NOTES sur ORBEC – 14478
Collection de Répertoires Sommaires des Documents Antérieurs à 1800 Conservés dans les Archives Communales – Ministère de L’instruction Publique.
VILLE D’ORBEC.
I. Dioc . de Lisieux. Siège d’un bailliage. Maîtrise d’Argentan .
Gr. à sel de Bernay – Gén. et int. d’Alençon; él . de Lisieux ; siège d’une subdélégation .
II. Distr. de Lisieux; ch. 1. de canton (Arrêté du 1er mars 1790).
III . 4 arr . communal (Arr. de Lisieux); ch.- 1. de canton (Loi du 28 pluviôse an VIII et arrêté du 6 brumaire an X ). Pop.: 2.974-2.896 hab. ( 1911 ). Sup.: 1.009 hect. 77 a. 74 c.
ADMon Gale. Délibérations des officiers municipaux . 20 septembre 1767-3 février 1790 (1er reg. , fol. 1-20; 2°-8° reg. ); de l’assemblée générale, pour la milice bourgeoise, etc. 6-30 octobre
1786 (9 reg.); du Comité général national de subsistance et bienfaisance. 31 juillet 1789-28 janvier 1790 (10-11 reg. )
Délibérations municipales. 30 janvier 1790-11 frimaire an IV (12 reg., 1er reg., fol. 21-126 ; 13-18 reg. ) Enregistrement des lois. 6 thermidor an II – 15 brumaire an IV ( 19 reg . )
Analyse, par l’agent national, des actes de la municipalité. 1er nivôse 3 ventôse an II (20 reg.)
Lacune : 31 octobre 1792-2 août 1793 .
Délibérations de la municipalité cantonale. 24 brumaire an IV-26 floréal an VIII (21-24 reg. ) -Séances décadaires. 10 vendémiaire an VII – 40 vendémiaire an VIII (25° reg.) – Arrêtés sur pétitions . 14 ventôse an III -pluviôse an VI (26 reg.)
Divers pétitions . 1792 , an V-an VIII ( 2 liasses ) .
Voir aux Archives du Calvados le « registre de police de l’agent municipal d’Orbec. An IV-an V : affaires diverses de la municipalité cantonale (3 reg. et 1 liasse ).
ÉTAT-CIVIL . Baptêmes. Décembre 1649-1664 . — Baptêmes, mariages et sépultures , depuis 1665 .
Abjurations. 1684-1686 . Audiences de contrats . 1685-1691 .
Tables alphabétiques . 1650-1788 (2 reg .)
STATISTIQUE . États nominatifs de la population ( Sections A,E et G). 1791 (6 cah.); An IV (Cah.)
Semblable état pour Bienfaite. An IV ( Cah. )
Mercuriales (minutes des audiences de police du bailliage). Octobre 1754-11 novembre 1790 (4 cah.)
Lacunes octobre 1762- novembre 1769, mars 1775 – février 1776.
Journal de la halle . 2 janvier 1790-4 messidor an IV (6 reg.) ;21 pluviôse an VII – 15 fructidor an VIII (Reg . )
Jusqu’à nivôse an II, noms des vendeurs et acheteurs , quantités et prix; depuis le 11 nivôse an II, enregistrement des apports de grains et distributions .
Mercuriales de la police municipale. 9 juin 1790-3 août 1791 (Reg. ) Dépôts de grains à la halle . 28 octobre 1788-9 septembre 1789 (Reg., fol. 1-31 ); – 11 brumaire an III-10 pluviôse an IV (Reg., fol . 32-95 ) . Prix commun des grains . 1790-1793 – (Liasse ) Comptes d’achats et distributions de subsistances . 30 juillet- 29 novembre 1789 (Cah. et 1 p.); 4 vendémiaire- 25 frimaire an IV (2 cah. et 6 p.)
Réceptions des maîtres des corporations ( minute des audiences du bailliage ). 20 juin 1747-23 mai 1754 (Reg. )
Un dossier relatif aux foires et marchés, depuis l’an V , indiqué par l’inventaire arrêté le 9 septembre 1865, n’a pu être vérifié.
IMPOSITIONS. Estimation des maisons et biens – fonds de la ville. 1719, 1750, 1755 (4 cah .)
Rôles de la taille. 1723-1790 (70 cah.)
Lacunes : 1724, 1740, 1742. Pour 1762, en outre, un rôle de rejet et un rôle de recette des impositions accessoires (militaires) .
Contribution foncière : états de sections ( Sections A-H). 1791 (8 cah.); travail de l’an V : déclarations (1 p.) ; état de changement. An VII Cah.) – Matrices . 4792 , an III , an V (3 cah.)
Contribution personnelle -mobilière états de sections (Sections A-H) .1791 (8 cah.); travail de l’an V: déclarations (1 p.); état de changement. An VII Cah.) – Matrices. 4792, an III, an V (3 cah.). Contribution personnelle-mobilière états de sections (Sections B, D-E. H). 1794 (4 cah.an V – an VII (6 cah.)
Matrices. 1792-1793 , an III.
Rôle de la taxe pour les dépenses locales . An IV ( Cah.)
Divers . 1791 – an VII (Liasse ) .
Portes et fenêtres . Recensement . An VII ( Liasse ) .
Patentes (pour le canton). États et correspondance . An V- an VII (Liasse) .
Matrices et rôles des contributions pour les communes du canton Foncière. 1791 (manque Bienfaite ) ; – an III ( manquent Cerqueux et La Cressonnière ); an V (Familly seul) ( 20 cah. )
Personnelle -mobilière. 1791; – an III ( manquent Abenon, Bienfaite, La Cressonnière, Familly, La Vespière ); – an V (manque Abenon); an VII (Abenon, Cernay, Cerqueux, La Cressonnière et Tordouet seuls) (33 cah. )
AFFAIRES MILITAIRES . Enregistrement des routes des détachements et isolés. Avril 1728-4 messidor an VIII ( 3 reg. et 1 cah.)
Lacunes septembre 1733-1758 , avril 1793 – nivôse an VII .
État des réquisitionnaires. Août 1793. Recherche des volontaires en congé. An III; des réquisitionnaires qui n’ont pas rejoint. An IV (3 liasses ). Conscription. An VII- an VIII (2 liasses) .
Ces documents portent sur l’ensemble du canton
Secours aux familles des défenseurs de la Patrie: déclarations des ayants droit; états de mandatement. An II – an IV (6 cah. et 1 liasse) ; dossiers individuels des défenseurs certificats, correspondances. An II- an IV ( Carton) .- Pensionnaires militaires. An VII (Liasse) .
Habillement. Comptes des draps fournis par les manufactures d’Orbec à l’administration militaire, marchés, échantillons. An II- an III (Liasse).
POLICE. Plumitif d’audience de la municipalité . 9 avril 1791-18 floréal an III 3 cah . ) ; minutes ( Liasse ) .
Geôle états de fournitures . An II -an VIII (Liasse ) .- Écrous. An II – an VIII (4 cah.)
Série incomplète ? – Des registres d’écrous antérieurs à 1790, des requêtes et minutes de sentences de police (6 liasses) ont été versés en 1892 aux Archives départementales .
ÉLECTIONS. Liste des citoyens actifs. 1790 (1 p .) Procès-verbaux des assemblées primaires. An V , an VII (2 liasses).
COMPTABILITÉ. – Enregistrement des mandats. 15 février 1793- 5 jour complémentaire an V Reg., fol. 1-35).
Des états d’actif et passif, depuis 1790; comptes du receveur, depuis l’an V; comptes de l’agent municipal, de l’an VII, indiqués par l’inventaire de 1865, n’ont pu être vérifiés.
PROPRIÉTÉS COMMUNALES . TRAVAUX PUBLICS . Adjudications diverses. 6 frimaire an VII – 6 nivôse an VIII (2 cah.) — Correspondance relative au projet de route entre Falaise et Bernay. 1790-1791 (Liasse) .
Les pièces ou dossiers ci-après, mentionnés par l’inventaire de1865, n’ont pu être vérifiés : Ci, depuis 1789. – Testaments, depuis 1761.- Baux. 1789 – an II. (28 fol.) – Alignements, depuis 1791. Règlements d’eau, depuis l’an II. – Pavages et plantations, depuis 1786. Devis. 1747-1788.
CULTES .
Deux dossiers : fieffes des bancs de l’église paroissiale ( 1770-1786); sommier de recette pour les Augustines d’Orbec (1635-1698) ont été versés aux Archives départementales en 1892 .
DIVERS .
Deux dossiers: aveux rendus au Domaine d’Orbec (baronnie de Pontchardon ) à Pontchardon, Avernes, Le Bosc-Renoult (1620-1690); et titres d’une famille La Hire (1669, cah.), ont été également versés aux Archives départementales en 1892.
Voir aux Archives du Calvados les délibérations du Comité de surveillance d’Orbec 16 mai 1793. 1er jour complémentaire an II. (2 reg.) ; — affaires diverses. An II. (Liasse).
Dictionnaire topographique du Département du Calvados : comprenant les noms de lieu anciens et modernes
Hippeau, Célestin.
ORBEC, canton de Lisieux, sur la rive droite de l’Orbiquet qui n’est encore qu’un ruisseau. — Orbeccus, 1090
(Orderic Vital, t. III, 1. VIII, p. 3 60). — Aurea Beccus, 1198 (magni rotuli, p. 15). — Orbeccum, 1200 (ch. de l’hospice de Lisieux, n° 38). — Auribecus, i23i (charte de Friardel). — Parrochia Beatoe Marioe de Auribeco in Molania, 1271 {ibid.).— Auribeccus, 1280 (cart. norm. n° 9/18, p. 289). — Capella Leprosa apud Auribeccum,XVI° s° (pouillé
de Lisieux, p. 35).
Par. de Notre-Dame, patr. l’abbé du Bec; lépros. de Sainte-Madeleine. Hôtel-Dieu du XVI° s; petit hôpital
établi en 1646 sous l’épiscopal de Mgr Alleaume, et dont la chapelle était dédiée sous le nom de Saint-Remi. Chef-Lieu d’un des doyennés de l’archidiaconé de Lieuvin , au diocèse de Lisieux.
Génér. d’Alençon, élect. de Lisieux, chef-lieu d’une sergenterie. La prébende des Chênes , — prebenda de Quercubus Tyoudi,XIV° s°; de Quercubus Theruldi, XVI° s° (pouillé de Lisieux, p. 18),— sur la paroisse de Saint-Jacques, faubourg d’Orbec, avait droit de mortuaire sur les vassaux.
Le fief d’Averne, sis à Orbec, 1678 (chambre des comptes de Rouen, t. II, p. 5o). Les fiefs de Beauvais, de l’Espervier et du Grand-Moulin furent incorporés au plein fief du Plessis, sis en la paroisse de Saint-Germain-la-Campagne, relevant du roi, 1671 (ch. des comptes de Rouen, t. II, p. 91).
Le doyenné d’Orbec {decanatus de Auribecco), dans l’archidiaconé de Lieuvin , comprenait : Saint-Aubin-de – Tanei, la Chapelle – Gautier, Meulles, Chambrais (aujourd’hui Broglie), Capelles-les-Grands, Familly, le Ronceray, la CbapcUe-Yvon, Saint-Pierre-de-Tanei (aujourd’hui Saint-Pierre-de-Mailloc), le Sap, le Mesnil- Guillaume, Saint-Marc-de- Fresnes, Saint-Germain-la-Campagne, Saint-Jean-de-Tanei, Saint-Denis-du -Val- d’Orbec (aujourd’hui Saint-Denis-de-Mail!oc), Grandcamp, les Ferrières-Saint-Hilaire, Orbec, Cerqueux-la-Campagne, Saint-Sébastien-de-Préaux, Tordouet, Notre-Dame-d’Aunay, Saint-Aubin-de-Bonneval, Saint-Julien-de-Mailloc, Cernay, Bienfaite, la Halboudière, le Benerei, Saint-Vincent-la-Rivière, Abenon, la Vespière , la Cressonnière , Friardel , la chapelle Saint-Jean dans l’église d’Orbec, la chapelle de la léproserie d’Orbec. En 1789, Orbec était le siège d’un bailliage royal composé de 208 communes dont 108 rassortissaient à Orbec, et de 26 justices ressortissant par appel au même siège.
La sergenterie d’Orbec comprenait : Abenon, Avernes, Auquainville, Bellou, Bellouet, le Benerei, Bienfaile, Bosc-Renoult, Canapville, Cernay, Cerqueux, la Chapelle-Yvon , Cheffreviile, la Cressonnière, Croisilles, Etrecheville, le Faulq, Fresnes, Jouvaux, Livarot, Lisores, les Loges, le Mesnil-Germain, Meulles, les Montiers-Hubert, Notre-Dame-de-
Courson, Notre-Dame-de-Livet, Notre-Dame-d’Orbec, Orville, Pontalery, Préaux, les Roncerets, Saint-Aubin-sur-Auquainville, Saint-Cyr-d’Escrancourt, Saint-Denis-de-Mailloc, Saint-Georges-du-Pont-Chardon , Saint-Germain-de-la-Campagne, Saint-Marc-du-Fresne, Saint-Martin-de-Mailloc, Saint-Martin-du- Pont-Chardon, Saint-Ouen-le-Hoult, Saint-Pierre-de-Courson, Saint-Paul-de-Courtonne, Saint-Pierre-de-Mailloc, Ticheville, Tonnecourt, Tordouet et la Vespière.
Orbec formait une vicomté qui dépendait du bailliage d’Évreux. Elle se composait des sergenteries d’Orbec (ville et banlieue), Lisieux, Bernay, Moyaux, Folleville, le Sap et Chambrais.
Les hautes justices d’Orbec étaient l’évêché-comté de Lisieux, le doyenné et le chapitre de Lisieux, Auquainville, le Molay, les Frênes, Drucourt, Menneval, Lieury, Gacé, Echaufrey, Fauguernon, les petites prébendes de Lisieux, Chambrais- Broglie, la Goulafrière, Saint-Philbert-des-Champs, Planes.
Beauvoir, f. et h. – Bellevue, h. – Bois (Le), h.- [Bois-Yvon (Le), fief du roi en la vicomté d’Orbec. — Boscus Yvonis , 1208 (magni rotuli, p. 9/1). — Boz ïvo, v.]. – Bourdonnière (La), f. – Capucines (Les), h. – Chenevotte (La), h. – Côte-à-Réaume (La), h. – Fontaines-Gosse (Les), h. – Fontaine-Varin (La), h. – Gingant, q. – Lackay, maison isolée – Livraye (La), moulin. – Madeleine (La), q. – Minière (La), h. et f. – Mondière (La), h. – Oziers (Les) , q. – Pagerie (La), maison. – Petits-Perriers (Les), h. – Prés (Les), h. – Roquet (Le), maison – Tréhardière (La), h. – Trichardière (La), f. – Trois-Croissants (Les), h. – Tronquet (Le), h. – Val-Rhimbert (Le), h. – Vieux-Château (Le), h. –
1 – Bibliographie :
2 – Pièces Justificatives.
3 – Archives ShL.
1 – Bibliographie :
Additions analytiques aux itératives représentations du Bailliage d’Orbec – 1788.
B.M. Lisieux F.N. 671.2.- B.
ARNOUX Mathieu, Forges et forêts au Moyen Age: l’exemple normand in Denis WORONOFF. 1990.
BAUME Andrew J.L., L’organisation militaire des seigneuries du duc d’York, Cahiers Léopold Delisle, XL, 1991 (1994).
BENET Armand, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Calvados.
BONNET de la TOUR Général R., « Le curé constitutionnel d’Orbec », PAR, 19, 4-1969.
CAUMONT Arcisse de; Statistique monumentale du Calvados, tome III.
Décret de la Convention nationale du 1er du 2e mois de la République Française. = Arch. mun. Orbec, A. 1
DELISLE Léopold, Actes normands de la Chambre des Comptes sous Philippe de Valois (1328-1350)A. Le Brument, 1871.
DETERVILLE Philippe, « Images du Pays d’Auge à la Belle Epoque: Le Vieux Manoir d’Orbec », PAR, 44, N° 2, Février 1994.
Orbec-en-Auge, Manoir de la Chénevotte, PGMPA. Le Vieux-Manoir.
DEVILLE Etienne, « Excursion du 26 août (1926) », AAN, 94, 1927.
Editions Flohic : Le Patrimoine des Communes du Calvados, page 1234.
ENGERAND Roland, En Pays d’Auge, ouvrage orné de 44 gravures, Tours, Arrault, 1937.
Etats des représentations des officiers du bailliage d’Orbec au Garde des Sceaux, s.l.s.n., In-8°= B.M. Pont-Audemer
FAUCHET Claude, Lettre de Claude Fauchet, évêque du Calvados aux citoyens d’Orbec, (2 janvier 1793), s.l.s.d.
FORMEVILLE Henry de, « Sentences rendues par les Commissaires enquêteurs réformateurs » MSAN, XIX, 185.
FORMEVILLE Henry de, « Les barons fossiers et les férons de Normandie », MSAN, XIX, 1851.
FORMEVILLE Henry de, Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux.
FOURNIER Dominique : Extrait du Tabellionage d’ORBEC (année 1463 )
Bulletin du Foyer rural du BILLOT n°6O – Décembre 1997.
FOURNIER Dominique: les références à la justice dans la toponymie et l’anthroponymie normandes; BSHL n°61, décem. 2006.
F.R.A.M. Fonds Régional d’Acquisitions pour les Musées de Basse-Normandie. 1982-1992, Alençon, 1992.
FRONDEVILLE Henri de, « Documents concernant la cession de la vicomté d’Orbec », Bull.Soc.hist.d’Orbec, n° 5, 1934-1935.
FRONDEVILLE Henri de, La Vicomté d’Orbec pendant l’occupation anglaise (1417-1449)t. IV, 1936.
FRONDEVILLE Henri de, [Documents sur l’histoire d’Orbec, XIV-XVIe s°], Bull.Soc. hist. d’Orbec, n° 6, 1936, ( 1938).
FRONDEVILLE Henri de, Le Compte de Gautier du Bois, vicomte d’Auge pour la Saint-Michel 1312 in Mélanges publiés par la Société de l’Histoire de Normandie, 15e série, pp. 25-62
FRONDEVILLE Henri de, Recherches sur la Vicomté d’Orbec au XIV° siècle, Bernay, Claudin s.d. (1938) ( Extrait du Bull. de Soc. Hist. d’Orbec, II, 1938), 76 p.; p. 54. Garencières
FRONDEVILLE Henri de, Recherches sur la vicomté d’Orbec au XIVe siècle, Bernay, Claudin et Bull. Soc. Hist. d’Orbec, II, 1938.
FRONDEVILLE Henri de, « Le Compte de la Vicomté d’Orbec pour la Saint–Michel 1444 – Jean Le Muet, Vicomte et receveur », Etudes lexoviennes, IV, 1936.
FRONDEVILLE Henri de, « Documents concernant la cession de la vicomté d’Orbec, 1470-1476 », Bull. de la Soc. hist. d’Orbec, n° 5, 1934-1935.
FRONDEVILLE Henri de, « Quittances de travaux concernant le château d’Orbec », Bull.Soc. Historique d’Orbec, II, 1938.
FRONDEVILLE Henri de, « Le Comté de Beaumont-le-Roger apanage de Robert d’Artois (1310-1331) », BSAN, t.XLV, 1937 (1938).
BSAN
GOY Robert, « Les cahiers de doléances du Tiers Etat du Bailliage d’Orbec1789 », PAR, 26, N° 11, Novembre 1976 – N° 12, Décembre 1976.
GOY Robert, « Les députés du bailliage secondaire d’Orbec et l’assemblée du bailliage principal d’Evreux », PAR, 27, 2-1977.
GROMORT Georges, Documents d’architecture. Petits édifices – Deuxième série – Normandie. Constructions urbaines en pans de bois, Paris, 1927.
GUIBLAIS R., Promenades dans le canton d’Orbec-en-Auge, Rennes, Imp. Bretonne, 1959.
GUILMETH Auguste, Orbec, s.l., s.d., In-8, 48 p. = M.C. Br. E.D. 1167 ( incomplet)
= L’ex. de la Bibl. mun. de Caen: Res. F.N.B. 971 comporte 48 p. imprimées et 16 p. ms. ( écriture de Ch. Vasseur ?)
JOBEY Ch., Histoire de la ville et du bailliage d’Orbec dans Bull. de la Soc. Historique d’Orbec, 1937.
JOUAN Isabelle dir., Pays d’Auge Guide des cantons de: Lisieux II,.
LACOUR, Notice historique sur la ville et les environs d’Orbec depuis le IXe siècle, Lisieux-1867. In-8°, VI-198 p.
LE CHERBONNIER Yannick : L’architecture fromagère en Pays d’Auge. Bulletin du Foyer rural du Billot n° 91 Sept. 2005.
LE HARDY Gaston, « Le dernier des ducs de Normandie. Etude critique sur Robert Courte-Heuse », BSAN, X, (1882).
LESCROART-CAZENAVE Elisabeth, « Il était une fois la Révolution (à Orbec) », PAR, 39, N° 7-8, pp. 50-56
LESCROART-CAZENAVE Elisabeth, Orbec dans Isabelle JOUAN Isabelle, dir., Pays d’Auge – Un terroir, un patrimoine – Guide des cantons de: Lisieux II, Saint-Pierre-sur-Dives, Livarot, Orbec, s.d. (1989), pp. 47-51
LESCROART-CAZENAVE Elisabeth, Orbec dans Art de Basse-Normandie, n° 101, Décembre 1993, 112 p. ill.
LESCROART-CAZENAVE Elisabeth, « Orbec en Pays d’Auge », PAR, 45, N° 1, Janvier 1995, p. 5
LESCROART-CAZENAVE Elisabeth, « L’église Notre-Dame d’Orbec », PAR, 45, N° 1, Janvier 1995, pp. 7-21, ill.
LESQUIER Jean, « Les plus anciens textes de la Société Historique de Lisieux – 1208-1450 », BSHL, N° 22, 1914-1915.
LETOREY Dominique, Les confréries de charité en Pays d’Auge dans Isabelle JOUAN dir., Pays d’Auge – Un terroir, un patrimoine – Guide des cantons de: Lisieux II, Saint-Pierre-sur-Dives, Livarot, Orbec, pp. 15-16
L’EXPLOITATION ANCIENNE DES ROCHES DANS LE CALVADOS : HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE. Serv. dép. d’Archéologie. 1999.
MAYER Jannie, Catalogue des Plans et Dessins des Archives de la Commission des Monuments Historiques – Tome I, Basse-Normandie: Calvados Orbec-en-Auge.
MERLIN-CHAZELAS Anne, Documents relatifs au Clos des Galées de Rouen et aux armées de mer du roi de France.2 vol., Paris, Bibliothèque Nationale.
MIROT Léon, Inventaire des paiements et quittances de travaux exécutés sous le règne de Charles VI (1380-1422) en Normandie.
MONTIER Amand, Etudes de céramiques normandes. Les épis du Pré-d’Auge et de Manerbe, Paris,1904; Coll. Picard, p. 15.
NEUVILLE Louis Rioult de, « De la résistance à l’occupation anglaise dans le pays de Lisieux de 1424 à 1444 », BSAN, t. XVI et t. à p. Caen, Delesques, 1893.
NEUVILLE Louis RIOULT de, « Les Barons d’Orbec », MSAN, XXX, p. 750 sq.
NORTIER Michel, Testament de Roger le Véel Cahiers Léopold Delisle, XL, 1991 (1994).
PAUMIER Henri : Les moulins des papetiers du Pays d’Auge. Bulletin du Foyer rural du Billot, n°82, juin 2003.
PELLERIN Henri, « Notre-Dame d’Orbec », PAR, 11, N° 9, Septembre 1961.
PELLERIN Henri, « Les trésors d’art de nos église », PAR, N° 3, Mars 1962.
PELLERIN Henri, » Un magnifique ornement du XVIIIe siècle », PAR, 12, N° 5.
POUGHEOL Jacques, « Exposition des trésors d’art du Calvados et de Basse-Normandie.Art de Basse-Normandie, n° 6, 1957.
RUAULT A., « Origine et particularités de l’ancien chemin du Mans à Rouen », BSAN, 1930-1931.
SIMON Georges-Abel, « Orbec », BSHL, N° 27, 1926-1930 (1930), p. 209
TISSOT Pierre-François-Amédée, Chemin de fer de Lisieux à Orbec. 1873.
VAULTIER Roger, Le folklore pendant la guerre de Cent Ans d’après les Lettres de Rémission du Trésor des Chartes.
VEUCLIN E., Notice sur les vitraux de l’église paroissiale d’Orbec, Orbec, 1878
VIVIER Marie-Noëlle, L’architecture fromagère en Sud Pays d’Auge dans Isabelle JOUAN Isabelle dir., Pays d’Auge.
Revue Le Pays d’Auge:
A. Bihorel-Le petit train d’Orbec-1952,04-avr.
Henri Pellerin La Statistique monumentale du Calvados, par Henri Pellerin – Canton d’Orbec.</p<
2 – Pièces Justificatives:
STATISTIQUE MONUMENTALE DU CALVADOS PAR ARCISSE DE CAUMONT.
Notes de M. Ch. Vasseur.
Il n’entre pas dans le plan de cette statistique de s’étendre sur l’histoire des villes et localités importantes. Tôt ou tard il se trouvera , sans doute, des écrivains pour entreprendre ces travaux, qui ne sont pas dépourvus de charme.
Orbec, chef-lieu d’un des grands bailliages de Normandie, domaine royal et baronnie possédée successivement par les plus puissantes maisons, exigerait plus d’un volume. Cette ville, qui compte aujourd’hui 3,266 habitants (un cent de moins qu’en 1760), est construite sur la rive droite de l’Orbiquet, et s’étage sur la pente assez raide du coteau qui circonscrit la vallée. La difficulté opposée aux constructions par cette pente rapide fait que la ville a pris surtout son extension du nord au sud, parallèlement à cette vallée. C’est dans cette direction que se développe la grande rue, autrefois le Pavé du Roy, qui doit avoir suivi le tracé de la voie romaine de Lisieux.
Au centre de cette large voie étaient bâties les halles, surmontées de la cohue ou salle commune pour les délibérations des habitants. Mais l’administration très-progressive de la ville d’Orbec a fait jeter bas ces vieilleries, que remplace un coquet Hôtel-de-Ville en briques et plâtre, établi dans les quartiers neufs.
Cette artère principale partage la ville en deux parties à peu près égales. A droite, l’église, les Augustins, le bailliage et quelques maisons qui ne sont pas dépourvues d’intérêt ; à gauche, le château, l’hôpital, la geôle, les Capucins.
Église paroissiale.
— L’église paroissiale d’Orbec est sous l’invocation de Notre-Dame. Les curés étaient à la nominationde l’abbé du Bec-Hellouin ; mais les seigneurs d’Orbec y avaient une chapelle particulière, dédiée à saint Jean, dont ils s’étaient réservé le patronage. Le plan de cet édifice est fort irrégulier. La construction n’est pas homogène : l’analyse fait voir que les diverses parties appartiennent à des époques fort différentes. L’intérieur se décompose en une nef centrale, flanquée de deux collatéraux de largeur inégale: au midi, une chapelle en transept ; au nord, une chapelle irrégulière et une tour massive.
Dans le pignon occidental, flanqué de trois contreforts, s’ouvre la porte principale, à double baie carrée divisée par un trumeau central que surmonte une fenêtre ogivale à trois meneaux, dont la tracerie se compose de trois rangs de quatre-feuilles. Une autre fenêtre ogivale éclaire le bas-côté nord. Au sud, la nef est régulièrement divisée, par des contreforts, en cinq travées percées de fenêtres ogivales flamboyantes. La chapelle, en saillie sur ce bas-côté, appartient également au style ogival tertiaire. Le mur latéral du nord, qui comprend deux travées, n’a aucune ouverture.
A la suite vient labour carrée, à la base massive et sans ouvertures, à l’exception d’une porte à deux baies carrées garnies de vantaux à panneaux flamboyants. Deux contreforts placés d’angle buttent les murs, d’une épaisseur très considérable.
Sur ce corps carré se trouve en retraite un second étage plus svelte, percé sur chaque face de fenêtres cintrées et orné de tous les détails usités à la Renaissance, par conséquent un peu postérieur à la première partie. Un toit à double épi, en ardoise, ajouré sur chaque face d’une petite lucarne trilobée surmontée d’un épi en plomb, termine cette tour, qui des coteaux voisins produit un effet assez bon, malgré sa robuste structure, rappelant le donjon.
Entre la tour et le choeur se développe une très-vaste chapelle à angle coupé, percée de quatre fenêtres flamboyantes.
Le choeur peut remonter au commencement du XIIIe siècle; ses contreforts sont construits en poudingue, avec deux retraites; malheureusement les ouvertures primitives ont été dénaturées.
L’irrégularité du plan produit à l’intérieur un effet peu agréable; mais dans les détails on trouvera de curieux sujets d’examen.
Six arcades ogivales, portées par des colonnes sans chapiteaux, font communiquer la nef avec les bas-côtés et le transept.
Toutes les voûtes sont en merrain, avec charpentes apparentes, excepté celle de la base de la tour.
Les fenêtres conservent encore des restes notables de leurs magnifiques verrières: la restauration en serait facile. J’y ai reconnu, parmi des fragments moins importants, une Vierge-Mère, une sainte Anne, un saint Louis, un arbre de Jessé, et dans la chapelle du nord, dédiée à saint Jean-Baptiste, le martyre du Saint en plusieurs tableaux.
Deux pierres tumulaires se trouvent dans la chapelle du sud et dans l’extrémité du collatéral, devant l’autel. Voici les inscriptions qu’elles portent :
ICI REPOSE
MESSIRE CLAUDE DU MERLE (1)
XCUYER SEIGNEUR DE
S. GERMAIN DE LA CAMPAGNE
D’ORBEC EN PARTIE
ET DE LA VESPIERRE
DÉCÉDÉ LE 28 AVRIL 1758
AGÉ DE 69 ANS
PRIEZ DIEU POUR LUI.
(1) CLAUDE du Merle, écuyer, seigneur du Plessis, de St-Germain-la-Campagne, d’Orbec en partie et de La Vespière,
décédé le 29 avril 1738, à l’âge de 49 ans, et inhumé devant l’autel principal de l’église d’Orbec; Marié, le 25 juin 1717, avec MARIE-ANNEVERZURE, originaire de Gênes, fille de Jean-Laurent Verzure, qualifié noble Génois, et de Marie-Catherine Souëf
ICI REPOSE
MESSIRE PIERRE DU MERLE (2)
ECUYER SEIGNEUR DE
S. GERMAIN DE LA CAMPAGNE
ET D’ORBEC EN PARTIE
DÉCÉDÉ LE 28 AVRIL 1720
PRIEZ DIEU POUR LUI.
(2)PIERRE Ier du Merle, chevalier, seigneur du Plessis, de St-Germain-la-Campagne, d’Orbec, etc., qui fit inscrire son
nom et ses armes dans l’Armorial général de France de Ch.d’Hozier, juge d’armes, en 1697 ; décédé le 20 avril 1700, et
inhumé devant l’autel de la Vierge de l’église d’Orbec; Marié, le 40 mai 1688, avec MARIE-GABRIELLE DE NOCE, fille
de Claude de Nocé et de Marie Le Roy de Gomberville, dont un fils, qui suit, et une fille, Anne-Dorothée, mariée, en septembre 1707, à Charles de Quérière-Bois-Laval.
Les boiseries de l’orgue, dans le style de la Renaissance, sont assez remarquables, ainsi que celles de la porte du nord qui sont en style gothique.
Le choeur est entouré d’une grille en fer contourné du dernier siècle.
Le maître-autel, style Louis XIV, est d’une très-belle exécution.
Le retable consiste en quatre colonnes torses à ceps de vigne d’ordre composite portant un entablement, à arc surbaissé, surmonté de volutes sur lesquelles sont assis des anges qui tiennent les instruments de la Passion. Un cadre sculpté, à angles rentrants concaves, entoure une toile représentant l’ensevelissement de Notre-Seigneur. Ce tableau a de la valeur.
Le tabernacle, semi-hexagonal, est cantonné sur les angles de colonnettes en faisceau. Les cinq niches abritent les statuettes du Sauveur et des quatre Évangélistes. Enfin, trois médaillons renferment le Père-Éternel, N.S. Jésus-Christ et la Sainte-Vierge.
Cet autel est presque identique à celui de St-Martin-de-Bienfaite, et son exécution est due incontestablement au même ouvrier. Il occupait, avant la Révolution, le fond de la chapelle des Dames Augustines. L’ancien maître-autel, moins important, a été reporté dans la chapelle du sud. Également du règne de Louis XIV, M. Raymond Bordeaux l’avait signalé dans ses Excursions archéologiques dans la vallée d’Orbec, en 1851. Il est, dit-il, « décoré d’un tableau malheureusement très-altéré par des retouches grossières, mais qui peut avoir encore quelque intérêt pour l’histoire de la peinture provinciale au XVIIe siècle. — Il est signé ainsi : 1644. G. RUGÉ pingebat.
Nous plaçons ici un dessin de la clanche d’une des portes de l’église, que nous devons à M. Bouet.
On trouve dans la sacristie deux statues du moyen-âge: saint Louis et saint Eloi, et une chasuble dont les broderies datent du XVIe siècle.
La cloche principale est ancienne et fort belle. Elle ne porte que cette courte inscription :
IAY . ESTE – FAICTE . EN – L’HONNEVR . DE
On trouve dans la sacristie deux statues du moyen-âge :
saint Louis et saint Eloi, et une chasuble dont les broderies datent du XVIe siècle.
La cloche principale est ancienne et fort belle. Elle ne porte que cette courte inscription :
IAY . ESTE – FAICTE . EN L’HONNEVR . DE • LA – SAINCTE .
TRINITE • AV • MOIS – DE . IVIN . 1700.
JEAN AVBERT
DE LISIEVX
MA FAICTE.
Les trois autres cloches de la sonnerie datent de 1819 et 1866.
Hôtel-Dieu.
— L’Hôtel-Dieu d’Orbec offre un intérêt tout particulier. Il date du XVIe siècle et on peut retrouver encore ses dispositions primitives.
Malheureusement l’administration municipale va porter la sape au pied d’une partie de ces curieuses constructions, pour mettre mieux en évidence une bâtisse neuve destinée à loger le personnel.
En dégageant l’édifice primitif des additions pratiquées aux XVIIe et XVIIIe siècles, on trouve une chapelle avec nef à double étage et une vaste salle qui s’appuie sur le mur latéral du nord. La façade se développe sur la grande rue.
Elle est construite en briques, butée par deux contreforts très-saillants. La porte est une ogive obtuse à deux voussures en retraite, biseautées. Un léger encorbellement, au niveau du plancher de l’étage supérieur supérieur, a permis de placer une corniche sculptée en relief. Au centre s’offre un blason dont la forme accuse le XVe siècle.
Il est parti au premier de deux fasces et d’une pièce ondulée en pointe; au deuxième peut-être d’un lion. A droite est un autre blason incliné sur le flanc dextre, soutenu par deux anges et sommé d’un casque à lambrequins. Il est meublé des mêmes pièces que la première partition du précédent.
L’autre extrémité de la frise, fort dégradée, représentait des personnages en ronde-bosse, peut-être la Vierge Mère de Douleurs et un personnage debout.
On a incrusté dans le contrefort du sud une autre composition en bas-relief, où j’ai cru reconnaître le baptême de Nôtre-Seigneur. Évidemment ces sujets ne sont pas à leur place, et leur style indique une époque antérieure à la construction dans laquelle ils sont encastrés. Ce petit portail est couronné par un campanile garni de plombs repoussés, dont nous offrons un croquis fait par M. Bouet.
Ce clocher a l’apparence d’un beffroi et peut-être en avait la destination. On voit que ces ornements portent les caractères de la Renaissance.
Vers le nord, adossée au portail que je viens de décrire, se trouve la salle de l’Hôpital, bâtie également en briques. Ses fenêtres sont carrées, avec croisées de pierre. Une porte particulière s’ouvre sur la rue dans le rez-de-chaussée. Le mur commun à la nef de la chapelle et à cette salle est percé d’arcades surbaissées, maintenant bouchées, mais dont on reconnaît parfaitement la situation. On les avait sans doute, dans l’origine, garnies de châssis ou d’une clôture mobile que l’on ouvrait pendant les offices, afin de permettre aux malades et à leurs infirmiers d’assister aux cérémonies du culte.
Comme la nef est dans une proportion fort restreinte, on l’a partagée dans sa hauteur par un plancher qui forme une vaste tribune ouverte sur le choeur, avec une balustrade à fuseaux au-dessous de laquelle règne une frise sculptée de rinceaux. Cette boiserie, d’une bonne exécution, peut remonter au règne d’Henri III. L’escalier en vis qui y donne accès est construit en briques, il est curieux à étudier.
Le choeur, bâti en pierre de taille, se compose de trois travées; la dernière en pan coupé, avec contreforts sur les angles et fenêtres à traceries flamboyantes. Les voûtes en pierre, à arceaux prismatiques, sont reçues par des faisceaux de colonnettes garnies d’un listel, mais sans chapiteaux. Ces faisceaux sont coupés par des niches avec consoles et dais gothiques, privés de leurs statues. En 1851, M.R. Bordeaux y avait vu des « statuettes peintes et dorées, qui étaient incontestablement supérieures à ces banales figures de plâtre blanc, aujourd’hui devenues de mode dans les églises » et qu’on finira probablement par y mettre. Deux des clefs de voûte portent des figures singulièrement groupées, où l’on reconnaît les instruments de la Passion.
Signalons enfin le bel épi en plomb, du XVe siècle, qui surmonte le poinçon du chevet.
On parle de changements notables projetés pour mettre cette chapelle intéressante plus en harmonie avec le nouvel Hospice. Espérons qu’il n’en sera rien.
Dédiée à saint Remi ; la nomination du titulaire appartenait à l’évêque de Lisieux.
Les fenêtres possèdent des débris de leurs anciennes verrières. Deux vitres neuves, dans le style du monument, ont été tout récemment exécutées par M. Duhamel, d’Évreux.
Outre son Hôpital, Orbec possédait encore, au moyen-âge, une Léproserie ; mais j’en ignore l’emplacement.
Capucins.
— Le couvent des Capucins a disparu aussi à peu près. Il fut établi en 1646, grâce aux générosités de la maison de Melun, qui possédait le domaine de la Cressonnière.
A l’entrée de la ville, sur le chemin de Lisieux, ses beaux jardins en amphithéâtre servaient de gradins à la maison, construite, comme celle de Lisieux, avec un préau central entouré d’un cloître. Derrière se trouvait un vaste verger , puis un bois percé de belles allées, qui occupait le sommet du coteau. Ce vaste enclos était entouré de murs.
Augustines.
— Le couvent des Augustines a été divisé, et c’est sur une partie des terrains qu’il occupait que s’élève le nouvel Hôtel-de-Ville. L’église a été transformée en halle après la destruction de l’édifice affecté à cet usage. Nous allons laisser, pour sa description, la parole à M. Raymond Bordeaux, qui s’exprimait ainsi il y a quelques années :
«Il eût fallu certainement comprimer nos instincts d’archéologue pour ne pas faire le tour de cette ancienne église des Augustines, dont le clocher d’ardoise et les ogives effondrées attiraient notre curiosité. L’architecture en est d’ailleurs fort simple et sans aucunes sculptures ; et, bien que les fenêtres soient ogivales, cette chapelle ne nous parut point remonter plus loin que les premières années du XVIIe siècle.
Ce fut dans cette église qu’on déposa les restes d’un des plus illustres jurisconsultes normands. Josias Bérault, né à Laigle, en 1563, avocat au Parlement de Rouen et conseiller à la Table de Marbre, vint habiter à la Vespière, village qui forme en quelque sorte un faubourg d’Orbec. On dit qu’il y travailla à ses Commentaires sur la Coutume de Normandie.
Mort vers 1647, il eut pour dernière demeure cette chapelle des Augustines, où sa cendre repose peut-être encore sous quelque dalle effacée. »
Les dames Augustines, sous l’invocation de saint Joseph, furent fondées en 1632, par Mme Claude Alexandre, veuve de Jacques Le Portier de La Surière. Chassées par la Révolution, elles sont revenues à leur berceau après la tourmente, et elles possèdent de l’autre côté de la ville un pensionnat prospère.
Maisons.
— Les rues sont encore bordées de vastes hôtels du XVIIe ou du XVIIIe siècle, sévères comme les magistrats du bailliage auxquels ils servirent de demeure. Malheureusement, trop vastes pour les habitudes rétrécies de notre époque, ils auront bientôt disparu. Leur description entraînerait loin, et exigerait, pour être complète, des détails historiques trop abondants pour entrer dans cette statistique.
Indiquons seulement, dans la grande rue, une maison de bois de la fin du XVIe siècle : on y lit la date de 1568. Les entre-colombages sont garnis de tuiles inclinées ; les sablières étaient couvertes de fleurons, d’oves et de godrons, tandis que les poteaux se chargeaient de larges feuillages en consoles.
La lucarne, aussi richement ornée, est aujourd’hui découronnée. Sur un des poteaux corniers on voit une enseigne dessinée par M. Bouet. et représentant un apothicaire préparant ses drogues dans un mortier.
La maison voisine date du XVe siècle. Elle est sans sculptures ; mais ses moulures, bien profilées, méritent un coup-d’oeil.
Au bas de la ville, non loin de la route de Livarot et du point où les anciens plans placent le Bailliage, existe encore une tourelle de pierre octogone, ornée sous le larmier d’une frise de feuillages gothiques fortement fouillés. Des pinacles feuillagés font contreforts sur les angles. Les baies, largement ouvertes, sont carrées, entourées d’une gorge où l’on a ménagé des guirlandes du même genre. Le toit était pyramidal, couvert en ardoise. Cette tourelle, oeuvre du XVe siècle, dépendait d’une maison en bois assez importante, qui s’est trouvée modifiée au XVIIe siècle.
La ville d’Orbec n’a jamais été close de murs. « Il ‘est vray, dit un ancien document, qu’en 1534, les habitants du lieu obtinrent permission du roy de faire des fossez… qu’ils commencèrent à les fouiller ; mais ils en discontinuèrent bien tost le travail à cause que le seigneur d’Orbec dont releuent tous les héritages scituez dans les lieux qu’on avoit désignés pour les fossez et les remparts dud. bourg, empescha qu’on ne passast outre jusqu’à ce qu’il eust este indemnisé des cens et rentes qui lui étaient deüs… »
Des procès pendants, en 1657 et 1698, ralentirent le zèle des habitants pour un pareil objet, d’ailleurs peu utile.
De là il suit qu’il n’y a point encore eu de fossez ny de remparts ny de portes au lieu d’Orbec. »
Par contre, il y avait deux châteaux-forts : l’un entre les mains du seigneur, l’autre réservé aux apanagistes ou engagistes du domaine royal.
Le château royal, le plus important, occupait le coteau au levant, au bout de la rue de Geôle. On en voit encore de notables débris. Il a déjà été décrit par M.Raymond Bordeaux dans son excursion de 1851. Il était composé de deux enceintes, comme tous les châteaux de moyen-âge. La plus vaste et la plus voisine de la ville était de forme ovale et mesurait environ 45 toises à son plus grand diamètre, du nord au sud. Il subsiste encore quelques pans de mur dont il est difficile d’indiquer l’époque.
La seconde enceinte, plus haut sur le coteau, devait contenir le donjon. C’est une motte presque ronde ; on la nomme le Bonnet-Carré (1). Un fossé profond la séparait de la première enceinte.
(1) Orbec. Le « Bonnet-Carré », motte à double enceinte, à l’est de la ville. (De Caumont: Stat. mon.,t. V, p. 793, et Cours d’antiq., t. V, p. 195.)
Cette place a eu une certaine importance. D’abord apanage de la maison d’Orléans, elle fut cédée, en 1353, au roi de Navarre, en échange du comté de Champagne. Les révoltes de ce prince amenèrent la destruction de ses places fortes de Normandie, vers 1378. Orbec fut rétabli, car en 1418 le roi d’Angleterre en gratifia le duc de Clarence.
Conquis de nouveau en 1448, il rentra dans le domaine royal pour être, au XVIIe siècle, engagé à la dame de Balagny.
Enfin, par lettres-patentes du mois d’avril 1777, enregistrées au Parlement de Rouen le 14 novembre suivant, les domaines d’Orbec et de Falaise furent donnés par Louis XVI a Monsieur, son frère, depuis Louis XVIII, en remplacement de St-Sylvain, le Tuit et Alençon.
Le château, que je regarde comme ayant appartenu aux barons d’Orbec, est situé à une petite distance de la ville, sur la route de Lisieux, à peu près en face de Bienfaite. On en voit encore quelques pans de murs qui couronnent le
coteau au pied duquel passe la route.
Les seigneurs d’Orbec prétendaient tirer leur origine de Richard Ier, duc de Normandie. Richard de Clère, seigneur d’Orbec et de Bienfaite, suivit le duc Guillaume en Angleterre.
Ce sont ses fils qui désunirent les deux terres ; car on trouve dans la liste des compagnons de Robert II, pendant son voyage en Terre Sainte, Jean de Bienfaite, Guillaume et Jean d’Orbec. On n’a pas la filiation suivie de cette famille, qui tint toujours un haut rang parmi les nobles de Normandie et s’allia aux d’Harcourt, aux Giffart et autres maisons considérables. Du reste, ce n’est pas ici le lieu de s’en occuper : il suffit de citer les plus connus de ses membres.
Saint Louis érigea la terre d’Orbec en baronnie. Confisquée par le roi d’Angleterre après son invasion de la Normandie, elle fut restituée le 9 octobre 1419 à Pierre d’Orbec; mais c’est alors vraisemblablement que fut démantelé le château baronnial, car Jean d’Orbec ayant épousé Marie de Bienfaite, vers le milieu du XVe siècle, s’établit dans cette terre, où depuis lui presque tous les barons d’Orbec ont fait leur résidence. Son petit-fils, Guy d’Orbec, suivit le roi Charles VIII dans son expédition d’Italie, et le 6 juillet 1495, à la bataille de Fornoue, il se comporta si bien, que le roi le fit chevalier de sa main et lui octroya un don de 1,100 livres, qui n’était pas une mince somme pour cette époque.
Plus tard, il obtint du roi Louis XII la création de deux marchés par semaine et deux foires par an au bourg de Bienfaite. A la fin du XVIe siècle, Louis d’Orbec était bailli du grand bailliage d’Évreux. Il se mit à la tête des huguenots du pays et il encourut la responsabilité des dévastations commises dans la ville et la cathédrale de Lisieux, au mois de mai 1562.
En 1612, il ne restait plus que deux filles de cette puissante et antique maison : Louise et Esther d’Orbec. La première avait épousé en 1600 Jean du Merle, seigneur de La Motte; Esther s’unit à Jean de Bouquetot, seigneur du Breuil. Les terres composant la baronnie furent divisées entre les deux soeurs, dont les descendants prirent conjointement le titre de barons d’Orbec. La famille du Merle en a joui jusqu’à la Révolution ; elle est encore représentée aujourd’hui par M. le comte du Merle, qui habite le château de la Vespière. Esther d’Orbec n’eut qu’une fille, nommée Louise par sa tante, qui épousa Henri de Chaumont, baron de Lecques, dont la descendance mâle subsiste encore.
Henri de Chaumont, baron de Lecques (et non Lesquis) et de Bourdon, maréchal des camps et armées du Roi, mort en 1678, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Orbec lui était venu par son mariage avec Louise de Bouquetot, dame d’Orbec. (La Chesnaye-Desbois.)
Orbec a vu plusieurs fois des rois dans ses murs. Jean sans- Terre y séjourna du 5 au 6 décembre 1201, 1e 15 mars
et le 3 novembre 1203.
Louis XIII y coucha le 24 juillet 1620, dans ce voyage qu’il entreprit pour pacifier la révolte suscitée par la reine mère et Richelieu.
Promenade dans le Canton d’Orbec – Raymond Guiblais.
Orbec en 1820. Extrait.
En arrivant à Orbec, depuis Lisieux, on aperçoit l’extrême pointe du clocher de Notre-Dame et le beffroi de la chapelle de l’Hôpital. A droite l’Hôtel de Lisieux. La Halle à la poterie cache le « vieux Manoir ».
La Halle, détruite aux environs de 1830, s’élevait sur la place de la Poissonnerie.
La Place du Marché aux veaux et le Champ de Foire n’existaient pas. Le Marché aux veaux était un petit verger ayant appartenu aux Pères Capucins, le Champ de Foire était un jardin potager d’une ferme.
– Une modeste voie cahoteuse, appelée rue du Chaos, descendait vers la rivière entre ce jardin potager et les bâtiment de l’Hôtel de Lisieux, à l’emplacement du trottoir de la Place du Champ de Foire et la partie gauche du présent Bd de Beauvoir. C’était une voie antique qui se dirigeait vers Lillebonne (SM)) en montant par la rue des Capucins, le chemin du Calvaire et St-Germain-la-Campagne.
– Entre l’Hôtel de Lisieux et La Halle à la poterie se trouvait la Place du Marché. La rue de Livarot n’existait pas, pour gagner le pont de pierre, il fallait prendre la rue du Chaos et passé la rivière à Gué, ou prendre la rue de la Guillonnière pour regagner la rue des Moulins par la rue des Trois Croissants.
– Dans la Grande-Rue à droite Venelle Jouan et la rue Guillonnière à l’angle laquelle subsiste encore le vieux manoir et la maison natale de Lottin-de-Laval. Sur sa gauche, face au vieux manoir, la rue des Champs. Toujours existante, elle est une des plus ancienne voie de la ville. Puis sur sa droite les venelles des trois croissants et Dossin, inchangées (1959).
– Au centre de la ville s’élevait un très grand bâtiment remontant au moins au XV° siècle (hauteur rue de Geôle et rue Carnot) . Il servait de halle dans son rez-de-chaussée, et au premier étage siégés pendant des siècles les magistrats de baillage et vicomté d’Orbec.
– Au centre de la Grande-Rue, la rue de Geôle. Elle tire son nom des anciennes prisons.
– En face de la rue de Geôle s’amorçait la rue du Grand Monarque ( actuellement rue Carnot qui doit son nom à l’auberge portant enseigne « Au Grand-Monarque », il s’agissait de Louis XV. Mais cette rue était un cul-sac, un escalier, d’une dizaine de marches, permettait d’accéder à la rue des Religieuses. Il n’y avait pas de place d’hôtel-de-Ville. Elle était occupée par des vergers, des jardins et des pièces d’eau qui faisait partie de l’ancien couvent des Augustines (actuellement le cinéma-théâtre et l’école des filles.
– La mairie, qui se trouvait avant la Révolution au-dessus de la halle du centre de la Grande-Rue, près de la salle du Baillage, avait été transférée, au début du XVI° siècle dans la maison, habitée (* ) par M.Surtouque (Maison située à l’angle de la Rue-Grande et rue Saint-Rémy( * ), jusqu’à la construction de l’Hôtel-de-Ville, en 1848.
– La rue Saint-Rémy partait du porche de l’hospice, entre la chapelle et la maison Surtouque, longeait la chapelle de l’hôpital et rejoignait la rue de la Rigole.
– Une petite ruelle, qui partait de l’ancienne maison Rivière, abattue il y quelques années ( * ) aboutissait rue Saint-Rémy. Elle s’appelait rue de la Corde en raison de son profil arrondi.
– A droite de la Rue-Grande, la rue des Moulins, dont un tronçon, celui qui se raccorde à la Rue-Grande à pris le nom de Maxime-Pellerin.
– La rue des Moulins est l’une des plus anciennes rues d’Orbec. Elle est mentionnée dans de nombreuses Chartres du Moyen-âge.
Aux abords de l’église Notre-Dame, notons que la rue de l’Aigle n’existait pas.
Pour aller à Montreuil, à partir du centre ville, il fallait emprunter la rue du Petit-Four, qui se prolongeait, en traversant l’actuelle côte de Montreuil, par le petit chemin passant de nos jours (*) non loin de la partie sud du cimetière, pour aboutir en haut de la côte.
Pour se rendre de l’église à la rue du Petit-Four, il n’y avait que la rue Gigant.
– La rue Croix-au-Lyonnais existait (Croix au Lionnet). Elle doit son nom, d’après la légende, à deux lyonnais qui, venant à la foire d’Orbec, aurait été tués et inhumés à la fourche des routes de Vimoutiers et du Sap, où une croix avait été posé. En réalité, cette croix devait son nom à ca qu’elle portée les armories des Orbec, c’est à dire un lion d’où » La Croix Lionnée » « croix décorée d’un lion).
Au XVII° siècle, tout ce quartier de l’église était à peine bâti, il comportait des herbages avec des sources médicinales (?) et quelques belles habitations, comme l’Oraille.
Ce nom de l’Oraille peut avoir deux origines. Certains ont prétendu que ce mot venait du chemin qui conduisait à la léproserie de la Madeleine « Via ad oratoria » voie vers l’oratoire, ou voie l’oreuse, d’où l’oraille. D’autres, mieux informés, pensent-t-on, verraient dans l’Oreille une demeure construite à l’extrémité de la ville, à « l’aurée » de l’agglomération.
– La route du Sap, qui prolonge la rue Croix-au-Lyonnais est une voie antique, remontant à la plus haute antiquité.
Partant de cette rue Croix-au-Lyonnais, nous trouvions sur la gauche:
– La rue Gigant, dont nous avons parlé, la rue de Montreuil, qui n’était autre que la continuation du chemin de Mervilly. L’intersection de la rue du Petit-Four, de la rue de Montreuil et du chemin de Mervilly, s’appelait le carrefour de la Vespière.
– En suivant la rue Croix-au-Lyonnais, nous trouvons encore, de nos jours, la rue de l’Oraille, qui partant non loin du château de ce nom, relie la rue Croix-au-Lyonnais à l’ancien château de Montreuil.
– Sur la droite, en venant de l’église, et sensiblement dans le prolongement de la rue de Montreuil, se trouve une rue descendant vers le Petit-Moulin et qu’on nommait indistinctement « Rue Saint-Pierre », nom qu’elle a conservé aujourd’hui, ou venelle du Roulle. Elle s’appelait rue Saint-Pierre, en souvenir de l’ancienne église St-Pierre, qui s’élevait près de l’église Notre-Dame, avant les invasions normandes. Quant au nom de venelle du Roulle, il vient du bois appelait aujourd’hui « bois du Pavillon » et qu’on surnommé en ce temps là « bois du Roulle ». C’est à ce bois que conduisait la rue en question.
Quittant le quartier de la Croix-au-Lyonnais, nous arrivons à celui de la Croix d’Or, qui n’existait pas en 1762.
– La route de l’Aigle, la rue d’Orléans, la rue des Bains, ainsi que le chemin partant de la Croix d’Or et qui va à la Vespière, n’existaient pas, pas plus que le chemin qui passe entre l’étang et le moulin Fournet, autrefois moulin à Foulon, auquel on accédait par un sentier partant du château et qui contournait l’étang.
– Pour aller au château de la Vespière, un seul chemin existait, dont le tracé partait de l’actuel cimetière d’Orbec, passait près de l’église de la Vespière, pénétrait dans le parc et passait au pied même du château , situé non loin de l’étang, et après un mouvement tournant, longeait la carrière pour venir rejoindre les rues Saint-Rémy et de la Rigole. La rue du Rempart existait, ainsi que la Venelle du Château, qui toutes deux, partaient de la rue de Geôle, venaient rejoindre la rue Saint-Rémy et le chemin de la Vespière.
La rue de la République, qui n’existait pas en 1762, s’appela la rue Louis Philippe, parce qu’elle fut percée sous le règne de ce roi.
– Pour se diriger vers Bernay, en partant de la Rue-Grande, il fallait emprunter ou la rue des Capucins, ou la rue des champs, ou les rues de Geôle et Haute Geôle.
– La rue « Pont-Guernet » s’appelait rue « du Point-du-Jour ». Prolongeant la rue des Champs, elle aboutissait à une fourche de deux voies antiques, l’une se dirigeant vers Honfleur, en passant par l’actuelle rue Haute-Justice et l’autre conduisait à Bernay et Broglie (actuelle rue de Bernay).
– La ville d’Orbec a connu de nombreuses modifications au cours du XIX° siècle. Une seule rue restée à peu près intacte et celle des Moulins, dont une partie s’appelle maintenant rue du Dr Maxime-Pellerin. Cette rue existait déjà à la fin du XV° siècle, exactement à l’emplacement où elle se trouve de nos jours, et le livre de la Charité d’Orbec, qui fut rédigé au lendemain de la guerre de cent ans, la mentionne en nous donnant la liste de ses habitants. A cette époque-là, toute, toute la partie comprise entre la rue des Moulins et de la rue des trois croissants, était un vaste étang, alimenté parle ruisseau de la rue des Religieuses.
Au XV° siècle, cet étang fut asséché. Au XVII° siècle, les religieuses Augustines, dont le couvent s’élevé à l’emplacement de l’actuelle école de fille (1959) et du cinéma-théâtre, organisèrent à cette endroit de vaste jardins et l’Hôtel-de-Ville actuel, ainsi que la Place Foch et la Place Joffre, ont été réalisés à l’emplacement de ces jardins dans la première moitié du XIX° siècle.
A cette époque, on créa également la rue de Livarot, qui permettait d’aller directement, de la place du Marché (actuelle place de la Poissonnerie) au Pont de Pierre, et qui en somme, doublait l’ancienne rue du Chaos.Quant à la rue du Chaos, elle se transforma en une avenue (actuel Bd Bauvoir) qui eut un retour à angle droit, pour regagner la rue de Livarot avant le Pont de Pierre, évitant ainsi le passage à gué qui existé.
– En bordure de l’hôpital de Lisieux à la place d’un grand jardin on fit la Place du Champ de Foire.
De cet ensemble, réalisé au XIX° siècle, émergent quelques rues anciennes:
– La rue des Trois Croissants doit son nom à une auberge qui avait pour enseigne Trois Croissants d’or sur fond d’azur. Au moyen-âge, cette auberge s’appelait l’auberge des Trois Maries (Marie Mère de Jésus, Marie Mère de Jacques et Marie Salomé). Elle été située entre les fossés de la ville et la rue des Moulins, non loin de laquelle se trouvaient le Prêche des Protestants, le Jeu de Paume « cinéma-théâtre) et la rue du tripot (rue des Religieuses).
– En bordure de la rue des Trois Croissants s’élevait au Moyen-âge le bas-fort de la ville. Bastion de la forteresse qui défendait l’enceinte de la cité du côté de la vallée. Au XVI° siècle on aménagea un hôtel particulier à proximité du bas-fort et les qu’habitèrent les derniers seigneurs d’Orbec. Ils étaient protestants, dans leur propriété que furent aménagés le prêche et le cimetière des protestants.
– La rue des Religieuses est également ancienne; Elle s’appelait rue du Tripot, car assez mal fréquenté. Elle donné accès au Jeu de Paume. Elle longeait le fossé de la ville en dehors de l’enceinte. Elle réunissait le bas de la rue des Champs à la rue du Moulins (aujourd’hui, le bas de la rue des Champs à la rue Maxime-Pellerin.
– La venelle Dossin doit son nom à un magistrat qui avait son hôtel particulier dans cette venelle.
– La ruelle Avenel, du nom d’une vieille famille Oberquoise, aboutissait rue des Religieuses.
– La rue de la Guillonnière, qui était dénommée rue des Champs, puisqu’elle était le prolongement de la rue de ce nom, s’appela aussi rue aux Fèves.
– La venelle Jouan portait le nom de rue des Religieuses, dont elle était le prolongement.
– La rue Carnot s’appelait le rue du Grand-Monarque, elle se terminait près du ruisseau de la rue des religieuses. Par un escalier qui permettait d’accéder à la rue des Religieuses, alors baptisée rue du tripot.
– En bordure de la rivière, qui s’appelait autrefois « Rivière d’Orbec » s’élevaient de nombreux moulins.
– Le Pont de Pierre, l’un des plus ancien pont d’Orbec, assurait l’arrivée des voyageurs venant de Vimoutiers et Livarot.
L’hôpital d’Orbec.
L’hôpital d’Orbec est une très ancienne fondation charitable qui remonte au Moyen-âge. On en trouve déjà mention de sa chapelle dans le cartulaire de l’Abbaye de Friardel au XIII° siècle.
L’hôpital eut à souffrir les troubles de la guerre de Cent Ans et l’incendie qui détruisit la ville à cette époque dut anéantir aussi le viel hôpital. On fut donc obligé de le reconstruire dans la seconde moitié du XV° siècle. La chapelle ne fut reconstruite qu’au XVI° siècle. Alors que l’hôpital était sous le vocable de Saint-Rémy, la nouvelle chapelle fut dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien.
Dans le Beffroi se trouve une cloche qui fut bénie à la fin du XV° siècle. Quelques bas-reliefs de pierres sculptées, proviennent très probablement de l’ancienne chapelle; ont été encastrées dans le mur Est de la tour et l’une d’elles forme le linteau de la porte d’entrée. On remarque notamment sur ce linteau les armoiries de la famille des Planches. Dans le choeur, on pouvait admirer encore au début du siècle (20 ème) un très joli maître-autel en bois sculpté et doré qui fut remplacé aux environs de 1910. Cet autel du XVII° siècle figure parmi les objets les plus intéressant du musée d’Orbec.
On peut encore admirer, dans le choeur d’anciennes statues polychromées, placées sous des dés de pierres sculptées à même les colonnes (1959).
Le Couvent des Capucins – Chapelle du Pensionnat « Notre-Dame-d’Orbec ».
Au XVII° siècle, la famille de Melun et la famille du Merle contribuèrent à la fondation d’un couvent de capucins à Orbec.
A cet effet, ils achetèrent une auberge située en bordure du vieux chemin d’Honfleur, avec quelques vergers environnants et quelques bois et ils y établirent la communauté naissante. Bientôt s’éleva à mi-côte un vaste couvent construit dans le style Louis XIII que surmontait un petit clocheton très caractéristique de l’ordre franciscain.
Ils défrichèrent une partie du bois et ils édifièrent un monumental chemin de Croix. Enfin, à l’emplacement même de l’auberge, ils construisent leur chapelle qui comportait sur le côté une petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Consolation. La statut de la vierge était en marbre blanc.
A la Révolution le couvent des capucins fut vendu comme bien national. Mais au début du XIX° les religieuses de la congrégation de Notre-Dame de Bernay rachetèrent le vieux couvent et y installèrent leur pensionnat de jeunes filles. Elle ne purent utiliser l’ancienne chapelle, trop délabrée et elles construisirent, en bordure de la rue du Chaos, aujourd’hui (1959 *) une nouvelle chapelle en briques.
L’ancienne chapelle des Capucins fut transformée en bâtiment commun. La chapelle actuelle conserve un grand Christ de bois sculpté, polychromé, qui n’est autre que le Christ de l’ancien Calvaire, du chemin du même nom, qui fut décroché à la révolution et traîné dans la ville.
Le PRIEURE DE SAINT JOSEPH D’ORBEC. Ordre de Saint Augustin.
Chapelain. — P. Leprou
– 1216- Orbec – Traité entre Isabelle d’Orbec, mariée en seconde noce au Comte de Pembroc, et Philippe-Auguste par lequel elle s’engage à ce que ses deux enfants Guillaume et Richard ne feraient aucun dommage au royaume de France et qu’elle mettrait en la main du roi ses forteresses d’Orbec et plusieurs autres situées en Normandie = Texte signalé lors d’un procès de 1782, H.SUP. 1365. B.40 dans Armand BENET (1900), t.II, p.31
Monstres du bailliage d’Evreux
JAVELINES ET DEMYES LANCES
– Thomassin Eustasse seigneur en usufruit de la Mocte et d’Orbec, se présenta armé de3/4 de cuirasse, salade et ½ lance en sa compagnie, monté de deux chevaux.
– Denis d’Orbec, escuier, seigneur du Prey, se présenta et fu reçeu tant pour lui, Jehan d’Orbec, son père, homme fieble et ancien, que pour Pierres d’Orbec, son frère, en abillement de homme d’armes, ung archier en sa compaignie, ung gros varlet et ung paige, suffisamment montez et armés.
– Guillaume, sire de Gauville, chevalier châtelain d’Orbec qui donna quittance en cette qualité en 1377
Scellé de ses armes qui sont de gueules au chef d’argent semé d’hermines, il tenait château pour le roi Charles-le-Mauvais.
Branche de Boisandré
Louise Françoise le Cornu, mariée au Marquis du Merle, seigneur d’Orbec en Normandie, fille et 3e enfant de Nicolas le Cornu, seigneur de Boisandré, chevalier de St Louis, mort 1750, et de feue Marie Marthe de Gaillarbois.
Guy de Chaumont seigneur de Quitry, marquis d’Orbec par sa mère Louise de Bouquetot, dame d’Orbec et de Bienfaite (Et LOUISE DE BOUQUETOT, Dame d’Orbec, alliée à Henri de Chaumont-Quitry, mort âgé de quatre- vingt ans en 1678.), mourut en 1712. Il avait épousé Jeanne de Caumont de la Force dont il eut Jacques Antoine marié 1° à Françoise de la Pallu du Mesnil-Hubert et 2° à N du Fay de St Léger.
Du premier lit sont venues 5 filles et du second 2 fils et une fille.
Orbec devint le domaine de la couronne par suite de la cession qu’en fit à Charles VI Charles le Noble, roi de Navarre fils de Charles le Mauvais ( né à Evreux en 1361 et mort en Navarre) ainsi que de ses droits sur les contés de Champagne, de Brie et d’Evreux et les seigneuries d’Avranches, Pont-Audemer, Pacy, Nonnancourt, Beaumont-le-Roger, Breteuil, Mantes, Meulan etc …
(Guide de Caen L’Enault) Conches, Orbec, Pont-Audemer, le Cotentin furent données à Charles le Mauvais en échange du comté de Champagne (Le Brasseur)
Recherche des nobles de l’élection de Lisieux 1540.
NOTRE-DAME D’ORBEC.
52. Jean Baudouin, pour lui ; Me. Jacques Baudouin , vicomte d’Orbec ; Nicolas Baudouin son fils ; et maistre Hector et Guillaume , ses frères ; la veuve de Me. Guillaume le Boulenger, sa soeur, ont fourni un anoblissement, concédé par le roi Louis , le septembre 1475 , à Jean Baudouin l’ainé , leur ayeul, dont la copie est demeurée au greffe, Le procureur du Roi a requis, qu’ils vérifiassent leur descente, ou qu’ils fussent assis. V. le n°. 10.
53. Jaques Malherbe, et Denis Michel, Sr. de Bellou, pour justifier leur noblesse ancienne , ont produit un arrêt dont la copie est demeurée au greffe : le dit arrêt donné en la cour de nos seigneurs les généraux , le 3 décembre 1519, contre les asséeurs du dit Orbec, à l’entente des dits Malherbe, et Michel, et de deffunt Pierre Grieu , pour l’estat de leur noblesse ; savoir le dit Grieu , comme issu de Gilles Grieu, son ayeul, anobli par charte de l’an 1467; le dit Malherbe comme procréé de noblesse ancienne ; et le dit Michel comme fils de Guillaume Michel, anobli au moyen des francs-fiefs
54. Cyprien de Montreuil a dit être noble de toute ancienneté, dont il a baillé généalogie et produit plusieurs pièces et écritures ; et pour ce qu’elles ne sont suffisantes pour la justification d’icelle généalogie, il a obtenu lettres royaux en forme de commission à nous adressée, pour être reçu à justifier sa dite noblesse par témoins ; suivant lesquelles il a été permis faire venir témoins ; et sur ce est encore en procès vers le procureur du Roi.
55. Me. Jaques le Certavier, lieutenant particulier en la vicomté d’Orbec de Mr. le bailli d’Evreux, a déclaré ne vouloir user d’aucun privilege d’exemption et de noblesse : au moyen de quoi le procureur du Roi a requis , qu’il soit assis au profit du Roi, si assis n’avoit été aux années passées.
56. Jacques de la Mondie a été appelé sur l’article de la parroisse d’Aucainville, avec son frère, Philippin, sieur du Val-Combert, n° 22.
57. Nicolas Michel, Verdier d’Orbec, a été plusieurs fois convenu pour déclarer les causes de son éxemption : sur quoi il a répondu , qu’il n’entend jouir d’aucun privilège d’éxemption, et que depuis longtemps il étoit assis en la ville d’Evreux, dont il étoit prêt de faire apparoir ; pour quoi à son refus de ce faire, le procureur du Roi a requis icelui Michel être assis.
CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE TENUES A LISIEUX EN 1870.
Epoque mérovingienne.
M. d’Hacqueville , membre du conseil général, rend compte de la découverte d’antiquités mérovingiennes faite
dans sa terre de Launay, près Orbec, à l’occasion des travaux exécutés pour la construction du chemin de fer. Ces
travaux ont d’abord mis au jour quatre tombeaux renfermant des objets d’une importance médiocre, tels qu’un poignard en fer, un anneau de même métal et des débris de poterie grossière; mais un peu plus loin les déblais ont amené la découverte de trois tombes plus riches en objets d’une belle conservation. Il s’y est trouvé notamment un certain nombre de haches, sept à huit pointes de javelot, un vase de poterie mérovingienne, un anneau formé d’une faible lame de cuivre courbée en cercle et deux belles plaques de ceinturon.
L’abbaye de Notre-Dame de Grestain à l’ancien diocèse de Lisieux – Charles Bréard
Acquisition par l’abbaye de Notre-Dame-de-la-Victoire-lès-Senlis, de la seigneurie du Mesnil-Ferry.
On sait que Louis XI avait donné à Notre-Dame-de-la-Victoire la vicomté d’Orbec et fait d’autres largesses en argent.
CATALOGUE ANALYTIQUEDES CHARTES-DOCUMENTS HISTORIQUES-TITRES NOBILIAIRES,ETC.
– Nicole de Veires, secrétaire de M. le duc de Normande, donne quittance à Jean d’Orbec, trésorier de Normandie, de cent livres parisis, en à compte de la somme de deux cents livres qui lui étaient dues annuellement. (7 novembre 1361.)
– Amendes de la vicomté d’Orbec, taxées par Jehan LeFranc, vicomte du dit lieu, à compter au terme de Pasques, l’an de grâce 1368.
– Quittance de David d’Orbec, chevalier, seigneur dudit lieu, l’un des capitaines des nobles du ban et arrière-ban du duché de Normandie, d’une somme de 200 livres pour ses gages d’un an de la dite charge de capitaine.
– Quittance de gages donnée à Jean d’Orbec, bourgeois et changeur de Rouen, au nom de Jean le Villain, trésorier général des subsides de Normandie, par Colin Le Mestre et Robin le Vasseur, clercs des gouverneurs généraux desdits subsides. (25 mai {356).
Histoire de l’ancien Evêché-Conté de Lisieux par H. De Formeville.
– Ce fut aussi avec la permission et de l’autorité de Mgr Alleaume que le monastère des religieuses réformées de l’ordre de Saint- Augustin, d’Orbec, fut fondé en cette ville, en 1632. Le contrat de fondation est du 5 janvier de cette année, et les lettres- patentes données en confirmation , du mois d’août de l’année suivante (1633).
– Ce fut sous l’épiscopat de Mgr de Cospean, ou au commencement de celui de son successeur, que le monastère des Capucins d’Orbec fut fondé, selon Masseville, par les habitans du lieu, aidés des libéralités du vicomte de
Gand, et des sieurs du Houlley , de la Pilette et des Eteufs , lieutenans-généraux au bailliage de ce lieu.
Pierre Fouques, sieur de la Fillette. La noblesse de Pierre Fouques fut révoquée en 1664; mais estant subdélégué à Orbec de M. de Marie Intendant d’Alençon qui fut chargé de la recherche des nobles de sa généralité, cet Intendant
qui connoissoit le rare mérite de Pierre Fouques, sr de la Pilette, luy procura des lettres de confirmation de noblesse, l’an 1665… » (Bibl. Nat., ms. français, 32, 3og, p. 371.) En marge, il est noté qu’il a répondu.
Histoire de Lisieux : ville, diocèse et arrondissement. Tome 2 – M. Louis Du Bois
ORBEC. Dans Orderic Vital, Liv. VIII, Orbeccum; Orbec, dans Wace, v. 13,666. Il y a lieu de croire que ce nom vient d’ora: bord, rive, et de beccum : bec, ruisseau. En effet, cette ville est bâtie sur la rive droite de l’Orbiquet qui n’est encore qu’un ruisseau; elle est fort ancienne, et fut jadis fortifiée, mais il ne subsiste plus de son vieux château que peu de ruines, telles que des souterreins sous la rue des Champs et celle de Geôle. Dès le Xe siècle, sa vicomté était importante, et ses barons figurent dans nos guerres du moyen-âge. Gauffrid ou Geoffroi, fils naturel de
Richard I, duc de Normandie, eut pour fils Gislebert Crispin ou Crépin qui fut comte d’Eu et de Brione et seigneur du Sap; c’est de ce Gislebert que sortirent Baudouin, qui eut en partage Le Sap ainsi que Meules, et Richard qui posséda Orbec et Bienfaite dont Guillaume-le-Conquérant lui fit don et desquels il prit le nom. Cette concession fut, suivant M. Auguste Le Prévost, le dédommagement pour sa part du patrimoine aliéné pendant la minorité» de ces seigneurs.
Les services que Richard de Bienfaite rendit au roi Guillaume, notamment dans la révolte de 1073 suscitée par le comte de Hérefort et celui de Norfolk, le firent créer comte de Clare en Suffolk.
Il mourut vers 1090, probablement au château de Tonbridge où il résidait ordinairement. A la date de 1092, Orderic Vital (Liv. VIII) parle d’un Landric, vicomte d’Orbec, qu’il place en enfer sur la foi d’un cauchemar de Gauchelin,
prêtre de Bonneval-Saint-Aubin. A la fin du XIe siècle, Jean de Bienfaite, Guillaume et Jean d’Orbec figurent parmi les seigneurs qui accompagnèrent le duc Robert en Palestine. Les barons d’Orbec prirent part aux troubles qui agitèrent
et ravagèrent la Normandie de 1119 à 1124.
En 1153, Robert, comte de Mont-Fort-sur-Rîle, ayant fait prisonnier son oncle Valeran, comte de Meulan, le fit enfermer au château d’Orbec jusqu’à ce qu’il lui eût restitué le château de ce Mont-Fort dont il s’était injustement emparé. En 1154, Clémence de Bienfaite, qui épousa Robert de Mont-Fort-sur-Rîle, possédait les seigneuries d’Orbce et de Bienfaite. Vers 1200, Hyvon Hugon ou Hugues d’Orbec céda quelques droits à Guillaume-le-Maréchal (1) et à Isabelle d’Orbec, sa femme, qui en secondes noces, devint celle du comte de Pembrok. Vers 1216 peu de tems après la conquête de la Normandie par Philippe-Auguste, Isabelle traita avec ce monarque, s’engagea à lui remettre le château d’Orbec et plusieurs autres, ainsi qu’à maintenir dans le service de France ses deux fils Guillaume et Richard. En 1231, le comte de Pembrok et Isabelle, sa femme, ainsi que Jean d’Orbec, fils de Hugon dont nous avons parlé plus haut, confirmèrent
aux religieux du Bec le don du patronage de la cure d’Orbec.
(1) Guillaume Le Maréchal avait épousé Isabelle fille de Richard de Clare, comte de Pembroke. Gilbert, frère d’Isabelle, étant mort sans postérité, laissa le comté de Pembroke à sa soeur de cette manière Guillaume Le Maréchal devint, en 1189 comte de Pembroke. Guillaume Le Maréchal livra en mai 1204, le château d’Orbec à Philippe Auguste.
NOBILIAIRE DE NORMANDIE – GABRIEL O’GILVY
ANFRAY ( N. ) , d’Orbec, anobli avant 1682 , taxé, pour ce, à 40 livres.
AMIOT. 1463, MONFAUT : Jean Amiot, d’Orbec.
ANGUETIN. 1463, MONFAUT : Jean Anguetin, d’Orbec, NON TROUVÉ NOBLE ET ASSIS À LA TAILLE.
BELLEAU , Vic . d’Orbec, anobli par la charte des francs – fiefs et nouveaux acquêts de 1470, taxé à 54 livres.
LA DEPORTATION DU CLERGE ORTHODOXE PENDANT LA REVOLUTION
Bardel (Michel-Frangois), cur6 d’Orbec, Calvados, 54 ans, passeport d61ivr6 par le district de Rouen, le 5 septembre
[le 18].
Histoire Généalogique de la Maison d’Harcourt – Gilles André De La Roque
– ALIX de HARCOURT Dame de la Baronnie d’Orbec, de Friardel , du Pré, d’Orbiquet
Hugues d’Orbec époux de Alix de Harcourt fit une donation de cent sols de rente, à prendre sur son Moulin du Pré, par contrat de 1296, ce qui fut confirmé par de l’an 1296. ce qui fut confirmé par Guillaume d’Orbec, l’an 1379.
– Hyvon ou Hugues d’Orbec Chevalier , au raport des registres du Prieuré de Saint Cyr de Friardel, eut pour femme Alice ou Alix de Harcourt, lesquels sont inhumés dans le choeur de cette église. Ils eurent pour fils Jean d’Orbec.
Jean d’Orbec de Bienfaite fit sa preuue l’an 1463 sous le règne de Louis XI. de mesme en 1540. régnant François I. Louis d’Orbec Seigneur d’Orbec & de Bienfaite fit la sienne tant pour luy, comme aisné; que pour ses frères puisnés de treize degrés, se disant dcscendu de Mr Guillebert d’Orbec Comte de Briosne , Michel d’Orbec (1) , & Florent son fils baillèrent aussi en mesme temps leur Genéalogie aux Eleus de Lisieux , la commençant à Jean d’Orbec Seigneur de la Graie leur bisaieul compris en un titre de l’an 1450.
(1) S’est présenté Michel d’Orbec, pour lui et Florent son fils, demeurants en la dite parroisse, assis et cotisés au rôle d’icelle à la somme de 16 livres, dont ils ont dit être encore en procès en la cour des généraux, et que les
collecteurs et parroissiens ne les avoient pas voulu nommer comme nobles à la fin de la copie de leur rôle : et ils ont présenté une généalogie commençante à Jean d’Orbec, qu’ils ont dit être leur bisayeul, qui vivoit en 1450, et se titroit sieur de la Gasse, selon qu’il est porté par les lettres par eux montrées. Mais parce qu’ils n’ont suffisamment fourni du dit tiltre de noblesse, et de leur descente, le procureur du Roi a requis, qu’ils soyent continués, en leur assiette à somme à eux portable.État des anoblis en Normandie, de 1545 à 1661, avec un Supplément de 1398 à 1687, par l’abbé P.-F. Lebeurier.
72. L. d’an. de Nicolas Huré, sieur du Baudroit, demeurant paroisse d’Orbec, don. a Blois en janvier 1554, ver. ch. le 3 febvrier 1552, et c. le 3 décembre 1577; au 7e vol, fol. 467; finance 200 L, d’indemnité, 451. de rente.
321. L. d’an, de Nicolas des Hays, advocat à Orbec, don. a Rouen en novembre 1596, ver. ch. le 17 may 1601, et c. le 16
dud. mois et an, fol. 1.
729. Mre Michel Morin, sieur de Ressencourt, demeurant à Orbec, a esté annobly par lettres, ver. ch. le 13 decembre 1638, obtenues en septembre aud. an a Paris, registrées en la c. le 1 5 febvrier 1634. Nota qu’il y a arest en la cour par lequel led. Morin n’est prejudicié en sa qualité d’ancien noble nonobstant la veriffication.
1139. Charles des Hais, sieur du Travers et de Bonneval, demeurant a Orbec, a obtenu l. d’an. don. a Rouen en febvrier
1650, ver. ch. le 17 juin 1659, etc. le 2 may 1653.
4156. Pierre Maillot, sieur de la Rouveraye, d’Orbec, a obtenu pareilles lettres don. a Paris en avril 1655, ver. ch. le 27 juin 1659, et c. le 17 febvrier 1657.
1157. Michel Maillot, sieur de la Roustiere, d’Orbec, a obtenu pareilles lettres don. a Paris en 1652, ver. le 17 juin 1659.
4524. Pierre Fouques, sieur de la Pillette, d’Orbec, annobli l’an 4638, verifié 1665. El. de Lisieux.
Annuaire des cinq départements de la Normandie. 41. 1875.
Découverte de monnaies à Orbec.
Dans le courant du mois de novembre dernier, M. Perrine, boulanger, en faisant exécuter des travaux de réparation à une maison qu’il occupe à Orbec, rencontra sous le seuil de la porte un vase en terre grisâtre renfermant 150 monnaies du XVe siècle.
La plupart portent les effigies de Henri V d’Angleterre, de Henri VI et de Jean V, duc de Bretagne. Les pièces de Henri V et de Henri VI, doubles tournois et grands blancs, sont assez nombreuses. Il ne se trouve que deux spécimens au nom de Jean V de Bretagne. Il y a quelques années, des découvertes analogues avaient eu lieu au Torquesne et dans les terrassements opérés aux abords de l’Hospice, à Orbec. Le trésor quela pioche des ouvriers ramena au jour, en 1872, au
Torquesne, comprenait plus de 500 monnaies aux noms de Charles VI et de Henri VI. Parmi les dernières, on remarquait une pièce d’or d’une remarquable conservation.
– Découverte dans la cour d’une maison de la Grande Rue à Orbec non loin de l’hospice, d’un trésor de 300 pièces du Roi Henri VI d’Angleterre. Cette maison appartient aux héritiers d Monsieur Bizet.(Normand 31 mars 1866).
3 – Archives ShL:
– 1282 – Michel de Sameele vend à Etienne de Bienfaite, chevalier, dix livres de rente sur ses immeubles situés à Orbec. = Arch. SHL. FF 142 + IND.: LESQUIER, les plus anciens textes…, n° 3, p. 5.
Bulletins Sociétè historique de Lisieux.
Numéro 55, Décembre 2003. – Aurélie Desfrièches – Visite de la ville d’Orbec par la ShL, le 12 octobre 2003.
Numéro 78 : Deuxième semestre 2014 – Patrice Lajoye – Chroniques judisciaires dans le baillage d’Orbec.
Numéro 94 : Second semestre 2022 – Patrice Lajoye – Une complainte méconnue sur un crime familial à Orbec en 1609.
Archives SHL :
Dossier « Familles » 28 – famille d’ORBEC.
Dossier « LIEUX » dossier « Lieux M à Z » : Orbec : origine du nom, organistes, château féodal, famille Castaing, les seigneurs, l’imprimerie à Orbec.
FONDS Michel COTTIN
11 FA – 14 – Fonds Delaval. Famille Gosse, Coulibeaux, Enguerrand, Marais,
Couvent d’Orbec, Delaval.
Fonds « Manuscrits »
SECTION B B. – BAILLIAGE ET VICOMTE D’ORBEC ET ANNEXES.
409. – Transaction entre Jean Dumoncel, marchand à Orbec, et Me Charles Huet, notaire audit lieu, rendu garant de l’éviction que Dumoncel avait subie de fonds acquis par lui; 26 décembre 1760.
SECTION E A. – TITRES DE FAMILLE. ETATS DE. LA NOBLESSE.
47. – Copie d’une liste de fiefs des vicomtés de Falaise et d’Orbec, d’après les aveux existants aux archives de la Seine-Inférieure.
SECTION E E. – CONFRERIES. CHARITES.
280. – Donation d’une rente par Charles Le Petit à la confrérie de Notre Dame de la Miséricorde d’Orbec; 9 février 1658.
272.- Vente par Nicolas Le Noir à Mc Jean Leroy, lieutenant en la vicomté d’Orbec, d’une maison à Lisieux; 8 août 1647.
Section F F. – ORBEC, CANTON.
94. – Quatre pièces. Fieffé par Jean de Bienfaite, chevalier, à Raoul Petit; 30juin 1366. – Fieffe par Jean seigneur Bienfaite, écuyer, seigneur du lieu, à Jean Le Sénéchal; 11 décembre 1409. – Fieffe par Jean seigneur Bienfaite, chevalier, seigneur du lieu, à Jean Létouys; 24 avril 1416. – Délaissement par Nicolas Huet, d’Orbec, à Jean d’Orbec, écuyer, et demoiselle Marie de Bienfaite, sa femme, qui fieffent à nouveau; 27 septembre 1447.
142. – Onze pièces. Vente par Michel Samecle à Etienne de Bienfaite, chevalier, de dix livres de rente sur ses héritages à Orbec; 1282; pièce mutilée. – Fieffé par Jean de Bienfaite, chevalier, d’une maison à Orbec; 7 mars 1349. – Sentence du vicomte d’Orbec sur une demande de Jean de Bienfaite, chevalier; 4 janvier 1367. – Fieffe d’une masure par Jean de Bienfaite, écuyer; 26 juin 1409. – Deux aveux rendus à Jean d’Orbec, écuyer, seigneur de Bienfaite à cause seigneur Marie de Bienfaite, sa femme;
1454. – Vente d’une place vide à côté des fosses du manoir de Bienfaite par Jean d’Orbec, écuyer, seigneur de Bienfaite, et demoiselle Marie de Bienfaite, sa femme; 21 octobre 1444. Vidimus du 26 octobre 1457. – Aveu rendu à noble et puissant seigneur Jean d’Orbec, baron du lieu et de Bienfaite, pour une pièce de terre à Bienfaite; 18 juin 1571. – Déclaration seigneur divers biens en la franche bourgeoisie d’Orbec faite à Catherine seigneur h Hospital, une des dames d’honneur de la reine-mère, veuve de Jean d’Orbec, chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme seigneur sa chambre, seigneur d’ Orbec et Bienfaite;.‘!l octobre 1580. – Certificat d’hommage rendu pour la baronnie d’Orbec et plusieurs autres terres par Louis d’Orbec, seigneur et baron du lieu; 24 juillet 1596. -Acte concernant la collation de la cure seigneur Bienfaite : 11 mars 1662.
161. – Charte du roi Philippe le Bel érigeant la fiefferme d’Orbec en baronnie en faveur d’Etienne de Bienfaite, chevalier; 1er mars 1292: copie collationnée du 8 novembre 1630.
163. – Protestation par Guy d’Orbec pour la conservation de ses droits sur les bois de futaie de Bienfaite; 25 mars 1522.
164. – Quatre pièces. Aveux rendus aux seigneurs de la baronnie d’Orbec; 10 août 1553; 24 juillet 1580; 10 février 1596; 1er juin 1630.
165. -Arrêt du Conseil pour plusieurs habitants d’Orbec, d’où il résulte que la ville d’Orbec n’a jamais été entourée de remparts; 10 juin 1698.
181. – Vente par Robert Le Touzey à Jean Leliquerre d’une cour à Saint-Denis-du-Val d’Orbec; 25 mars 1539.
186. – Aveu rendu à noble dame Catherine de l’Hospital, veuve de Jean d’Orbec, chevalier de l’ordre du roi, seigneur et baron du lieu, Bienfaite, Beauvoir, le Plessis, le Prey, le Couldray, la Halhoudière, Lyvet et Vatiéville, tutrice seigneur ses enfants mineurs, par Jacques Jehan pour deux pièces de terre à Bienfaite; 7 août 1591.
250.- Aveu rendu à Guy de Chaumont, chevalier, marquis d’Orbec, par Georges et Adrien Le Portier, écuyers, sieurs du Saulcey, et par Mr Luc et Guillaume Hélix, pour terres à Bienfaite et Orbec, tenues de la seigneurie de Bienfaite; novembre 1697.
254.- Aveu rendu au doyen du Chapitre seigneur Lisieux, à cause de la seigneurie de la Masselinaie, par Jean- François Le Camus pour un tènement à Saint-Martin du-Val d’Orbec; juillet 1700.
257.- Deux pièces. Aveu rendu au doyen du Chapitre de Lisieux, par Nicolas de Saint-Denis, pour une ainesse située à Saint-Denis et à Saint-Martin- du-Val d’Orbec, tenue de la seigneurie de la Masselinaie; 15 décembre 1679. – Approbation dudit aveu par plusieurs tenants en cette ainesse.
258.- Deux pièces. Aveu rendu à Gabriel de Mailloc, chevalier, seigneur Chastelaine du lieu, par Jean et Louis Leliquerre, pour plusieurs pièces de terre à Saint-Denis-du-Val d’Orbec, tenues de la châtellenie seigneur Mailloc; 22 juillet 1661.-Autre aveu; 15 juin 1663.
259.-Aveu rendu à Françoise-Charlotte Le Brun, veuve du baron de Mailloc, pour une pièce seigneur terre à Saint-Denis-du-Val d’Orbec, tenue de la seigneurie seigneur Saint-Denis; février 163G. Pièce incomplète.
303. – Aveu rendu au Chapitre de Lisieux par Richard Lebrun pour terres à Saint-Martin-du-Val d’Orbec, tenues de la seigneurie de la Masselinaie; 14 mai 1639.
304. – Echange entre Jean et Nicolas Mullot de pièces de terre à Orbec et à Bienfaite; 30 octobre 1649.
307. -Vente par Jean Montoure, bourgeois d’Orbec, à Pierre Bardel, de Saint-Julien-de-Mailloc, de manoir et terres à la Chapelle-Yvon; 26 janvier 1704.
318. – Inventaire des meubles trouves au décès de demoiselle Françoise Le Camus, veuve de Louis Leliquerre, et femme de Gabriel de Bonnechose, à Saint- Martin-de-Mailloc; 2 janvier 1704.
328. – Aveu rendu à Jacques-Antoine de Chaumont, chevalier, marquis de Guitry, baron d’Orbec et Bienfaite, seigneur et patron de Tordouet, le Roncerey, la Chapelle-Yvon, baron de Lesques, etc., au nom des Pères Capucins d’Orbec pour leur maison en celte ville; 1er février 1734.
348. – Aveu rendu à Jacques-Guy-Gorges-Henri de Chaumont, marquis de Quitry, maître de camp de cavalerie, baron de Bienfaite, par Pierre Asselin, pour maisons à Orbec; 15 février 1771.
383. – Aveu rendu à Jacques-Antoine de Chaumont, marquis de Quitry, baron d’Orbec et Bienfaite, etc., par Georges Le Portier, sieur du Saussay, et autres représentants d’Yves de Fouques, sieur de la Mare et seigneur la Pillette, pour une maison à Orbec; 12 février 1734.
385. – Lettres de garde-chasse données à François Moutier par noble dame Antoinette-Catherine Le Vasseur, dame et patronne de Préaux et de la Nolard; 29 octobre 1787.
817. – Aveu rendu à haut et puissant seigneur Gabriel de Mailloc, chevalier, baron du lieu, Saint- Pierre, Saint-Martin, Saint-Denis-du-Val d’Orbec, Sallenelles, etc., par Mathieu Dumoulin pour terre à Saint-Pierre-de-Mailloc, tenue seigneur la sieurie du Buisson; 12 avril 1664.
685. – Deux pièces. Certificat d’hommage rendu au roi par Pierre-Nicolas du Moncel, écuyer, pour la seigneurie du Coudray en la vicomté d’Orbec; 8 avril 1720. – Certificat de garde-noble pour ses enfants mineurs; :23 janvier 1743.
Série J. – AFFAIRES CIVILES DEPUIS 1789.
160. – Vingt-huit pièces. Documents concernant les hospices civils de Lisieux et d’Orbec; 1808.
Fonds « Imprimés IJ »
– I J 24 : Exposition des faits, des titres et de la possession dont l’hôpital général des pauvres renfermés d’Orbec entend faire usage dans un procès contre M. Louis André Le Boullenger, seigneur du fief de Capelles-Chaumonf (fin XVIIIe siècle)
– I J 6 : Mémoire pour J.B. Davy tant en son nom que comme tuteur des enfants de J.P.A. Davy sieur de Boislaurent etc… appelant d’une sentence rendue au bailliage d’Orbec le 15 janvier 1751, contre J.B.M. Desperriers, J.B. Desperriers, et J. Desperriers Saint Mars.
Précis pour J.J. David tuteur des enfants de Davy sieur de Boislaurent contre de Bellemare Saint Cyr ; 1767. (ex n°73)
-I J 7 : Sentence rendue, le 22 juillet 1767, au bailliage d’Orbec, condamnant J.F.L. Legrip notaire à Hermival et Dubois notaire à Glos à 3 livres d’amende pour chacune des contraventions par eux commises en passant des contrats hors la limite de leur territoire et condamnation des contractants ; (ex n° 74)
I J 10 : Exposé à M. le Lieutenant général civil et criminel du bailliage d’Orbec que M. Mallet des Acres, receveur des consignations, a quitté Lisieux sans prévenir sa famille. 1779. (ex n°78)
I J 17 : sentence du bailliage d’Orbec, homologuant une transaction entre Louis-Guillaume Trinité et André et François Bautier – 1770.
II J 7 : affaire survenue à M. le Président de Coulons par l’interception de ses lettres commise sur le chemin de Lisieux à Orbec. Août 1790.
Observations pour le sieur Dumont, ex receveur général du Calvados contre le sieur Loiselière payeur au même département. 1810.
Du tiers coutumier relativement aux enfants nés de mariages contractés sur la foi de la donation coutumière (commente la loi du 17 nivôse an II)
III J 6 : Précis pour les créanciers de la faillite Piel, intimé, contre M. Lefrançois banquier à Orbec, syndic de la faillite, appelant d’un jugement rendu par le Tribunal de Lisieux en 1835.
Défense de Me Roustel, avocat à Lisieux, sur les poursuites du procureur général près de la Cour Royale de Caen.
Réponse de M. Lefrançois jeune à la lettre de M. Roustel avocat. 1835.
III J 10 : Mémoire pour Mme Delaplanche, veuve Delamare d’Orbec contre M. Lemaître d’Orbec.
I A 17 : Lettres patentes du roi, en forme d’édit par lesquelles le roi donne à Monsieur les domaines de Falaise et d’Orbec.
II A 58 : demande de la Municipalité de Lisieux pour le transfert du tribunal d’Orbec à Lisieux. 17 février 1790.
III A 18 : Représentations faites aux députés par les marchands et fabricants de frocs de Lisieux et Orbec. Comporte des indications sur le travail des frocs et tissus, l’économie lexovienne et une liste de professionnels. (S.D.)
Carnets de Charles VASSEUR
Voir : « Doy. d’Orbec.doc » ou le carnet bleu « Doyenné d’Orbec » : Orbec en 16.
16 – ORBEC (Auribecco)
Etat des gentilshommes : Messire François Duchemin escuyer, seigneur de Belleau
Arrêt du Conseil qui maintient Monsieur de François de Broglio, comte de Buchy, maréchal de France dans le droit de grosses forges et affineries en la baronnie de la Ferrières comme premier baron fossier de Normandie. (Chambre des Comptes de Normandie 1735/1736)
Insinuations:
Sous l’invocation de Notre Dame
Maître Pierre Pellerin, prêtre, curé d’Orbec 1712
Noble et Discrète personne Messire Charles de Montuchon prêtre curé d’Orbec 9 novembre 1720
Curés:
Bardel 1764/1774
Bardel 1781/1787
Description de l’église 17 octobre 1853
Description des cloches j’ai été faite en l’honneur de la Ste Trinité en juin 1700 (Jean Aubert de Lisieux m’a faite) je m’appelle le St Sacrement j’ai été bénite par Maître Michel François Bardel, curé d’Orbec en 1819 (Louis Maire et Pierre Cartenet père et fils fondeurs)
je m’appelle Notre-Dame j’ai été bénite par Maître Michel François Bardel, curé d’Orbec en 1819 (Pierre Cartenet, père et fils et Louis Maire fondeurs)
Généralités, description de la ville et de l’emplacement de l’ancien château.
Historique
Des seigneurs d’Orbec accompagnèrent le Duc Guillaume à la conquête de l’Angleterre en 1066 et
Le Duc Robert en Terre Sainte en 1099.
Guillaume et Jean d’Orbec font partie de cette dernière expédition.
Henri le Maréchal, l’un d’entre eux, fut d’un grand secours à Philippe Auguste, lorsque celui-ci conquit la Normandie en 1204.Le domaine a appartenu autrefois sous le titre de baronnie à la Maison d’Orléans. En 1353 il fut cédé à la Maison de Navarre. Par lettres patentes du mois d’avril 1777, enregistrées au Parlement de Rouen le 14 novembre suivant, Louis XVI donna à Monsieur, depuis roi sous le nom de Louis XVIII, les domaines de Falaise et d’Orbec en remplacement de St Sylvain-le-Thuin( ?) et d’Alençon en Cotentin).
Il y avait en 1791 deux communautés, celle des Capucins établie en 1746 et qui reçurent plusieurs aumônes de la Maison de. Melun qui les aidèrent à construire leur maison, et celle des Chanoinesses régulières de St Augustin sous l’invocation de St Joseph. Elles furent fondées en 1632, par Madame Claude Alexandre veuve de Jacques le Portier, écuyer, sieur de la Surière. Le 15 mai de la même année Madame Jean Alexandre de Brevet fut mise en possession de la maison en qualité de prieure perpétuelle.
Il y a également un hôpital dont on ignore l’origine. Il existait néanmoins en 1366 comme il paraît par une donation de 32 livres d’or qui lui fut faite cette année. En 1649 il est presque abandonné mais en 1654 il fut rétabli par les soins de Paul Lecesne, d’abord curé de Familly et ensuite d’Orbec, qui lui légua 200 livres de rentes, et par Monsieur Gohory, bourgeois de Paris qui lui donna par testament du 5 janvier 1656, les droits sur la marque des cuirs à Orbec, Gacé, Le Sap, Montreuil et Broglie. Il fut érigé en hôpital général en 1684.
Description de la chapelle de l’hospice
St Laurent du Boscrenoult, St Clair-des-Bois à St Paul-de Courtonne, Drucourt, St Mélain ou Ste Mélaine près d’Orbec, La Madeleine du Sap, léproseries réunies à l’hôpital d’Orbec ainsi que St Laurent-du-Grès ou de Montreuil, en 1696 ou 1697;
Sur le chemin qui conduit à l’abbaye de Friardel est une maison en pierre avec deux ailes détachées formant une cour carrée, fermée d’une grille Louis XV du côté de la rue. Cette maison du même règne est surmontée de 4 épis en plomb d’une grande beauté, dont deux portent des girouettes armoriées.
Cette maison se nomme le fief de Lorailles. Montfaut trouva noble dans la ville de Caen en 1463 un Thomas de Loraille. (10 août 1863 les girouettes ont disparu)
Une maison nommée anciennement « Loies qui couve » rue des Trois Mariés à Orbec (4 mai 1650).
Description des vieilles maisons à pans de bois
Historique.
On a découvert de 1832 à 1838 des ustensiles divers et des médailles de l’époque romaine du Haut Empire.
La voie romaine du Mans à Lillebonne la traversait. Elle fit partie du domaine ducal sous les Normands et le château dut être fondé sous le règne de Robert, père de Guillaume le Conquérant.
Vers 1030, fut détaché du domaine et donné à Ghislebert de Brionne, fils d’un fils naturel de Richard Sans Peur, avec Meulles, Cerqueux et Brionne, fief qui en était voisin.
Ghislebert non content de ces possessions, essaya mais en vain, de s’agrandir aux dépens de ses voisins les Giroie. Il mourut en 1041 au moment où il faisait une seconde tentative et ses domaines d’Orbec, Meulles et Bienfaite retournèrent au domaine du Prince.
Guillaume le Conquérant les en détacha de nouveau au profit de ses deux enfants Richard et Baudouin, Richard eut Bienfaite et Orbec, Baudouin Meulles et Le Sap.
Le deuxième des sept enfants de Richard, Roger, succéda à son père dans les seigneuries d’Orbec et Bienfaite qu’il partagea à ses deux enfants, Guillaume eut Orbec et Jehan Bienfaite. Ils moururent l’un et l’autre en 1099.
Léproserie de la Madeleine d’Orbec fondée en 1124 ou 1125, sous l’invocation de Ste Marie Madeleine par Roger Fitz Herbert, dans un petit vallon et au sud-est hors de la ville. Clémence, fille et unique héritière de Roger d’Orbec, après la mort de ses frères, épousa Robert sire de Montfort-sur-Risle, auquel elle porta en dot les terres d’Orbec et de Bienfaite.
La léproserie de St.-Mélain ou St.-Mélaine, assise près de la ville d’Orbec, ne nous est connue que par la carte du diocèse de Lisieux, dressée par l’ordre de M. de Brancas , son évêque , dans laquelle cette paroisse est particulièrement désignée sous le titre de l’aumône ou de la léproserie de St.-Mélain.
La chapelle de la léproserie de Ste-Marie-Madeleine d’Orbec, était sous le patronage des habitants de cette ville, dans le diocèse de Lisieux.
Généalogie et possesseurs de la seigneurie d’Orbec.
Jean Sans Peur passe à Orbec les 5 et 6 décembre 1201, le 15 mars 1203 et 9 novembre 1203
Le 9 octobre 1419 le Roi restitue ses biens à Pierre d’Orbec.
Messire Guillaume d’Orbec, chevalier seigneur des fiefs d’Asnières et du Val pour avoir accablé de coups de dague et de verges un nommé Auber qui était son homme se vit assigné à l’Echiquier où Auber demanda à être quitte et affranchi perpétuellement lui est ses hoirs, envers ce chevalier de l’hommage et de toutes les redevances auxquelles il était tenu envers lui. Par arrêt de l’Echiquier en date de l’an 1380 Auber fut déchargé des rentes qu’il faisait audit seigneur d’Orbec et de toutes autres redevances L’hommage, cour et usage des biens dudit Auber adjugés au Roy. En 1588 Messire Louis d’Orbec était seigneur de Watierville(en Caux) ¼ de fief de Haubert assis en chastellenye de Mortemer.
Il faut citer:
– Pierre-Victorien LOTTIN dit LOTTIN DE LAVAL, né à Orbec en 1810.
Autodidacte, il fréquente Hugo, Dumas, Delacroix, Chopin, Rossini, Berlioz. Il est l’inventeur de la méthode de moulage appelée lottinoplastie qui consiste à prendre des empreintes à l’aide de pâte de papier et de feuilles de papier, que l’on applique successivement l’une sur l’autre à l’aide de brosses.
Il est allé en mission au Sinaï, en Egypte, en Mésopotamie et Assyrie d’où il a rapporté plus de 700 moulages, d’inscriptions de bas-reliefs. Il est décédé à Méneval près de Bernay en 1903.
– CLAUDE DEBUSSY dit aussi Claude De France, est né à Saint Germain en Laye en 1862. Compositeur français il obtint le Prix de Rome en 1884. On lui doit de nombreuses mélodies, il renouvela le langage musical. Il a séjourné à Orbec où il avait pour amie Gabrielle Dupont qui habitait près de l’hôtel de Croisy où il était reçu. C’est là qu’inspiré par les jardins il aurait composé « Jardins sous la pluie ». Une plaque en rappelle le souvenir.
– PAUL BIGOT naquit à Orbec en 1870. Il devint architecte après avoir suivi l’Ecole des Beaux Arts à Paris. Il obtient le Prix de Rome en 1900. Son œuvre la plus importante fut l’Institut d’Art à Paris. Il a réalisé un plan en relief de la Rome Antique du 5e siècle. Cette maquette en plâtre de plus de 70 m2 est exposée à la Faculté de Caen. Une copie de cette maquette existe à Bruxelles au Palais du Cinquantenaire, et une 3e, propriété de la ville de Rome, évolue au fur et à mesure des nouvelles découvertes archéologiques. On lui doit de nombreux monuments aux morts : à Saint Quentin, à Mondemont dans la Marne et plus près de nous à Caen.
– RAYMOND BIGOT, son frère, est né à Orbec en 1872. C’est sa fascination pour le travail de l’ébéniste local qui, dès son jeune âge décidera de sa vocation. Il travaillera cette matière noble et vivante qu’est le bois : chêne normand, olivier, poirier, noyer et aussi le bois précieux. Il aime sa couleur son veinure, sa chair et taille directement le bois sans modelage préalable. Seules quelques lignes directrices sont tracées rapidement à la craie, préfigurant le sujet : un oiseau, un coq … à qui il donne vie. Au début ses œuvres sont réalistes, il sculpte tous les détails avec la plus grande précision. Vers la fin de sa vie ses sculptures sont épurées, plus lisses, plus modernes.
Raymond Bigot a pratiqué avec autant de talent que la sculpture, le dessin au crayon ou la cire, la gouache, le pastel, le lavis à l’encre brune, noire ou de couleur. En 1914 il se fixe à Honfleur où il sculpte le monument aux morts de 1914/18 inauguré le 11 novembre 1922.
Les fiefs de la maison d’Orbec étaient connus sous le titre de baronnie lorsque Philippe-le-Bel, par lettres-patentes de 1301, accorda à « Étienne sire de Bienfaite, pour la récompense de ses services, que toutes les choses qu’il avait en sa baronnie d’Orbec fussent tenues par un franc-fief entier de Haubert », et en 1322 donna pour apanage à Robert d’Artois- le comté de Beaumont-le-Roger, auquel il annexa sa suzeraineté sur Orbec, qualifié de baronnie appartenant à Étienne de Bienfaite.
Ces biens étant passés, par l’effet d’un mariage, dans les mains de Charles-le-Mauvais, le roi Jean lui cédaen 1352, entre autres domaines, le comté de Beaumont-le-Roger, la vicomté de Pont-Audemer avec Orbec, etc., pour les tenir à
titre de « pairie sous un échiquier, avec les mêmes prérogatives que celui de Normandie ».
En 1366, Guillaume de Gauville était châtelain d’Orbec.
La terre d’Orbec et d’autres domaines furent, en 1378, confisqués sur Charles-le-Mauvais : l’année suivante le connétable Du Guesclin s’en empara et en fit démolir les fortifications. Pour terminer leurs différens, Charles VI donna au fils de Charles-le-Mauvais le duché de Nemours en échange d’Orbec et de quelques autres fiefs.
Parmi les places que le comte de Dunois enleva aux Anglais en 1448 on cite Orbec. David, baron d’Orbec et de Bienfaite, était fils de Marie de Bienfaite qui avait épousé Jean d’Orbec : Charles VIII lui accorda, en 1495, l’extinction d’une
rente « due à son domaine et vicomté d’Orbec sur les cens de la baronnie d’Orbec ».
Louis d’Orbec, sieur de Bienfaite, bailli d’Évreux, est cité comme un des principaux chefs de la troupe protestante qui, en mai 1562, commit des dévastations dans la cathédrale de Lisieux: pillage déplorable, mais dont les chanoines, partie lésée, firent rédiger par des gens qui leur étaient dévoués le procès-verbal comme ils l’entendirent.
Il fallait qu’en 1568 la ville d’Orbec eût presque autant d’importance que celle de Lisieux, puisque la première fut, par l’édit du 28 mars, imposée à 2,000 livres lorsque la dernière l’était à 3,000 et Bernai seulement à 1,000.
La proportion est bien différente lors du Don Gratuit de 1758 : tandis que Lisieux est taxé à 9,400 livres, Orbec ne l’est qu’à 2,100.
Les assises de la vicomté d’Orbec, dans quelques circonstances d’épidémies et autres calamités, tinrent à Meules le 7 octobre 1546, à Chambrais Broglie le 27 septembre 1582, et à Lisieux en octobre 1590.
Par lettres-patentes d’avril 1777, le domaine d’Orbec, en même tems que celui de Falaise, fut accordé par échange à Monsieur comte de Provence (depuis Louis XVIII), avec les bois et les forêts qui en dépendaient.
Les chanoinesses régulières de Saint-Augustin (Hospitalières) furent fondées à Orbec par Claude Alexandre, veuve Le Portier de la Surière, qui demeurait à La Vêpière : l’acte notarié est du 5 janvier 1632. Les lettres-patentes du roi
furent accordées sur la demande de Jeanne Alexandre, religieuse à Vernon, en auguste 1633, et enregistrées au parlement de Rouen le 3 avril 1640. C’est dans l’église de ce couvent que fut inhumé, en 1633, Josias Bérault, célèbre commentateur de la Coutume de Normandie, né à L’Aigle, et qui fut un des principaux bienfaiteurs de la maison.
En avril 1682, les religieuses de la congrégation du couvent de Saint-Joseph d’Orbec, établies tant en cette ville qu’à Coquainvilliers, à Meules et à Cerqueux-la-Campagne, obtinrent du roi des lettres d’amortissement pour une acquisition
qu’elles avaient faite le 18 juin 1681.
En 1130 ou 1131, Roger d’Orbec aumôna, pour la fondation de la léproserie de la Madelène d’Orbec (l’une des seize du diocèse de Lisieux), la dîme de ses bois ainsi que de ses moulins d’Orbec et de Bienfaite; cette maladrerie fut favorisée des dons de divers seigneurs et de Henri I, roi d’Angleterre. A la fin du XVIIe siècle, ses revenus
et quelques autres des maladreries voisines furent réunis à l’hôpital d’Orbec.
Sous le titre d’Hôtel-Dieu-de-Saint-Remi, cet hospice, qui existait dès le 8 avril 1366, était presque complétement détruit en 1649 : il fut rétabli en 1654, grâces aux soins et aux libéralités de Paul Le Cesne, curé d’Orbec, et du conseiller d’état Gohory, qui légua, par son testament du 5 janvier 1656, les droits qu’il avait sur la marque
des cuirs de cette ville, de Gacé, du Sap, de Montreuil-l’Argillé, et de Chambrais-Broglie. Marguerite Le Gendre, de Lisieux, s’était empressée de s’y rendre le 8 septembre 1654 et de prendre avec zèle l’administration de la maison dont elle fut et mérita bien d’être la première supérieure.
D’après une déclaration du roi, de juin 1662, qui établissait des hôpitaux généraux, l’hospice d’Orbec fut érigé en hôpital général des Pauvres Renfermés par lettres-patentes d’octobre 1690, L’auteur (l’avocat Courtin) d’un savant mémoire imprimé en 1783 sous le titre d’Exposition des Faits, des Titres, etc., pour l’hôpital d’Orbec, remarque, p.29, que «les bourgeois furent assez mal avisés pour délibérer, le 6 janvier 1639, qu’ils ne pouvaient faire bâtir ni doter un hôpital., tandis que, 14 ans après, les mêmes bourgeois achetèrent une maison pour y établir une communauté de Capucins ».
Orbec fut favorisé de Casernes en 1712, d’une Conservation des Hypothèques en 1771, et d’un Grenier à Sel en 1787.
En 1789, cette ville avait un gouverneur, un bailliage royal composé de deux cent huit communes, dont cent huit rassortissaient à Orbec et quarante à Bernai, trois vicomtés royales, seize hautes-justices ressortissant par appel à Orbec.
Les baillages ayant été établis par Philippe-Auguste au commencement du XIIIe siècle, la vicomté d’Orbec dépendit du bailliage d’Évreux. Comme les rois de France n’étaient pas seigneurs directs d’Orbec, il n’y jouissaient que de
la justice, sa suzeraineté. Aussi, en 1789s il n’y avait dans cette ville qu’un petit nombre de maisons qui relevassent directement du roi, tandis que les autres dépendaient soit de la baronnie d’Orbec et de Bienfaite qui appartenait alors à la maison illustre des Chaumont-Quitry, soit des fiefs séparés de cette baronnie par un ancien parage appartenant à la maison Du Merle (Exposition des Faits pour l’Hôpital d’Orbec).
Ce fut en 1646 que le couvent des Capucins fut fondé à Orbec, sur la demande que plusieurs bourgeois, acquéreurs d’une maison nommée l’Image-Saint-Martin, firent d’un établissement de ces religieux mendians au Chapitre général qui,
cette année, était assemblé à Argentan; il nomma pour premier Gardien le Père Paulin de Tinchebrai, qu’il ne faut pas confondre avec le révérend Père Esprit de Tinchebrai, si justement célèbre par un sermon facétieux où l’esprit séraphique resplendit de toute la la magnificence de son éclat.
Les vicomté dépendant de ce bailliage, l’un des plus importans du royaume, étaient Le Sap, Folleville-la-Campagne, et Moyaux qui siégeait à l’Hôtellerie.
Les hautes-justices étaient celles 1° de l’évêché et comté de Lisieux; 2° du doyenné, chapitre, dignités et prébendes de la cathédrale de Lisieux; 3° d’Auquainville; 4° du Houllei (Saint-Martin); 5° de Frênes (Saint-Mard); 6° de Drucourt; 7° de Maneval; 8° de Lieurei; 9° de Gacé, qui allait par appel au bailliage d’Orbec, auquel une partie des
cas royaux appartenait, et dont l’autre dépendait du bailliage de Breteuil; 10° Échenfrei:
dans la commune du Hamel (Notre-Dame); 11° Fauguernon, qui tenait à Saint-Philbert-des-Champs; 12° les petites prébendes de Lisieux; 15° Chambrais-Broglie, seulement pour le royal, le surplus allant à Rouen; 14° La Goulafrière qui
allait par appel à Montreuil-l’Argilé; 15° Saint-Philbert-des-Champs; 16° Planes, qui, pour les cas royaux allait à Bernai. Ces cinq dernières hautes-justices étaient mixtes. ) Par l’effet de la révolution de 1789 Orbec perdit ses établissemens publics tant civils que religieux.
Le tribunal civil qui, en vertu du décret du 4 février 1790, devait y siéger, fut définitivement placé à Lisieux où il fut installé le 13 novembre de la même année. Toutefois, la ville d’Orbec avait fait tous ses efforts pour conserver cet important établissement, notamment en adressant à l’Assemblée Constituante une Pétition (imprimée trois p. in-4°) qui fut rédigée par Charles de Chaumont-Quitry, envoyé à Paris comme député d’Orbec, et par Langueneur du Long-Champ.
Le tribunal de commerce lui-même, accordé à Orbec par un décret du 14 juillet 1791, ne tarda pas à être transféré à Lisieux qui se trouva ainsi réunir les principaux établissemens du district.
La ville d’Orbec fesait un commerce assez considérable de frocs, appelés vulgairement Tordonets, parce qu’une grande partie de ces gros draps était fabriquée dans la commune de Tordouet.
Cependant il semble que ce commerce y décroissait déjà avant la révolution, puisqu’il résulte des comptes-rendus des gardes jurés de cette fabrique à l’intendant d’Alençon, qu’il fut présenté en 1785 : vingt-deux mille trois cent
seize pièces de froc, et seulement quinze mille trois cent dix-neuf en 1787.
Cartulaire Shl avec inventaires ShL et sources bibliographiques diverses du Xe siècle à 1940
Robert Ogier, prêtre, garde du scel des obligations de la vicomté d’Orbec, atteste que devant Jehan Dorbes (ou Dorlies) clerc tabellion juré, et établi en la vicomté, Guillonin Duboys prend à rente de nous Guillaume d’Orbec, chevalier, une acre de terre à courtil assise en la paroisse d’Orbec et fut Jehan Poussier aboute sur le pavement du Roy et pour 6 fers à cheval suffisants, payable chaque année à la Toussaint. L’an 1382 le 11e jour de mars. (Parchemin original sceau arraché, des archives de la Baronnie d’Orbec.)
Robert du Bosc-André, garde pour le Roy du Scel des obligations d’Orbec, certifie que devant Simon Liescenine, clerc tabellion juré en ladite vicomté, Jehan Buseveille reconnaît être tenu payé à Noble Homme Jehan de Bienfecte, écuyer, 5 sous et 4 chapons de rente, payables, la rente à la Toussaint et les chapons à Noël, sur des héritages qu’il possède à Orbec, qu’il avait eus de la vente de Robert de Valosoul, de 22… de faible ….et pour 30 sous doux. L’an 1346 le samedi après la Saint Benoît.
Robert Ogier, prêtre, garde du scel des obligations de la vicomté d’Orbec, atteste que par devant Esber Lecuer, clerc tabellion juré en ladite vicomté, Guillaume Dufrene reconnaît avoir pris en fief de Noble Homme Jean, sire de Bienfecte, chevalier, un hébergement en la paroisse d’Orbec pour 16 sols et une géline à la Toussaint.
Le 28 décembre 1369.
Jehan Gloriant, bourgeois de Bernay, garde pour le Roy notre sire, du scel des obligations de la vicomté d’Orbec, certifie que devant Pierre Lovet, clerc tabellion en ladite vicomté, Colin Maurey, de la paroisse d’Orbec, a pris à rente perpétuelle de Jehan du Couldrey, de la paroisse de Prêtreville, fils et héritier de feu Guillaume du Couldrey, une place … sise en la ville et bourgeoisie d’Orbec et aboute sur le pavement du Roy ; somme 30 sols tournois payables à la St Jean-Baptiste et à Noël. Le 24 novembre 13… Présents ad ce : Robert Delile, écuyer et Robin Dorliens, témoins.
Septembre 12….
Lettres royales écrites en latin, données par le Roi Philippe à Etienne de Bienfaite chevalier, et réglant diverses redevances dues par le seigneur au trésor royal.
5 février 148…
Lettre de présentation par N. d’Orbec, chevalier, seigneur temporel du fief, terre et sieurie du Plessys. Les bourgeois, manants et habitants de la ville d’Orbec, de Maistre Robert Aupoix, prêtre, pour remplir la cure qui à présent est vacante par la résignation et la démission de Messire Jehan … de la Maladrerie de la Magdeleine d’Orbec.
Deux feuillets concernant des fragments d’extraits collationnés des registres des comptes de la seigneurie de Beauvoir datés de 1476 et 1516.
1526 : Vente par Noble Homme Jehan Leroux seigneur d’Abenon à Noble et Puissant Messire Guy d’Orbec, seigneur dudit lieu de 20 sols de rente.
1528 : Sentence rendues assises de la Vicomté d’Orbec, tenues audit lieu en 1528 entre Messire Loys d’Orbec chevalier seigneur et baron du lieu et de Bienfaite, et Noble Homme Ollyvier de Saint Ouen, seigneur de Tordouet, héritier de défunt Ollyvier de Saint Ouen, de son vivant écuyer et seigneur et patron de Tordouet.
17 juin 1544 : Arrêt rendu entre Loys d’Orbec, seigneur et baron dudit lieu et Jehan Dandel, seigneur du Parc, où l’on trouve la mention de lettres données de Charles, Roy de France, de Sicile et de Jérusalem, le 24 juillet de l’an 1495, contenant que pour les faits dignes de rémunération faits par Guy d’Orbec chevalier à la journée de Fornoue, audit Guy donné de la main dudit Roy Charles l’ordre de Chevalerie ……….. donne audit Guy la somme de 1500 livres tournois.
Autre lettre du Roy Louis, du 15 octobre 1508, contenant qu’à la requête dudit Guy d’Orbec, le Roy ordonne établit audit lieu de Bienfaite deux marchés par semaine et deux foires par an.
2 juin 1557
Vente par Jacques Duval et Berthine, sa femme, de Tordouet, à Noble Homme Ollivier de Saint Ouen, seigneur de Tordouet et de Maigny, d’une portion d’héritage assise audit Tordouet, pour le prix et la somme de 35 sols tournois.
3 octobre 1580
Déclaration de maisons, cours et jardins assis en la noble et franche bourgeoisie d’Orbec, jouxte le lieu Presbytéral dudit Orbec et la ruelle tenant du pavement du Roy au moulin de la sieurie du Prey, baillés à Noble Dame Catherine de Lhospital, dame d’honneur de la Reine-mère, veuve de feu Messire Jehan d’Orbec, en son vivant chevalier du Roy, notre sire, et gentilhomme de sa chambre, sieur et baron dudit Orbec et de Bienfaite, le Plessis, le Prey, le Couldrey et la Halleboudière, membres dépendants de ladite baronnie, comme gardienne de ses enfants mineurs.
25 septembre 1585
Fragment d’un jugement d’adjudication des revenus des terres et seigneuries de Bienfaite, le Plessis, le Prey, le Couldrey, Beauvoir, la Halleboudière, appartenant aux enfants mineurs … de feu Messire Jehan d’Orbec, vivant chevalier de l’Ordre du Roy, seigneur et baron d’Orbec, Bienfaite, Beauvoir, la Halleboudière, et le Plessis
A la requête de Noble et Puissant Seigneur Messire René de Laval, chevalier de l’Ordre du Roy, Seigneur …. ayant la garde noble desdits enfants.
La plupart de ces seigneuries paraissent avoir été adjugées à un Sieur Duplessis, comme plus offrant et dernier enchérisseur.
La terre de Bienfaite avec maison manable, colombier, grange et étable, pressoir, jardin, étang, rivière, deux moulins avec les terres du Prey et de Couldrey, estimées 202 écus.
La terre de Beauvoir consistait en manoir sieurial, granges, étables, cours, jardins : 102 écus.
La Halleboudière, consistant en maisons, granges, étables, cours et jardins : 100 écus.
24 juillet 1596
Déclaration de prestation de foi et hommage par Messire Loys d’Orbec, baron du lieu, à raison de ladite baronnie d’Orbec, dont dépendent les fiefs, terres et seigneuries de Bienfaite, la Halleboudière, Beauvoir et de Lesperrier, leur appartenant et dépendances aussi tenus et mouvants de nous en plein fief de Haubert à cause de notre Vicomté d’Orbec.
De la terre et seigneurie de Livet, dont dépend le fief ou vavassorie de la Marchesbert ( ?) tenu et mouvant de nous de notre vicomté et chastellerie de Pont-Audemer.
Et du fief, terre et seigneurie de Vatreville et du Lion relevante et mouvante par un fief entier de la Chatellenie de Neufchastel et Mortemer-sur-Yonne
Le tout à lui appartenant succède et échoie par le décès et trépas de son défunt père.
16 décembre 1638
Vente faite par Laurent Perier demeurant en la paroisse de Bienfaite à Damoiselles Louise et J.. dites de Bouquetot, sœurs filles et héritières de feu seigneur de Brail ( ?), demeurant audit Bienfaite, absentes, stipulées et représentées par Vénérable et discrète personne Maistre Philibert Pathonyn, prêtre, curé dudit Bienfaite : D’une pièce de terre labourable avec arbres et haies dessus établis, assise à Bienfaite, village de la Barretière, bornée d’un côté la Dame baronne d’Orbec, mère d’icelles demoiselles, tenue de la vavassorie de Saint Pierre-du-Tertre exempte de toutes rentes sieuriales, subjecte en foi et hommage.
En marge est écrit : reçu par moi, Dame de Mailloc le treizième du présent contrat, fait ce 26e jour de Mai 1639.
12 octobre 1649
Jugement rendu au baillage d’Orbec dans la cause d’entre Messire Henri de Chaumont, chevalier Seigneur et baron de Lesques et autres terres, maréchal de camp des armées du Roy, ayant épousé Noble Dame Louise de Boucquetot, dame et baronne d’Orbec d’une part, et Messire Charles du Merle (1), chevalier seigneur du Plessis, d’Orbec, le Prey et Beauvoir, fils et héritier en partie de Messire Jean du Merle (2), vivant chevalier seigneur du Blancbuisson, ordonnant clausion ( ?) de pièces entre les deux parties au sujet d’un débat de tenure d’une pièce de pré, assise en la bourgeoisie d’Orbec, vulgairement appelé le Pré d’Angleterre.
(1) Charles du Merle était fils de Jean du Merle et de Louise d’Orbec, et fut maintenu de noblesse le 15 mars 1667. Il avait épousé Catherine Feydeau et eut six enfants dont le second, Pierre, forma la branche des seigneurs du Plessis. — D’interminables procès de famille, dans lesquels plus de 200,000 livres furent perdues en frais et dégrada tions amoindrirent la fortune de cette famille. (Voy. Abbé Porée, Notice sur la seigneurie et le château du Blanc-Buisson, dans Annuaire de L’association normande, Caen, 1884, in-8°, P- 499-)
(2) Jean du Merle, seigneur du Blancbuisson et du Boisbarbot, un des représentants de l’antique race des
barons du Merle-Rault connus dès le commencement du XIe siècle.
20 décembre 1649
Sentence rendue sur la contestation survenue entre Messire Charles du Merle, chevalier seigneur du Plessis, ayant repris certain procès en l’état que l’avait laissé défunt Jean du Merle (1), son père, en son vivant aussi chevalier, seigneur du Blancbuisson et du Prey, ayant épousé défunte Noble Dame Louise d’Orbec et en cette qualité mit en action Guillaume Perier pour être condamné à lui bailler aveu d’une pièce de terre en pré qu’il prétendait de la tenure dudit fief du Prey, assise en la paroisse d’Orbec, vulgairement appelé Pré d’Angleterre, lequel aveu était aussi demandé par la Dame de la Haye-du Puits, Baronne dudit Orbec, représentée par Messire Henri de Chaumont, seigneur et baron de Lecques, maréchal de camp des armées du Roy, ayant épousé Noble Dame Louise de Boucquetot, dame et baronne dudit lieu d’Orbec.
[(1) – Noble seigneur JEAN III du Merle, seigneur de Blancbuisson, du Boisbarbot, des Planches, de Bauvilliers, etc.,
lieutenant dans la compagnie des chevau-légers du comte de Grancey destinés au siége de Laon, en 1594 ; capitaine d’une compagnie de chevau-légers, par commission du 29 juillet 1622; Marié, le 24 septembre 1600, avec LOUISE D’ORBEC, fille de Jean, baron d’Orbec, et de Catherine de l’Hospital-Choisy, dont Jean, qui continue la branche de Blancbuisson, du Boisbarbot, de Bauvilliers, éteinte au XVIIIe siècle.]
Disant à tort la prétention du Sieur du Merle et adjugeant la tenure dudit héritage et ensemble la rente qu’il était sujet faire au Seigneur de Lecques, condamnant le Sieur du Merle aux dépends taxés à 45 livres pour les conseillers commissaires rapporteurs et 2 sols pour livre au greffier.
Parmi les pièces produites on remarque : une sentence des plés de la sieurie du Plessis du 3 octobre 1559, réunissant le Pré d’Angleterre à ladite sieurie du Plessis, faute d’hommage et aveu non baillé.
Des extraits des plés ….. de la sieurie du Prey, membre dépendant de celle du Plessis du 9 mai 1575, 26 juin 1577, 15 mai 1580, 7 juin 1585, 21 mai 1601, 20 mai 1604, 25 mai 1609, 9 mai 1622 et enfin 25 mai 1632, portant copie d’un contrat de vente du dernier jour de mars 1609 portant vente par Jehan le Cottonnier, de Saint Aubin de Cernay. déclaration baillée par Maître Jean le Cottonnier, prêtre, curé de Cernay, de la pièce nommée le Pré d’Angleterre à la baronnie dudit lieu d’Orbec le 16 août 1553.
22 mars 1652 : aveu baillé par Demoiselle Anne de Grieu, veuve de feu Messire Luc Morin, vivant écuyer sieur du Rocquey, conseiller, assesseur en la vicomté dudit Orbec, comme tutrice de ses enfants sous-âge à Haut et Puissant Seigneur Messire Henry de Chaumont, chevalier seigneur et baron de Lecques, maître des camps et armées du Roy, et à cause de Haute et Puissante Dame Louise de Boucquetot, son épouse, seigneur et baron d’Orbec et de Bienfaite.
18 juillet 1667 : vente par Thomas Guerard, de la paroisse de la Cressonnière, à Michel Dhomey fils Charles de la paroisse de Bienfaite, d’une pièce de terre en pré, assise en ladite paroisse de la Cressonnière bornée d’un côté le Sieur de Valliquerville, à cause de la Dame son épouse, d’autre côté la sente de la Pigeonnière, tendant à l’église dudit lieu.
Tenure de la sieurie de Cernay aux Sieurs Abbés du Bec-Hellouin, appartenant sous l’aînesse Duval et chargée de 14 livres 5 sols 7 deniers de rente envers le trésor de l’église de la Cressonnière par contrat du 31 mai 1666
21 juin 1673 : aveu rendu à Messire Guy de Chaumont (1), chevalier seigneur et baron d’Orbec, Bienfaite et autres lieux, par Demoiselle Elisabeth de Mailloc, veuve de François Morin, vivant écuyer, sieur du Bosc, tutrice de ses enfants, d’un manoir, cour et maisons, assis en la bourgeoisie d’Orbec, sujets faire au terme de Saint Rémy 6 livres de rente, 2 chapons et 2 deniers.
(1) En 1693, Gui de Chaumont, seigneur et baron d’Orbec, marié à Jeanne de Caumont-la-Force, mort en 1712, était marquis de Guitry. {Revue nobiliaire, t. XII, p. 176.)
2 septembre 1673 : constitution de 66 livres 8 deniers de rente reconnue par Maître François Flocquet, prêtre chapelain de la Charité de Saint Martin de Bienfaite et y demeurant, au profit de la Charité fondée en l’église paroissiale dudit lieu de Bienfaite, représentée et stipulée par Pierre de Launey, bourgeois d’Orbec, ci-devant échevin de la Charité.
1er décembre 1673 : procès-verbal de foi et hommage prêté à la Chambre des Comptes de Normandie par Guy de Chaumont, chevalier seigneur et baron d’Orbec, Bienfaite, Tordouet, Le Roncerey, Comte de Castet Seigneur de Paira et autres lieux, pour ladite baronnie d’Orbec à laquelle est incorporé le fief, terre et seigneurie de Bienfaite, de Tordouet duquel relève le fief et la terre de Roncerey, relevant du Roy à cause de ….Vicomté d’Orbec et à lui appartenant par avancement de succession à lui faite par Henry de Chaumont, chevalier, marquis de Lecques, lieutenant des armées du Roy, son père.
Octobre 1697 : aveu rendu à Haut et Puissant Seigneur Messire Guy de Chaumont, chevalier et marquis d’Orbec, Bienfaite, Quitry, Tordouet, Comte de Castes, Baron de Peirat et autres lieux et seigneuries, par Georges Leportier, écuyer, sieur du Saulcey, Adrian Leportier écuyer sieur du Saulcey, à cause de Dame Anne Leportier son épouse, Messire Luc Helix, diacre et Maître Guill Helix, son fils, conseiller du Roy assesseur certificateur, aux sièges de bailliage et vicomté d’Orbec, d’une pièce de terre labourable située dans la seigneurie de Bienfaite avec plusieurs maisons contenant 9 acres 1 vergée 4 perches, assise aux paroisses de Bienfaite et d’Orbec, sujet à 27 sols de rente au terme de Saint Rémy, à 10 sols à la Saint Jean ; aider à faner les prés du seigneur, reliefs, treizièmes, regard de mariage, service de prévôté, baonnier du baon du Moulin Fossard, corvées de bêtes, aides coutumières quand ils échoient et le cas s’offre.
16… : aveu rendu par Simon Thomas, demeurant en la paroisse de Bienfaite de 22 pièces de terre tenues de Messire Charles du Merle, chevalier seigneur du Blancbuisson, le Plessis, le Prey, le Coudray, Louvigny en Picardie et autres terres et seigneuries, sises en ladite sieurie du Plessis, sujettes à rentes féodales, 3 chapons, 3 boisseaux de blé avec foi et hommage, reliefs, treizièmes, corvées de bêtes gisantes sur le fief, service de prévôté, regard de mariage et 50 sols pour aider à l’aménagement des meules dudit moulin.
31 janvier 1703
Messire André Guenet écuyer, sieur de Saint Just, conseiller du Roy, lieutenant général civil et criminel au baillage de Orbec.
3 septembre 1739 : aveu rendu au Noble et Puissant Seigneur Jacques Antoine de Chaumont, par Luc Hélix écuyer, seigneur d’Haqueville, conseiller du Roy, auditeur en la Cour des Comtes Aides et Finances de Normandie, auparavant son conseiller, assesseur au bailliage et vicomté d’Orbec, fils et héritier de feu Monsieur Guillaume Helix, écuyer, conseiller du Roy, auditeur en ladite Cour des Comptes Aides et Finances de Normandie, et son conseiller honoraire audit bailliage et vicomté d’Orbec, et Georges Le Portier Ecuyer seigneur de Saint Ouen, l’un des deux cents chevau-légers de la garde ordinaire du Roy, fils héritier de feu Adrien Le Portier, écuyer, seigneur de Saint Ouen, de plusieurs pièces de terre possédées antérieurement par Luc Helix, son aïeul, Henry Helix, son bisaïeul, tous deux conseillers assesseurs audit bailliage et vicomté d’Orbec et par Guillaume Helix, son trisaïeul,, secrétaire ordinaire de Monseigneur le Prince de Condé qui représentait par acquêts Pierre Arnoult et le sieur Le Portier en tient 7 vergées 10 perches, la plus grande partie à la représentation de Dame Anne Le Portier, sa mère.
Ces diverses pièces de terre sont situées sur les seigneuries de Bienfaite, La Fontaine, Beauvoir, à charge de 112 œufs, ½ à Pâques, 2 chapons à Noël, 2 journées à aider à faner les prés, avec foi, hommage, reliefs, treizièmes, service de prévôté, regard de mariage, corvées de bêtes, aides coutumières, bâtonniers du ban du Moulin Fossard en payant ½ monte.
Michel de Mailloc écuyer, sieur de la Roussière, demeurant à Orbec 20 juin1673
Jehan et Guy Desperiers, père et fils, bourgeois d’Orbec 3 octobre 1580
Lettre de Louis XI demandant au Vicomte d’Orbec de lui fournit six paons et paonnes pour son chastel de Montils. Le 9e jour de mai 1469.
Fonds Famille COTTIN.
29 – Boîte archives: Orbec à toute vapeur, la ligne de chemin de fer Orbec-Lisieux, catalogue de l’exposition de 1983.
88 – Boite archives:
– Discours de M. Fournet, président de la société d’émulation de Lisieux au concours agricole d’Orbec 1865.
– Chemin de Fer de Lisieux à Orbec, acte de concession, Indicateur, et plans en photocopies 1870.
102 – Boîte archives: Plans du Vieux manoir d’Orbec.
VEUCLIN Essai de Bibliographie.
VEUCLIN Essai de Bibliographie 1892.
– L’Antiquaire de Bernay –
– « Bernay aux Etats Généraux tenus à Sens en 1614 » : 46 signatures, tous Bourgeois & habitants de Bernay, élection Jean Barrey à Orbec, député (3 aout 1614) – N° 15, 1er novembre 1892, p 65, 66, 67.
– Industries hospitalières du 17e siècle : la manufacture de dentelles de l’hôpital d’Orbec.
– Tabellionage de la viconté‚ d’Orbec (1714-1739-1722-1728-1791-1790).
VEUCLIN Essai de Bibliographie 1894.
L’Antiquaire de Bernay –
Jobey avocat à Orbec, Fr Lautour et Louis Lautour historiens d’Argentan, Baillage d’Orbec, Alençon (1765)
VEUCLIN Essai de Bibliographie 1895.
L’Antiquaire de Bernay –
« Les 2 Tabellionnages de Bernay » :
1er tabellionage de Montreuil, 1er registre (1388), manque (1390 à 1399) (1406 à 1439) (1441 à 1449) (1456 à 1458) (1461 à 1477) (1480 à 1495) ; (1569 à 1574), aux archives de l’Eure (1586), 72 registres notariat de Bernay brûlés de (1553 à 1588-1661-1662-1669) + 7 autres – 2e tabellionage d’Orbec, 1er registre (1500), manque (1585) (10 juillet 1714 au 8 janvier 1730), répertoire existant à partir du (28 octobre 1722) – N° 70, 15 février 1895, p 294.
L’Antiquaire de Bernay.
VEUCLIN Essai de Bibliographie- 1896. 9 et 13 mai, travaux chemin d’Orbec.
– M. de Grieu peintre (mss Lautour d’orbec).
– Magdeleine Moutier de St Remy, mort … Orbec chez son gendre ci-dessous, le 4 avril 1769 ag‚ de 84 ans.
– Marie Jacqueline Françoise Lautour, fille du prcit‚ (5 enfants) mort … Orbec, doyen des avocats du baillage, le 10 février 1778, âgé‚ d’environ 66 ans. Auteur d’un mémoire historique sur Orbec – N° 100 – 15 mai 1896 – p. 410.
– VEUCLIN V.E. – L’Antiquaire de Bernay –
« Les Prisons royales d’Orbec » :
Jean Jacques Dumont est installé … la garde des prisons royales par adjudication au rabais (24 Xbre 1734) – Un faux-saunier s’évade (1737) – Mort de Guillaume Dumont 23 ans, concierge de la prison r. (26 juin 1740) – Pierre Auguste Durand chevalier sgr de Mussy et autres lx, cr du R. en ses conseils et son procureur général au parl. de N., suivant déclaration du R. les 11 juin et 7 9bre 1724, lui ayant attribué le droit de présenter et commettre personnes capables pour garder les prisons, nomme Jean baptiste Dumont 32 ans préposé … la garde des prisons r. du baillage d’Orbec (8 aout 1747) – En plein jour évasion d’un prisonnier (27 mai 1753) – Décès de Michel Dumont (8 7bre 1757) – Il est payé 65 l. … 2 cavaliers de la maréchaussée de Montreuil ayant gardé les prisons pendant que Dumont était … Rouen (5 l. par jour et par cavalier, compris la dépense (19 avril 1758) – Dumont paye 63 l. 4 s. … Dumesnil imprimeur pour 100 ex. d’un mémoire de 7 feuilles (31 mars 1758) – Requête pour Dumont sa femme et leur guichetier contre le procureur général – Les habitants conduisent aux prisons une femme ayant perdu l’esprit, laquelle divaguait, insultait, causait des dommages aux bourgeois (25 avril 1758) – Payé 9 l. … un serrurier pour une chaine avec un fort cadenas pour enchainer la précitée, fille troublée d’entendement et furieuse (29 décembre 1758) -Dumont fait assigner les habitants et bourgeois en général, il réclame 295 l. pour la garde, gite et … de ladite fille (1763) – Délibération des habitants en état de commun : ils refusent payer parce que ladite fille n’est point de la ville (5 avril 1763) – Autre délibération confirmative (10 avril 1763) – sentence … ce sujet (22 juin 1763) – Dumont condamné … la requête d’un sr Bauquemare ; curieux mémoire de D. sur l’affaire (1764) – Un fraudeur écroué le 11 9bre dernier, s’évade en plein midi, après avoir soustrait les clefs dans les poches du vêtement du guichetier ; curieuses circonstances (a c). Poursuites … ce sujet contre Dumont, sa femme et le guichetier (28 janvier 1765) – Liste des détenus (1766) – Mémoire de D. au lieutenant général civil et criminel du baillage, sur les évasions : 2 en 1752, 1 en 1757 (21 janvier 1767) – décès de Jean Jacques Dumont (3 mars 1767) – Nø 105 – 1er octobre 1896 – p 430-431 – Répertoire du mobilier (4 mars 1767) – Requête de Gamard … l’intendant (… c) (15 7bre 1767) – Supplique de la veuve Dumont au Marèchal de Broglie ; elle est recommandée par le curé de Vire o— elle demeure et possède un petit immeuble qu’elle désire vendre, et le curé de Broglie (8 ao–t 1768) – Nouvelles suppliques au même ; le 15 février de Paris, réponse négative de la part du maréchal; ladite veuve (1782-1783) (Archives des tabeil. de Bernay) – N° 106 – 1er novembre 1896 – p.436.
– Fondation au trésor, Louise de Glatigny femme de Jehan Marmier bourgeois d’Orbec.
VEUCLIN V.E manuscrits et imprimés:
– 2 Les Organistes d’Orbec pendant les deux derniers siècles (article sans doute publié dans un journal local). manque.
– 1878, Quelques mots sur les vitraux anciens de l’église paroissiale d’Orbec
Fonds Cartes et plans.
249 – Orbec région, carte d’état-major, Armées, 1/50.000- 1
250 – Orbec, plan ancien de la ville, photocopie- 1
252 – Orbec, plan de la ville en 2 parties – 1/5.000- 1
Archives diverses de presse.
« Découvrez la champignonnière d’Orbec et ses histoires”, Le Pays d’Auge, 26 juillet 2024.
Fonds Brochures.
Br 097 Orbec, ville d’art et d’histoire LESCROART-CAZENAVE Elisabeth.
BR 366 Souvenir du vin d’honneur offert à Monsieur Georges VASSEUR 16/12/1928 G.HAMON Orbec
Fonds Seconde guerre mondiale.
Carton 08 – Orbec à l’heure allemande”, source non précisée, 2013.
FONDS DUVAL Georges 2S.
Orbec
2S313 Vieux Manoir et maisons à pans de bois (photographies) 1949-1986 Carton
Société Générale + immeuble Gouix (photographies) 1982-1984
Société Générale: bordereaux de prix 1984
Société Générale: plans 1984
Entretien des bâtiments communaux 1978
Perception: AO 1978
Perception: DG 1978-1983
2S314 Ecole Maternelle Carton
AO 1977
Soumission 1977
Bordereaux de prix 1977
Plans 1977
Dossier Général 1975-1979
Décoration 1974-1979
RV de chantier 1977-1986
Courriers 1977-1986
2S315 Hôtel des Postes et Permanence
Sociale (PTT et PS) AO 1975-1978 Boîte
2S316 Hôtel des Postes et Permanence
Sociale (PTT et PS) Boîte
Dossier Général 1976-1977
2S317 Hôtel des Postes et Permanence Boîte
Sociale (PTT et PS)RV de chantier 1976
2S318 Hôpital Boîte
Humanisation: AO 1974-1975
2S319 Hôpital Boîte
Humanisation: Bâtiments 1 à 5
(Hospice, Chaufferie, Médecine, Bureaux) 1974-1975
2S320 Hôpital Boîte
Dossier Général 1974-1979
2S321 Hôpital Boîte
Hôpital rural 1969-1974
Chapelle 1979
Immeuble sur la Touques 1972
2S322 Centre Incendie Boîte
AO 1971-1973
Dossier Général 1972-1978
2S323 Atelier de rotation Boîte
Plans E 1980
Dossier Sté Provet 1979-1986
2S324 Collège d’enseignement Général Boîte
Avant Projet 1969-1985
Marchés 1970
Plans 1970
Plans de recollement 1970
Gymnase 1969-1973
2S325 ollège d’enseignement Général Boîte
Décoration 1975-1977
Salle de Judo 1973
Ateliers 1975-1981
Travaux de sécurité 1970-1982
Grp. scolaire Filles: 4 classes
Grp. scolaire: logements instituteurs 1952
2S326 Collège d’enseignement Général Boîte
Courriers 1970-1989
2S327 Logements 106 pavillons Carton
Plans 1976-1977
Dossier Général 1975-1979
2e tranche de travaux: 20 pavillons 1976-1979
RV de chantier 1978-1979
Courriers 1977-1981
Situations 1979
40 pavillons 1976-1979
Immeuble Fortin
Fond Courel – Architecte: archives anciennes.
3S3 – Vente, 29 avril 1808: François Le Mercier(marchand, Orbec)
3S4 – 7 novembre 1809: requête du sieur Gabriel SIMON (Propriétaire, Orbec).
3S7 – 5 mars 1849: recours monsieur Eugène Duval (banquier, Orbec) contre M. Hain (marchand, Montreuil Largillé).
3S58 – Orbec: M. Jonval 1966, M. Ribourg, M. Prieur, CILCI
5 – Archives Baronnie d’Orbec:
Voir : ARCHIVES DE LA BARONNIE D’ORBEC


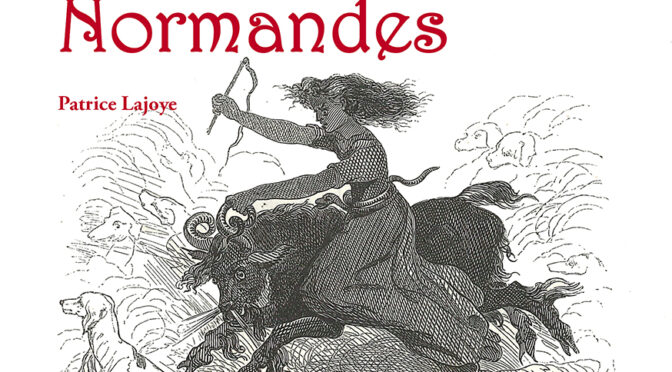
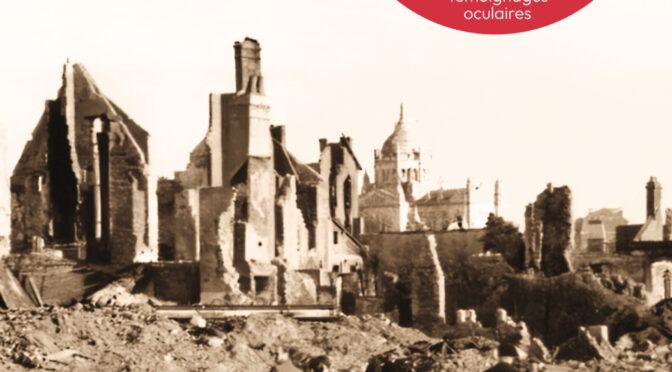
Laisser un commentaire