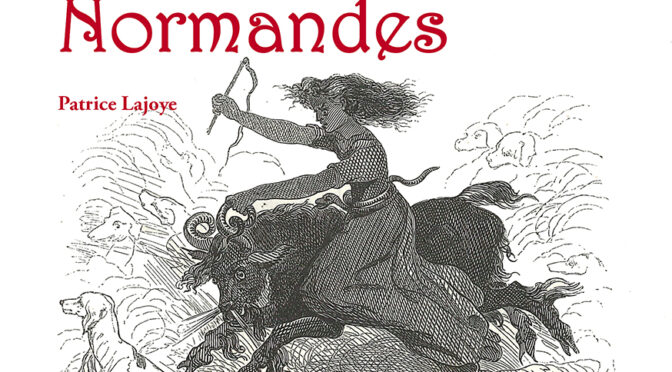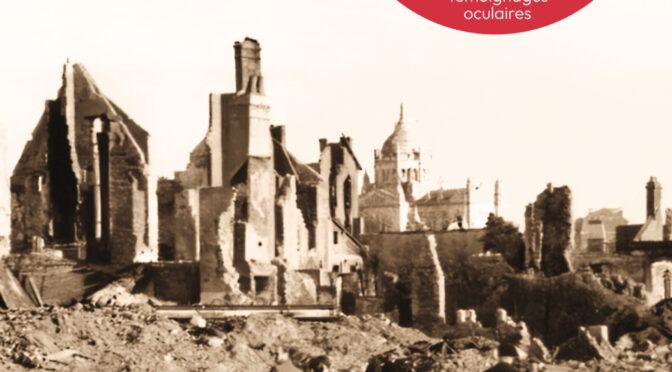Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie
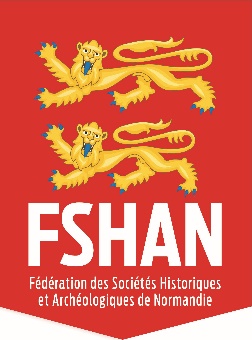
Proposition de communication et Inscription
60e congrès de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie organisé par la Fédération avec le concours des associations « La Maison de l’histoire de l’école dans la Manche » et « Les Arcades de l’histoire de Carentan ».
À Carentan-les-Marais du 8 au 11 octobre 2025Salle des fêtes, rue de la Halle. Les sociabilités en Normandie
ORIENTATIONS DE RECHERCHE.
1 -Ces orientations ont été établies par Éric SAUNIER, avec la collaboration de Georges BOTTIN, Vincent JUHEL, Edgar LEBLANC, Yves MARION, François NEVEUX, Hugues PLAIDEUX et Chantal PROCUREUR, Temple maçonnique de Carentan créé le 18 septembre 1788 qui abrita le « Coeurs-Unis » du Grand Orient de France © Claude Guillemette
2 – Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie Préambule Le thème choisi par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie pour le congrès de l’année 2025 est « Les sociabilités en Normandie ». On remarquera que le comité scientifique n’a pas précisé d’orientation autour de cette notion très vaste, érigée au rang de concept historique par Maurice Agulhon il y a près d’un demi-siècle dans un ouvrage qui fit date : La Sociabilité méridionale. Confréries et associations dans la vie collective en Provence orientale à la fin du XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, 1966. Un tel choix pourra sembler ambitieux tant la sociabilité est un « mot-valise » (Jean- Claude Kauffmann) qui englobe de multiples sujets d’études possibles. Mais en raison du rôle joué par les universités et par les chercheurs normands dans l’étude de cette notion qui a été placée sur le devant de la scène historiographique entre la fin des années 1960 et la fin des années 1980, au-delà de l’importance que revêt le « fait associatif » en Normandie ‒ que l’on accole presque par réflexe à la notion de sociabilité bien qu’il n’en soit que l’un des aspects ‒, proposer l’étude des sociabilités obligeait le comité scientifique à considérer la notion de sociabilité dans son acception la plus large, la réflexion importante développée autour de ce concept fournissant cependant des lignes directrices d’une recherche qui peuvent être enrichies par des travaux menés depuis le début des années 2000.
Confréries, salons, clubs et autres lieux de sociabilité : le fait associatif comme axe de recherche.
L’ancienneté et la densité de lieux de sociabilité dont la fonction naturelle est de provoquer la rencontre des femmes et des hommes autour d’une motivation clairement affichée, qu’elle soit professionnelle, religieuse, littéraire, savante, politique ou récréative, ont longtemps contribué et contribuent encore à faire de la sociabilité, l’un des principaux marqueurs culturels de la vie des sociétés normandes.
La richesse économique de la Normandie, qui fut l’une des plus prospères provinces du royaume de France depuis le Moyen-Âge, plus encore la forte urbanisation de cette région qui, comme l’ont montré les travaux du sociologue Max Weber il y a plus d’un siècle, ont facilité la construction du « caractère sociable » de la Normandie, font un premier objet d’études de ce congrès ces lieux de sociabilité très bien implantés dans une province qui compta trois académies (Roche, 1983) et une trentaine de loges maçonniques (Saunier, 1995). Il y a ainsi quatre villes de plus de 20 000 habitants (Rouen, Caen, Le Havre et Dieppe) au moment de la Révolution française et un nombre remarquable de villes moyennes, notamment dans la vallée de la Seine : la forte urbanisation de la Normandie au XVIIIe siècle, à la fin duquel le mot sociabilité entre d’ailleurs dans le dictionnaire de l’Académie française (1798), a donné naissance à une kyrielle de cercles littéraires et récréatifs et à divers lieux de rencontre et d’échange à caractère philanthropique, scientifique ou utilitaire qui, à côté des lieux de sociabilité traditionnels, religieux et/ou professionnel, comme les corporations, les confréries, ou les compagnonnages qui se sont très bien maintenus jusqu’à la Révolution sont des sujets d’étude importants de cet axe de recherche qui considère la sociabilité sous sa forme associative ou pré-associative.
Le « caractère sociable » de la Normandie se confirme, s’amplifie même, à partir de la Révolution française. La période révolutionnaire voit en effet émerger de nouvelles formes de sociabilités associatives. Dans ce cadre, on rappellera le fort succès que rencontrèrent les espaces de rencontre et d’échange à vocation politique. Ce succès est tel que, comme l’ont montré les travaux de Danièle Pingué et de Christine Peyrard, les sociétés populaires ont fait des départements normands, de ceux de Normandie orientale particulièrement, l’un de leurs
Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie, principaux terrains d’épanouissement. Pour cette raison, l’étude des lieux de sociabilité politique est aussi au coeur des préoccupations de ce congrès, de même que ceux qui les renouvellent au XIXe siècle, comme les cercles et les clubs, ancêtres des partis politiques.
A côté de la sociabilité politique, l’un des caractères culturels de la Normandie à partir de la Révolution a été aussi de se distinguer par la richesse de son réseau de sociétés savantes, lequel se développe surtout à partir de 1830, en réponse au goût prononcé des Normands pour l’esprit romantique et pour l’histoire. L’importance des sociétés savantes en Normandie, démontrée par les travaux de Jean-Pierre-Chaline, notamment à partir de son observatoire rouennais, fait de celles-ci un autre sujet d’étude important de ce congrès. S’agissant de ce type de sociétés, parce qu’elles sont le levier de l’organisation des congrès de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, il nous semble intéressant de préciser que leurs figures de proue, comme Arcisse de Caumont, et leur rôle dans la production de l’histoire (Charles Carbonel), donnent lieu à des propositions.
Un second axe : les thèmes permettant de définir la notion de sociabilité.
S’il manifeste le souhait de voir étudier ce lieu d’expression privilégié de la sociabilité que fut la forme associative, le congrès pourra aussi aborder celle-ci à travers les prismes thématiques variés qui ont permis de mieux la définir il y a un demi-siècle, au moment où les historiens se l’approprièrent, les chercheurs et les universités normands ayant joué un rôle important dans cette réappropriation. On rappellera ainsi que Maurice Agulhon, pionnier de l’histoire de la sociabilité, soulignait dans l’introduction de la réédition de son ouvrage de référence sur la sociabilité méridionale, la dette que les chercheurs de sa génération intéressés par la sociabilité devaient aux apports du colloque organisé à Rouen en 1983, dont a découlé l’ouvrage Sociabilité, pouvoirs et société (1987). Ce colloque a fortement contribué à fixer définitivement la définition de la sociabilité. Celle-ci est considérée comme la propension des individus à entretenir des relations choisies et réciproques pouvant être vecteurs de transformation des personnes et des groupes qui fréquentent les lieux où elle s’épanouit, ce qui la différencie de la socialité, qui ne recouvre que l’instinct naturel des hommes à vivre auprès de leurs semblables, et de la convivialité, qui renvoie à la simple coexistence harmonieuse des groupes humains. Les rencontres scientifiques et recherches qui le suivirent se sont caractérisées, dans le but de progresser dans ce travail de définition, par l’étude de nombreux sujets. Parmi ces sujets, on retiendra la motivation des hommes et des femmes à fréquenter un lieu de sociabilité précis, les rites et les fêtes destinés à faciliter la cohésion d’un groupe qui se reconnaît dans une pratique de sociabilité, les mutations entraînées sur les mentalités de ceux qui fréquentent les lieux de sociabilité. Ce sont toujours des sujets de recherches pertinents, de même que l’étude de lieux d’interaction et d’échanges humains comme la Rue et le Quartier qui donnent naissance à des sociabilités originales. L’approche de la sociabilité à partir d’un prisme générationnel (organisation de jeunesse, réunion de seniors) était aussi représentée lors de ces colloques et elle est toujours d’un intérêt évident pour le Congrès de Carentan. Lors du colloque de 1983 avait été aussi mis en évidence l’intérêt d’étudier le discours savant et les correspondances, de même que l’iconographie, pour parvenir à mieux définir la sociabilité ou à en comprendre les représentations. Toutes ces orientations sont des thèmes d’étude de la sociabilité au sujet de laquelle on rappellera que, bien que les XVIIIe et XIXe siècles soient considérés comme les deux siècles d’épanouissement principaux, nécessite d’être étudiée dans le cadre du temps long de l’histoire, de l’Antiquité jusqu’au XXIe siècle. La référence que nous avons faite plus avant à l’importance des fêtes, des rites et des rituels dans le processus de formation d’un groupe qui se reconnaît autour d’une forme de sociabilité.
4 – Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie suffit à souligner la contribution que peut apporter l’étude des sociétés antique et médiévale du point de vue de la connaissance de cette notion. S’agissant de la Rome du premier siècle de l’Empire, les travaux récents sur les célébrations des Julio-Claudiens rappellent le rôle des rituels festifs dans l’émergence d’une sociabilité à caractère politique et religieuse. Dans les sociétés antiques, on notera également que la notion de commensalité est aussi essentielle. Or, on sait qu’elle donne naissance à des phénomènes de sociabilité dans lesquels l’importance du rôle des liens de clientèle, qu’il convient de prendre en compte à côté de celui des liens familiaux, est essentielle pour aborder la question de la formation des lieux de sociabilité. S’agissant du Moyen-Âge, André Vauchez, lors du colloque de 1983, avait souligné la nécessité d’étudier la sociabilité durant cette période. Elle fut en effet le temps de développement du cénobitisme à partir du Xe siècle, puis du succès des confréries religieuses, notamment à partir du XIVe siècle qui vit aussi progresser des formes de sociabilité jugées subversives par les représentants de l’autorité mais appréciées par les sociétés de l’époque comme les carnavals et les charivaris. S’agissant du cadre chronologique, en se déplaçant de l’amont vers l’aval des deux siècles de prédilection que sont les XVIIIe et XIXe siècles pour l’étude de la sociabilité, on soulignera l’intérêt qu’il y aurait à présenter des travaux sur de nouvelles formes de sociabilité apparues dans la seconde moitié du XXe siècle, avec le développement de nouveaux loisirs, de des thèmes d’étude qui ont toute leur place dans ce congrès.
Les travaux des vingt dernières années : vers d’autres pistes de recherches.
Depuis vingt ans, la réflexion des historiens sur la notion de sociabilité occupe moins le devant de la scène historiographique qu’elle ne l’occupait dans les années 1980. Cela n’empêche pas que la sociabilité reste présente dans de nombreux travaux d’histoire sociale et culturelle, ce que l’on peut observer tant dans des recherches extérieures à la Normandie que dans les travaux régionaux. Une telle situation présente l’intérêt de donner un autre axe de recherche pour la tenue du Congrès de Carentan.
Parmi les pistes de recherches, certaines sont issues ou ont été relancées par la publication de travaux majeurs publiés dans les années 2000. C’est le cas de ceux d’Antoine Lilti sur la sociabilité des salons (2005), et de ceux de Stéphane Van Damme sur la sociabilité des savoirs et des structures d’enseignement, analysée pour Lyon à l’époque moderne dans sa thèse (2005), puis pour Paris à la suite de cette thèse.
Inscrite dans le prolongement des travaux de Daniel Roche, la thèse d’Antoine Lilti, sur la notion de sociabilité mondaine, tente d’expliquer les raisons du succès des salons qui sont sans doute les lieux de sociabilité emblématiques du siècle des Lumières. Dans cette explication, l’auteur parvient à mettre en évidence l’importance de pratiques qui ont été longtemps négligées ou jugées insignifiantes, comme le choix d’objets d’ornement, le soin donné au mobilier… mobilisés au profit de la promotion d’une culture de la Distinction. L’importance de l’envie de distinction qui est exprimée dans le choix d’un lieu ou d’un type de sociabilité, la capacité de celle-ci à faire émerger une philosophie ou une morale particulières, constituent aussi des pistes de recherches qu’il est possible d’explorer au-delà de la sociabilité des salons du XVIIIe siècle.
Nouveaux sports, avec également la montée de revendications de nouveaux groupes sociaux ou culturels. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la croissance des migrations internationales génère également d’autres formes de sociabilité dont l’étude peut venir s’ajouter à l’étude des premières associations du XIXe siècle spécialisées dans l’accueil des étrangers. Les conséquences de l’arrivée du numérique dans la vie sociale et celles de la crise du Covid, dans la mesure où elles ont donné lieu à des sociabilités nouvelles, sont également.
Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie.
Publiée la même année, la thèse de Stéphane Van Damme, Le temple de la sagesse. Savoirs, écriture et sociabilité urbaine (Lyon, XVIIe-XVIIIe siècles), à travers le prisme de l’étude du rôle des collèges de Jésuites dans la diffusion des savoirs à Lyon, a de son côté mis en avant non seulement le rôle important que peuvent jouer les structures d’enseignement dans la vie et dans les transformations des mentalités des sociétés urbaines, mais aussi leur capacité à faire naître, chez les maîtres comme chez les élèves, au sein des collèges mais aussi en dehors, dans divers lieux de la ville, des formes de sociabilité originales qui ont parfois participé au travail de construction et de transmission d’une mémoire et d’une identité urbaines. Ce constat invite à réévaluer l’étude des structures d’enseignement et des personnes qui les animent ou les fréquentent en tant que facteurs d’éclosion ou de développement de sociabilités originales. Il doit aussi incliner à réfléchir au rôle de ces personnes dans le succès d’autres formes de sociabilité, comme le montre la place occupée par les institutrices au niveau de l’action sociale et du militantisme politique entre la fin du XIXe siècle et l’entre- deux-guerres (Cl. Saunier-Le Foll).
Si des pistes sont ainsi suggérées par ces travaux qui éloignent le plus souvent de la Normandie, d’autres sont nées des apports des travaux menés dans cette région, dans le prolongement de la réflexion des années 1980. Le colloque de 1983 a été suivi par trois autres colloques sur la sociabilité, organisés à l’initiative de Françoise Thélamon (Aux sources de la puissance : sociabilité et parenté (1989), La sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges (1990), et d’Alain Leménorel (La rue, lieu de sociabilité ? 1994). Il a été aussi publié à la suite de ces colloques des travaux sur la sociabilité des Lumières et de la Révolution (la franc-maçonnerie, les sociétés populaires et la société d’Emulation -1995- 2001-) ou dans des villes importantes comme Rouen à travers le prisme de la politisation et de l’engagement social (Marec, 2001). Tous ces travaux ont permis de remarquer des aspects encore négligés au niveau de l’étude de la sociabilité, comme les sociabilités intéressées par l’idée de promouvoir les sciences et techniques ou des idées dans le domaine économique, également de prendre en compte la pluralité des motivations qui animent les femmes et les hommes qui fréquentent des lieux de sociabilité a priori intéressé par d’autres activités, comme c’est le cas pour la franc-maçonnerie.
D’autre pistes, peut-être sont-elles plus nombreuses, sont liées à l’intégration devenue systématique de la sociabilité dans les travaux des chercheurs en histoire sociale et culturelle. C’est ainsi le cas d’Alain Becchia étudiant le monde ouvrier à Elbeuf, qui a permis de mettre en lumière la diversité des sociabilités ouvrières que l’on réduit trop souvent aux seules sociabilités syndicales qu’il conviendra cependant de prendre aussi en compte lors de ce congrès au même titre que les sociabilités patronales.
Vivant loin des usines des villes de la vallée de la Seine, les travailleurs de la mer et les travailleurs portuaires, quel que soit le niveau où ils se situent dans leur hiérarchie professionnelle, offrent également de beaux sujets d’étude sur la sociabilité. Dans son ouvrage sur les marins du Havre, Nicolas Cochard a ainsi montré qu’il existait des formes de sociabilité propres au milieu maritime qui allaient au-delà de la seule sociabilité des débits de boisson et des quartiers de prostitution. Dans le monde maritime, la constitution d’une culture de l’entre-soi qui caractérise les équipages à tous les niveaux de la hiérarchie que l’on sait solide procède de multiples pratiques de sociabilité, dont l’étude pourra être étendue, en raison des apports de travaux récents, aux mondes de la pêche (Marie-Pierre Legrand) et de l’armée. On ne saurait enfin terminer la présentation des pistes de recherches que le comité scientifique souhaite voir traiter lors du congrès de Carentan, sans évoquer la nécessité d’étudier la sociabilité dans le monde rural. Outre que le concept de sociabilité a été immédiatement intégré par les spécialistes de l’histoire rurale (Antoine Follain, 1993), à travers l’étude du mode d’organisation et des pratiques sociales dans des campagnes où s’épanouissaient des sociabilités autour de la fabrique paroissiale, de l’assemblée villageoise ou de la veillée, et de la fonction de refuge que pouvaient revêtir les campagnes (on pense ici à la sociabilité des «déserts »), il est en effet d’autant plus nécessaire de prendre en compte.
6 – Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie.
L’étude des sociabilités rurales que la Normandie a été particulièrement touchée par les déstructurations sociétales provoquées par le poids des servitudes collectives et par la pression fiscale.
En conclusion des orientations précédemment définies et présentées ci-dessus, les axes de recherches suivants peuvent être ainsi formulés pour ce Congrès.
Les sociabilités intellectuelles, mondaines et culturelles. Collèges et structures éducatives diverses Sociétés savantes / Académies.
Loges maçonniques Salons et cercles littéraires.
Lieux et formes de sociabilités festive et récréative : bals, sociétés musicales, associations sportives, sociétés de jeux….
Les sociabilités professionnelles-Confréries de métier,Organisations de métiers (corporations) et syndicats Sociabilités ouvrières et patronales diverses Sociabilités militaires et maritimes.
Les sociabilités politiques et sociales, religieuses et philanthropiques,Clubs, sociétés secrètes et sociétés populaires Partis et mouvements politiques.
Sociabilités, sociétés et oeuvres d’éducation populaire Sociabilités, sociétés et oeuvres caritatives, Confréries pieuses « Sociabilités du Désert » Sociabilités mémorielles.
Les questions se rapportant directement aux religions seront réservées de préférence au congrès de Bayeux (2026) sur le thème : « Religions et croyances en Normandie ».
Sociabilités et représentations littéraires et picturales Sociabilités et discours savant Sociabilités et correspondances Sociabilité et iconographie Sociabilité et peinture. Autres formes de sociabilité.
Les sociabilités rurales.
7- Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie,Veillées, assemblées villageoises. Sociétés d’agriculture, syndicats agricoles. Les sociabilités informelles. Sociabilité de la rue et du quartier. Sociabilité des cafés et des lieux de commensalité Sociabilités amicales et familiales.
Les sociabilités du temps présent Sociabilités du numérique Sociabilité et crise sanitaire. Sociabilités et archéologie. Exemple : étude à travers les cimetières médiévaux. Bibliographie sélective (limitée à 50 titres)Approches théoriques et historiographiques générales. Agulhon Maurice, Pénitents et francs-maçons de l’ancienne Provence, Paris, Fayard, rééd. 1984. Agulhon Maurice, Le cercle dans la France bourgeoise, Paris, A. Colin, 1977. Beaurepaire Pierre-Yves, « La « fabrique » de la sociabilité », Dix-huitième siècle 2014/1 (n° 46), p. 85-105. Capdeville Valérie, Page-Jones Kimberley, La fabrique des sociabilités en Europe et dans les colonies. Espaces et identités (XVIIIe-XIXe siècles), PUM, 2023. Dang Nguyen Godefroy, Lethiais Virginie, « Impact des réseaux sociaux sur la sociabilité. Le cas de Facebook », Réseaux 2016/1 (n° 195), p. 165-195. Gailliot Antoine, Markovits Rahul, Nadeau Robin, Verlaine Julie, « (Re)Faire l’histoire de la sociabilité urbaine. Pratiques, espaces et discours », Hypothèses 2009/1 (12), p. 239-250. Lilti Antoine, Le monde des salons, Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005. Roche Daniel, Le Siècle des Lumières en province : académies et académiciens provinciaux, 1689-1789, Paris-La Haye, Mouton, 1978, 2 vol. Roche Daniel, Les Républicains des Lettres : gens de culture et Lumières au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1988.
Van Damme Stéphane, Le temple de la sagesse : savoirs, écriture et sociabilité urbaine, Lyon, XVIIe-XVIIIe siècle, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2005. Van Damme Stéphane, « La sociabilité intellectuelle. Les usages historiographiques d’une notion », Hypothèses 1998/1 (1), p. 121-132. Travaux sur la Normandie, Barzman John, Dockers, métallos, ménagères. Mouvements sociaux et cultures militantes au Havre, 1912-1913, Mont-Saint-Aignan, PURH, 1997. Becchia Alain, « La sociabilité patronale dans une ville drapière : Elbeuf (XVIIIe-XIXe siècles), Etudes normandes, 1991, p. 59-73.
8 – Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie Becchia Alain et Largesse Pierre, Sociabilité d’une ville industrielle, Bulletin de la Société de l’Histoire d’Elbeuf, septembre 1993, n° spécial. Becchia Alain, La draperie d’Elbeuf (des origines à 1870), Mont-Saint-Aignan, PUR, 2000. Bée Michel, « La croix et la bannière. Confréries, église et société en Normandie du XVIIIe siècle au début du XXe siècle », thèse de doctorat d’Etat, 1991. Bée Michel, « Dans la Normandie entre Seine et Orne : confrères et citoyens », Annales Historiques de la Révolution française, n°306, p 601-615. Boullet, Daniel « La société des Lumières à Rouen », Paris, 1969. Chaline Jean-Pierre, Les bourgeois de Rouen. Une élite urbaine au XIXe siècle, Presses de la Fondation des Sciences Politiques, Paris, 1982. Chaline Jean-Pierre, Sociabilité et érudition. Les sociétés savantes en France, XIXe-XXe siècles, Paris, CTHS, 1995. Chassagne Serge, Le coton et ses patrons (1760-1840), Paris, EHESS, 1991. Cochard Nicolas, Les marins du Havre. Gens de mer et société urbaine au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2014. Daireaux Luc, « Réduire les huguenots » : protestants et pouvoirs en Normandie sous le règne de Louis XIV : processus, acteurs, discours, thèse de doctorat de l’université de Caen Normandie, 2007. Follain Antoine, « La solidarité rurale : le public et le privé dans les communautés d’habitants en Normandie du XVe siècle à 1800 », thèse de doctorat, Université de Rouen, 1993. Follain Antoine, « Les institutions d’une paroisse sous l’Ancien Régime : Le Petit-Quevilly », Études Normandes, 1992, 41/4, p. 45-61. Goujard Philippe, Un catholicisme bien tempéré. La vie religieuse dans les paroisses rurales de Normandie, 1680-1789, Paris, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1996, Hamel Karine, « Les réseaux de sociabilité à Elbeuf : 1870-1914 : mécanismes de structuration et d’agrégation d’une société urbaine », Thèse de doctorat d’histoire, 2016.Labonne Legrand Marie-Pierre, « Vie et métier des pêcheurs de Ροrt-en-Βessin : une communauté de marins en mutation, 1792-1945 », thèse de doctorat de l’université de Caen Normandie, 2017. Legoy, Jean, Cultures havraises : 1895-1961, Saint-Etienne-du-Rouvray, EDIP, 1986. Leménorel Alain (dir.) La rue, lieu de sociabilité ? Rencontres de la rue, Actes du colloque de Rouen, 1994. Leménorel Alain (dir.), Sociabilité et cultures ouvrières, Cahiers du GRHIS, n°8, PUR, 1997. Louisfert Blandine, « La vie culturelle et intellectuelle à Alençon au temps des Lumières (1750-1789), SHAO, juin 1989, p. 29-49. Marec Yannick, Vers une République sociale ? Un itinéraire d’historien, préface de Michel Lagrave, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, coll. Histoire et patrimoines, 2009. Marec Yannick, Bienfaisance communale et protection sociale sous la Troisième République : le « système rouennais » d’assistance publique des années 1870 aux années 1920 », 2001. Perrot Annick, « Une société littorale en Cotentin au XVIIIe siècle : Saint-Vaast-la-Hougue et ses gens de mer », thèse de doctorat de l’université de Caen, 2017. Peyrard Christine, Les jacobins de l’ouest, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996. Pingué Danièle, Les mouvements jacobins en Normandie orientale. Les sociétés politiques dans l’Eure et la Seine-Inférieure, 1790-1795, Paris, CTHS, 2001. Plaideux Hugues, , « Une loge maçonnique pour la noblesse d’épée : l’« Union Militaire » de Valognes (1786-1789) », Revue de la Manche, t. 38, 1996, p. 222-232 ; « Une sociabilité portuaire : les francs-maçons de Cherbourg sous l’Ancien Régime (1758-1789) », Ports et lieux d’échange en Normandie : les pôles commerciaux et leurs arrière-pays, Louviers, Fédération des Soc. hist. et arch. de Normandie, 2021, p. 211-225 ; « Une sociabilité éclatée : les francs-maçons de Cherbourg en Révolution (1790-1798) », Les villes de Normandie :
9 – Orientations du congrès de Carentan (2025) – Les sociabilités en Normandie naissance, essor, crises et mutations, Caen, Fédération des Soc. hist. et arch. de Normandie, 2022 (Série des Congrès, vol. 27), p. 377-388.Reneau Serge, « Politiques et pratiques culturelles au Havre, 1944-1983 », Thèse de doctorat de l’I.E.Politiques de Paris, 2002.
Robinne Paul-Edouard, « Les magistrats du Parlement de Normandie à la fin du XVIIIe siècle », Paris, Thèse de l’Ecole des Chartes, 1967, 2 vol. Saunier Éric, « Etre confrère et franc-maçon à la fin du XVIIIe siècle », Annales Historiques de la Révolution française, n°306, 1996, p. 617-635. Saunier Éric, Révolution et sociabilité en Normandie au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, 6000 francs-maçons de 1740 à 1830, Rouen, Presses Universitaires de Rouen, 1999. Saunier Éric (dir.), Le Havre, les Francs-maçons et la mer, Oissel, Octopus, 2019. Saunier Éric (dir.), La franc-maçonnerie en Alençon et dans l’Orne : 250 ans de Fidélité aux libertés en pays normand, Argentan, Graph 2000, 2003. Saunier Le Foll Claire, « Femmes, pratiques associatives et action sociale en Seine- Inférieure à l’épreuve de la Grande Guerre », thèse de doctorat de l ’université de Lyon 2, 2022. Thélamon (dir.), Sociabilité, pouvoirs et société, Mont-Saint-Aignan, PUR, 1987. Thélamon Françoise (dir.) Aux sources de la puissance : sociabilité et parenté, Mont-Saint- Aignan, PUR, 1989. Thélamon Françoise (dir.), La sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges, Mont-Saint-Aignan, PUR, 1990. Vabre Nicolas, Dynamiques des organisations ouvrières et conflictualités sociales. L’exemple de Cherbourg (1890-1958), thèse de doctorat de l’université du Havre Normandie, 2017. Vadelorge Loïc, Rouen sous la IIIe République. Politiques et pratiques culturelles, Rennes, PUR, 2015. Viel Guillaume, « Sociabilité et érudition locale : les sociétés savantes du département de la Manche, du milieu du XVIIIe siècle au début du XXe siècle », Thèse de doctorat de l’université de Caen Normandie, 2017. Vincent Catherine, Des charités bien ordonnées. Les confréries normandes de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle, Paris, Ecole Normale Supérieure de jeunes filles, 1988.