NOTES sur OUILLY-du-HOULEY – 14484
OULLAYA RIBALDI ou St Martinus de Ouillera(s’écrit parfois avec 2 L à Houley)
En 1719:
– OUILLYE LA RIBAULD devint SAINT MARTIN DU HOULEY.
– SAINT LEGER D’OUILLYE devint SAINT LEGER DU HOULEY
Durant la Révolution, St-Martin du Houlley redevint Ouillye-la-Ribauld qui fusionna avec St-Léger-du-Houlley (SAINT LEGER D’OUILLIE).
L’actuelle commune d’OUILLY DU HOULEY regroupe Ouilly la Ribaude – Saint Léger du Houley – Saint Martin d’Ouillie (fusion en 1825)
OUILLY-DU-HOULLEY:
La commune actuelle de Ouilly-du-Houlley a été constituée par la réunion des communes de Ouilly-la-Ribaude et de Saint-Léger-du-Houlley, qui formaient chacune, avant 1790, une paroisse et communauté. (Ordonnance du 28 décembre 1825).
I. Dioc. de Lisieux. Baill. d’Orbec. Maitrise d’Argentan. Gr. à sel de Lisieux. Gén. et int. d’Alençon él. et subd. de Lisieux.
II. Distr. de Lisieux; canton de Moyaux (Arrêté du 1er mars 1790).
III . 4 arr . communal (Arr . de Lisieux) ; canton de Moyaux (Loi du 28 pluviose an VIII ); canton de Lisieux ( 1 section) (Arrêté du 6 brumaire an X). – Pop.: 241 hab. (1911). Sup.: 892 hect . 40 a. 75 c.
1 – Bibliographie.
2 – Pièces Justificatives.
3 – Fonds ShL.
Dictionnaire Topographique Du Département Du Calvados C. Hippeau.
OUILLY-DU-HOULLEY, canton de Lisieux (1er section).
Oilleia, Oilleya, 1180 (magni roluli, p. 14).- Oilly, 1198 (ibid. p. 174). Olleyum, v. 1215 (carte de Friardel, p. 207). Oulloe, 1620 (carte de Templeux). Oullee, Oculata, 1723 (d’Anville). Par. de Saint-Léger. Dioc. de Lisieux. Génér. d’Aiençon, élect. deLisieux, sergent. de Moyaux.
ADAMS (LES), h – AMIOTS (LES), h – AUVAGÈRE (L’), h – BELLEMARE, h. – Bois-de-Seney – BOIS-RICARD (LE), h – BRUNERIE (LA), h – BRUYÈRE-DU-BOIS-DUMONT (LA), h. – BUTTE (LA), h. – CERCLASIÈRE (LA), h. – CLIPIN, h. et min, – FILATURE-A-COTON (LA), maison – FUMICHON, min – GABELLERIE (LA), h – GOHIERS (LES), min – HOULLEY, chât. – LANDE (LA), h. – MARE (LA), h – MONT-CRIQUET (LE), h – MOULIN-BOURG (Le) – MOULIN-DU-BOURG, min – POMMERAY (LE), h. c d’Ouilly-du-Houlley. Pommerai, 1848 (Simon). – POUPLIN (LE), h – RENÉ (LA), h – RIQUETTERIE (LA), h – ROCHELLE (LA), h – TRAGINIÈRE (LA), h – VAL-HÉBERT (LE), h –
1 – BIBLIOGRAPHIE
BODIN Pierre Docteur : Les litres seigneuriales du Calvados, supplément au BSHL n°54 ou Litres Calvados.Doc
CAUMONT Arcisse de, « De Caen à Bernay. Par monts et par vaux », AAN, 30, 1864, Ouilly-du-Houlley, p. 140-143.
CAUMONT Arcisse de : Statistique monumentale du Calvados Tome III.
COTTIN Michel, Promenade d’Automne de l’Association le Pays d’Auge. Notes de visites:… Ouilly-du-Houlley, Manoir de Bellemare publiées par Armand GOHIER dans PAR, 43, N° 12, Décembre 1994, pp. 27-31, ill.
Joseph CORNU, Promenades à travers les communes rurales des environs de Lisieux, Lisieux, Emile Morière, 1938, 95 p.
Ouilly-du-Houlley, pp. 25-27.
DEVILLE Etienne, » Excursion du 27 août (1926) », AAN, 94, 1927, pp. 172-184 Ouilly-du-Houlley.
DETERVILLE Philippe :Ouilly-de-Houlley, Le Manoir de Bellemare, CDMPA, pp. 98-99
DETERVILLE Philippe, Richesse des châteaux du Pays d’Auge, Corlet, 1989.
Editions Flohic : Le Patrimoine des communes du Calvados, page 1060..
Dr Jean FOURNEE, Les deux saints Jacques en Normandie.
HANSEN Hans Jurgen, Architecture in Wood. A History of Wood Building and Its Techniques in Europe and Nord America.
Jannie MAYER, Ministère de la Culture et de la Communication Direction du Patrimoine. Catalogue des Plans et Dessins des Archives de la Commission des Monuments Historiques – Tome I.
NEUVILLE Louis RIOULT de, Le Château d’Ouillye-du-Houlley in La Normandie Monumentale et Pittoresque.
RAULT Fernand, La Révolution en Pays d’Auge et particulièrement à Ouilly-du Houlley, Communi. SHL, 29 septembre 1964.
SOULAS Jean-Jacques, Dinan. Guide de découverte des maisons à pans de bois,1986.
Henri VUAGNEUX, A travers le Pays d’Auge, Paris, Dentu, 1889, In-8°, 243 p.
2 – PIECES JUSTIFICATIVES
STATISTIQUE MONUMENTALE DU CALVADOS PAR ARCISSE DE CAUMONT.
Ouillie-du-Houliey, Oullaya Ribaldi, S. Martinus de Ouilleia.
L’église est assez importante. La nef date de la fin du XVI. siècle : elle est construite avec assez de soin. La porte s’ouvre à l’ouest. Elle est carrée, à moulures prismatiques, avec un blason derrière lequel est passée une crosse en pal.
L’appareil du mur est un damier de silex et de pierre de taille. Au-dessus de la porte est une niche, vide de sa statue. Les contreforts sont sur l’angle. Les murs latéraux n’offrent pas un intérêt égal : celui du nord est soigneusement construit en pierre de taille; il était divisé en quatre travées par des contreforts qui ont été enlevés» il serait difficile de dire pour quelle raison.
Un glacis court sur le plein des murs, au niveau de l’appui des fenêtres, qui sont au nombre de quatre.
Leur forme est ogivale, avec nervures prismatiques, à l’exception de la dernière qui est cintrée et subdivisée en deux baies géminées.
On voit aussi, de ce côté, une porte à pinacles. Au sommet de l’accolade, est un ange embrassant un écusson mutilé ; c’était probablement le support d’une statuette qui manque.
Les ouvertures du midi n’offrent aucun intérêt, si ce n’est une fenêtre carrée, entourée de moulures prismatiques, subdivisée en deux baies cintrées subtrilobées. Cette forme n’est pas commune dans le pays. Elle appartient au XVIe. siècle.
On a été obligé de reconstruire les deux murs latéraux du chœur, qui avaient perdu leur aplomb par suite de l’enlèvement des entraits de la voûte. Le chevet seul est ancien ; il est éclairé par une grande fenêtre ogivale. Le clocher est une pyramide en charpente, placée à l’extrémité occidentale.
L’intérieur contient peu d’objets dignes d’attention. La voûte du chœur est déshonorée par l’enlèvement de ses pièces principales. Celle de la nef a conservé ses six fermes de charpente apparente. Chacun des entraits est soutenu sur des consoles de pierre en forme de corbeaux. Une d’elles représente un ange soutenant un blason soigneusement bûché. Il est présumable qu’il avait sur son champ les fleurs de lis de France.
L’arc triomphal est de même époque que l’ensemble des constructions. C’est une ogive prismatique, portée par deux gros piliers semi-cylindriques.
Les deux petits autels qui sont dans la nef proviennent de l’église de St.-Léger ; ils n’ont aucune valeur artistique.
Le maître-autel est récent. Le sanctuaire est pavé en carreaux émaillés de la fabrique d’Auneuil, près Beauvais. Leur dessin est simple et de bon goût, et les combinaisons adoptées sont très-satisfaisantes. M. le Curé vient de mettre à découvert deux des blasons de la litre funèbre.
Du Houlley : d’azur à 3 étoiles d’or, la première à 5 pointes, la deuxième à 6 et la troisième à 7.
Cette église est dédiée à saint Martin.
Les pouillés lui donnent pour patrons : au XIVe. Siècle, R. de Brucourt, seigneur temporel du lieu ; au XVI ». siècle, l’abbé de St.-Laumer, de Blois, et au XVIIIe. siècle, l évêque de Blois.
Château.
— Le château offre un très-grand intérêt. Il est construit sur la croupe d’un mamelon assez élevé, et sa masse carrée, vue des coteaux voisins, est fort imposante.
Le plan que voici et les dessins de M. Bouet permettront d’abréger la description Évidemment toutes ces constructions ne sont point d’une seule époque. Les parties les plus anciennes, qui datent de l’époque gothique, sont, à l’extérieur, les tours circulaires qui occupent l’angle nord-ouest, le bâtiment qui leur sert de courtine vers le nord, et les autres tourelles circulaires qui défendaient l’angle nord-est, ainsi que toutes les parties basses du mur qui les sépare; le long mur plein qui regarde le levant, et, on peut le présumer, toutes les parties inférieures du reste de l’enceinte. A l’intérieur de la cour, une seule partie est bien caractérisée, c’est la tourelle octogone terminée par le campanile de l’horloge et les bâtiments adjacents, à droite et à gauche. On peut en juger par le dessin.
Le reste accuse, dans son ensemble, la fin du XVIe. siècle ou le commencement du XVIIe. ; en un mot, le règne d’Henri IV. La chapelle, qui est maintenant détruite, devait dater aussi à peu près de cette époque.
Les matériaux employés sont la pierre de taille et même le moellon pour les parties anciennes ; la pierre et la brique pour les autres parties. L’étage supérieur du bâtiment, qui se trouve entre le pavillon d’entrée et le grand escalier, est en pans de bois.
Les constructions de l’est sont occupées par des écuries et des communs; elles ne sont élevées que d’un rez-de-chaussée avec greniers. Il n’y a, vers l’extérieur, d’autres ouvertures qu’une série de meurtrières qui correspondent aux greniers.
Les appartements d’habitation sont situés dans le bâtiment parallèle. La grande porte d’entrée est pratiquée dans un pavillon élevé, qui fait partie de la seconde époque, dont voici l’aspect extérieur ( Voir le dessin page suivante ).
L’accès consistait en deux ponts-levis jetés sur les fossés : l’un conduisait à la grande porte, l’autre à la poterne qui accédait dans le corps-de-garde. Il n’y a aucune autre porte que celle de ce corps-de-garde dans le couloir qui, de la grande porte, mène à la cour intérieure. L’escalier qui conduit à la grande salle de l’étage supérieur, d’où l’on devait manœuvrer les chaînes des ponts, s’ouvre- immédiatement sur la cour. De l’autre côté est un appartement avec une cheminée, peut-être la cuisine de la garnison.
La chapelle s’appuyait contre ce pavillon d’entrée, et son chevet faisait saillie dans la cour (1). Elle n’était donc point orientée »; mais sa disposition contribuait encore aux moyens de défense, en permettant de tirer des fenêtres sur le flanc gauche des assaillants, qui, les portes rompues, se seraient précipités dans la cour. Le bâtiment en bois dont nous avons parlé n’est guère, jusqu’à l’angle des grands logis, qu’une galerie conduisant à la tribune de la chapelle. Le bas est ouvert et servait de remises pour les équipages de guerre ou de voyage. Le châtelain et sa suite assistaient aux offices dans la tribune ; la chapelle était petite et une foule nombreuse n’aurait pu y trouver place.
Le rez-de-chaussée du corps d’habitation ne comprenait que deux grandes salles. La principale avait, sur le manteau de sa vaste cheminée, une peinture fort détériorée, qui paraissait représenter le Jugement de Pâris. Elle est maintenant presque indéchiffrable. On accède à l’étage supérieur par deux escaliers principaux : le grand escalier en pierre à rampes droites et un escalier à vis qui remplit la tourelle octogone.
Un escalier de service est contenu dans une des petites tourelles de l’angle, et un autre conduit au pavillon de l’angle opposé. La disposition de ces appartements a été sensiblement modifiée sous le règne de Louis XIV. A gauche du grand escalier, on trouve diverses chambres et boudoirs.
Dans la chambre qui remplit le pavillon d’angle, on doit remarquer les pavés émaillés qui garnissent le contrecoeur de la cheminée. Leur dessin est fort bon, et leurs vives couleurs flattent l’oeil bien mieux que les marbres ou les carreaux blancs qu’il est de mode d’employer aujourd’hui.
Ils proviennent des fabriques du Pré d’auge et de Manerbe, dont les fours n’ont été éteints que par la Révolution. La plaque de fonte porte des armoiries. Deux lions servent de support à l’écu qui est sommé d’un casque à lambrequins, – taré de face. Le champ de l’écu est parti : au 1 er., trois étoiles ; au 2e., une croix, avec peut-être quatre pièces aux cantons.
Le premier ne laisse pas de doute: ce sont les armoiries de la famille du Houlley, que nous avons déjà trouvées à l’église.
L’appartement précédent était encore dernièrement tapissé de cuirs gaufrés et dorés, d’un dessin remarquable, et qui étaient loin d’avoir perdu leur éclat.
A droite du grand escalier, on entrait dans un vaste salon dont la décoration paraît n’avoir jamais été terminée. Ensuite se trouvait la salle à manger ; elle était aussi très-vaste, mais de forme irrégulière. On l’avait placée dans les deux tourelles circulaires de l’angle. Sa disposition était assez heureuse.
Ses murs étaient lambrissés, avec sujets peints sur les panneaux. Dans un des angles se trouve encore un lavabo en marbre. Dans les bâtiments du retour, on ne trouvait que de petits appartements.
Le plus ancien des seigneurs d’Ouillie dont le nom soit conservé est Martin d’Ouillie, qui figure dans les rôles de l’Échiquier de Normandie à la date de 1180 : Martinus de Oilleia 10 solid. pro duello Lexov.
Depuis cette époque jusqu’à la fin du XVe. siècle, je n’ai pu découvrir les noms d’aucun seigneur d’Ouillie. Le registre de Philippe-Auguste n’en fait pas mention. En 1464, Philippe Le Veneur, baron de Tillières, fit partage de la seigneurie d’Ouillé-le-Ribaut avec Philippe de Manneville et Catherine Le Baveux, veuve de Louvel-L’Estandart.
Philippe Le Veneur avait épousé, en 1450, Marie Blosset, fille de Guillaume Blosset, seigneur de Carrouges et de Marguerite de Malestroit.
Il avait une part d’hérédité dans la terre d’Ouillie, parce que Jean, son père, seigneur du Homme, qui fut tué à Azincourt, en 1415, avait épousé Jeanne Le Baveux, fille de Robert Le Baveux, baron de Tillières et d’Agnès Paynel. C’était une héritière.
Je suis porté à croire pourtant, sans en avoir de preuve, que la terre d’Ouillie venait des Paynel, qui possédèrent beaucoup de terres de ce côté.
C’est Philippe de Manneville qui resta en possession d’Ouillie.
Monseigneur Jehan de Manneville, sans doute son fils, chevalier, seigneur et baron d’Ouillieet d’un fief assis à Lieuray, nommé Tillière, n’ayant point comparu aux montres de la noblesse du bailliage d’Évreux ordonnées par Louis XI en 1469, ses fiefs furent « prins et mis en la main du Roy…« sous laquelle ils seront regis et couvergnez jusques à ce qu’il « ait fait apparoir comme et du lieu ou il s’estoit présenté. »
( Voyez les Monstres du bailliage d’Évreux, publiées par M. Bonnin, p. 43. ).
En 1540, René de Maintenon était seigneur et baron d’Ouillie. Pour justifier sa noblesse devant les élus de Lisieux, il produisit « plusieurs lettres et écritures, la première desquelles est une grande lettre en parchemin en forme de rôle commençante le lundi 24 juin 1409, sous le nom de Étienne Loresse, escuyer de l’écurie du Roy, duquel il a dit fournir être descendu par plusieurs lettres et écritures. Et si a fourni comme la différence du nom de Loresse à celui de Maintenon venoit de ce que MC. Jean Costereau thésorier de France, possesseur de leur chatellénie de Maintenon, qui avoit appartenu aux prédécesseurs dadit baron, avoit voulu usurper les noms et armes dudit Maintenoïi, à laquelle usurpation s’étoit opposé ledit baron, jouxte ce que contient l’acte d’opposition.
Recherche des Élus de Lisieux, publiée par M. de La Roque, p. 30-31. )
Gaston de Maintenon, baron d’Ouillie-la-Ribaude, épousa, en 1551, Marguerite de Nollent, la dernière des quatre filles de Florent de Nollent, seigneur de St.-Contest, et de Louise de Chançaux Le Breton. (Lachesnaye des Bois, t. XI, art. NOLLENT.)
Dès le commencement du XVIIe. siècle, la baronnie d’Ouillie est dans les mains de la famille de Longchamp, issue de la paroisse de St.-Léger, dont plusieurs membres furent gouverneurs de la ville de Lisieux au XVIe. siècle.
Dans la transaction déjà citée, faite avec le receveur de Charles de Clercy, écuyer, sieur de Mortemer et des Lonverets, relativement à des droits de treizièmes à prélever sur des terres situées à Moyaux, messire Jehan de Longchamp prend les qualifications suivantes : « chevallier de l’ordre du Roy, conseiller en ses Conseils d’Estat et privé, gouverneur de la ville de Lisieulx, baron et chastellain d’Ouillie, seigneur de Fumichon, Baudet, La Lande, Baratte et autres qualités et sieuries. » Il avait épousé noble dame Jehanne Dumoulin, qui mourut vers 1614; car, le 27 août de cette année, ses biens furent partagés par François Lambert d’Herbigny, d’une part ; Nicolas, Jean et Louis de Bigars, d’une autre part, et enfin par Abraham de Combault, héritiers chacun pour un tiers. (Titres originaux aux archives de l’Hospice de Lisieux.)
Jehan de Longchamp ne laissa point d’héritiers mâles, et sa fortune fut partagée entre Louis de Rabodanges et César
d’Oraison, qui avaient épousé ses deux filles. La femme du marquis de Rabodanges eut Fumichon; celle du sieur d’Oraison, Ouillie. C’est ce qui résulte de protocoles d’actes où l’on voit figurer : « haut et puissant seigneur messire Louis de Rabodenge, chevallier, marquis de Crévecceur et baron de Fumichon (27 septembre 1650 ); messire César d’Oraison, chevallier, marquis de Livarot, baron et chastellain d’Ouillie, seigneur du Mesnil-Godemén et plusieurs autres terres, soubz-lieutenant des gendarmes bourguignons, gouverneur, pour le service de Sa Majesté, de la ville de Lisieux ( 1637-1672-1683 ). »
César d’Oraison fit sa résidence ordinaire au château d’Ouillie. Il y produisit dans la recherche de la noblesse de 1666. On y lit :
« Ouillie. — Cezar d’Oraison, chastelain de Livarot, ancien noble. »
Adrien du Houlley (1659 – 1734) ✕ (1698) Marie de Loynes (1674 – 1726) dont:
1° Jean,
2° Adélaïde Rosalie Thérèse
3° Louis Sophie
4° Jean (1712 – 1759), baron de Saint-Martin du Houlley ✕ (1741) Jeanne Anne Herment, baronne de Fumichon
5° Anne Renée Cécile (1743 – 1805), dame du Houlley ✕ (1764) Daniel de Loynes (1732 – 1802), chevalier, seigneur de Mazères
Il laissa postérité. Néanmoins la baronnie d’Ouillie ne tarda pas à passer, par acquêt, à la famille du Houlley, qui lui a laissé son nom. Messire Alexandre-François-Pierre du Houlley, chevalier, seigneur, baron, châtelain et haut-justicier du Houlley, seigneur, baron et patron de Fumichon, Firfol, La Lande, Baudet, Barole, Thillières et autres lieux, mourut entre 1785 et 1787, laissant pour seule héritière sa soeur , noble dame Anne-Renée-Cécile du Houlley, épouse de messire Daniel de Loynes, chevalier, seigneur de Mazères et autres lieux, chevalier de l’ordre royal et militaire de St.-Louis, demeurant ordinairement à Orléans.
M. de Mazères possédait encore ces terres au moment de la Révolution. Me. Baguenault, qui a épousé Mme. Adélaïde-Zoé de Loynes du Houlley, nièce de M. de Mazères, vient d’aliéner la terre et le château.
La baronnie d’Ouillie, qui se composait de quatre fiefs de haubert et avait une haute-justice, s’étendait sur les paroisses de Moyaux, d’Hermival et autres environnantes. Au moment de la Révolution, elle valait, en rentes et redevances féodales et en fermages de terres non fieffées, environ 80,000 fr. de rente.
Le Houlley faisait partie du doyenné et de la sergenterie de Moyaux. On y comptait 45 feux, environ 225 habitants.
Comme on y a réuni la paroisse de St-Léger, dont nous parlerons tout à l’heure, et qui comptait 63 feux ou 315 habitants, on devrait, en totalisant, trouver une population de 540 âmes. Les états officiels n’en accusent que 436. Là, comme presque partout, la diminution est sensible.
(1) Cette chapelle (au château du Houlley), sous l’invocation de saint (Jean ?) Jacques et de saint Philippe, était un bénéfice dont le titulaire était présenté par le baron d’Ouillie. Chapelain L.-C. du Faguet des Varennes
Inventaire historique des actes transcrits aux insinuations – PIEL (abbé).
008. — Le 28 février 1709, la nomination à la chapelle du château d’Ouillye, sous le titre de St-Jacques et St-Philippe, appartenant au seigr baron d’Ouillye; Mesre Adrien du Houlley, chever, seigr baron, châtelain et haut-justicier d’Ouillye, seigr de Firfol et de la Lande, conser. du roy en sa cour des aides de Paris, nomme à lad. chapelle, vacante par la mort de Me Louis Gaillard, pbrë, curé de St-Jean-de-Livet et dernier titulaire, la personne de Mesre Nicolas du Houlley, pbrë et docteur de Sorbonne. Fait au château d’Ouillye les jour et an ci-dessus.
(Il y a un acte de collation donnée à Paris par le seigr évêque, le 16 février, aud. sr du Houlley, et qui par conséquent est antérieur à l’acte de présentation. Il y a aussi une procuration donnée par le même sr du Houlley, le 15 février, pour prendre possession de lad. chapelle. Aussi nous trouvons deux nouveaux actes, une collation et une procuration postérieures à la présentation).
Le 9 mars 1709, le seigr évêque donne à Me Nicolas du Houlley d’Anfernet, pbrë de ce diocèse, la collation de la chapelle du château d’Ouillye. Le 8 mars 1709, led. sr du Houlley, pbrë, M6 ès-arts en l’Université de Paris, docteur de Sorbonne, demeurant à Paris, au séminaire des Bons-Enfants, rue St-Victor, avait donné sa procuration pour prendre
possession dud. bénéfice et administrer les revenus qui en dépendent.
75. — Le 22 juin 1709, Mre Nicolas du Houlley, pbre, Me ès-arts en l’Université de Paris, docteur de Sorbonne, demeurant à Paris au séminaire des Bons-Enfants, pourvu de la chapelle du château d’Ouillye, fondée en l’honneur de St-Jacques et St-Philippe, parr. de St-Martin-d’Ouillye, et représenté par Mre Louis du Houlley, pbre, curé du
Torquesne, prend possession de lad. chapelle, en présence de Me Louis Hébert, greffier de la haute-justice d’Ouillye, et plusieurs autres témoins.
SAINT-MARTIN-D’OUILLIE PUIS SAINT-MARTIN-DU-HOULLEY. (vers 1711)
Curés. — F. Ricquier – A. Ricquier — L. Bourlet — F. Maillet — J.-B. Lechantre —J.-B. Lebrun.
Clercs. — J. Buquet — J.-B. Pastey.
Patron. — L’abbé de Saint-Laumer — J.-F.-P. Lefesvre de Caumartin — L’évêque de Lx, sede vacante — Les religieux de Saint-Laumer.
Notable. — L. Hébert.
Chapelle Saint-Jacques et Saint-Philippe. (Au château du Houlley). — Chapelain. — N. du Houlley.
SAINT-MARTIN-D’OUILLIE PUIS SAINT-MARTIN-DU-HOULLEY (vers 1719).
Curés. — J. Goubey — G. Caboulet — G. Lemonnier — R. Desperroys — F. Ricquier.
Prêtre de la paroisse. — G. Pastey.
Clercs. — G. Pastey — R. Pastey.
Patron. — L’abbé de Saint Laumer de Blois.
Seigneur et notable. — P. de Guerpel.
Chapelle Saint Jacques et Saint Philippe (au château d’Ouillye). —
Chapelains. — L. Gaillard, VIII. 668. — N. du Houlley —
Patron. — Le seigneur du lieu. — A. du Houlley.
543. — « A Blois, le 20 juillet (1711).—Je ne demande pas mieux, Monsieur, que de prnter à Monsieur de Lisieux por vrë parr, de St-Martin d’Ouillie un sujet capable d’y continuer tout le bien que le deffunt curé y a fait et les bons exemples qu’il y a donnés pendant sa vie; et je ne croy pas pouvoir prendre de meilleur party pour cela que de m’en rapporter au choix qu’en fera Monsr l’évesque ou messrs ses grands vicaires à votre sollicitation. Ce sera donc à vous, Monsr, à ménager la chose auprès d’eux, en sorte qu’on ne soit point prévenu en cour de Rome. Car ce n’est point la datte prise au secrétariat du présentateur qui empesche cette prévention, mais seulement la datte du
titre qu’en fait l’évesque ou bien Messrs les grands vicaires, sur la présentation qui lui est faite. Sur ce pied là, Monsr, rien n’empesche, ce me semble, que sitost après la réception de ma lettre, vous ne travailliez à faire expédier le titre en faveur d’un bon sujet tel que Monsr de Lisieux ou Mess. ses grands vicaires jugeront à propos de le choisir de concert avec vous. Je suis bien persuadé qu’un choix de cette nature ne saurait estre que bon et que ma conscience n’en sera point chargée, personne ne devant mieux connaistre les subjets propres aux cures- que les ordinaires des lieux; mais il est important pour la conservation de mon droit de nomination qu’il soit bien spécifié dans le titre qu’on expédiera que le pourvu a été présenté par l’évesque de Blois à qui ce droit appartient à cause de l’abbaye de St-Laumer unie à son évêché, et on le peut dire avec vérité, puisqu’en effet je veux bien tenir pour pnté par moy
celui que M. l’évesque choisira. Je consens volontiers que ce soit cet Adrien Ricquier dont vous dites tant de bien, si son deffault d’âge ne paroist pas estre un obstacle à conserver ce bénéfice sur sa teste. Je m’en rapporte aux supérieurs des lieux tant pour celluy là que pour les autres subjets par lad. cure vacante. Je croy que c’est tout ce que je puis faire de mieux pour obvier à tout retardement capable de produire la prévention en cour de Rome, aussi bien que pour vous marquer, Monsieur, que je suis très sincèrement votre très humble et très obéissant serviteur, David Nicolas, év. de Blois. » — Cette lettre n’a pas d’adresse, mais il est présumable quelle fut écrite à Mre Nicolas du
Houlley, chanoine de Lx et fils du seigr d’Ouillye. C’est lui qui la fit enregistrer au greffe des Insinuations, ainsi que l’acte qui suit. Le 25 juillet 1711, les vicaires généraux du seigr évoque donnent aud. sr Adrian Ricquier, acolyte, la collation de la cure de St-Martin-d’Ouillie. — II est à remarquer que Mre Léonor de Matignon, quoique
nouvellement nommé vicaire général, signe avant les deux anciens.
363. — Le 26 mars 1712, furent ordonnés sous-diacres : Me Adrian Ricquier, acolyte, curé de St-Martin-d’Ouillye.
343. — Le 5 déc. 1717, la nomination à la cure de St-Martin d’Ouillye appartenant au seigr abbé de St-Laumer de Blois, et lad . abbaye se trouvant réunie à perpétuité à l’évêché dud. lieu, le seigr évêque de Blois nomme à lad. cure d’Ouillye, vacante parla mort de Me Adrian Ricquier, dernier titulaire, la personne de M Louis Bourlet, diacre du
diocèse de Lx. Le 2 janvier 1717, le seigr évêque donne aud. sr Bourlet la collation dud. bénéfice. Le 3 février 1718, le sr Bourlet, diacre, prend possession de la cure de St- Martin d’Ouilly, en présence de Me François Jouen de
Bornainville, pbrë du grand séminaire de Lx; Me Charles du Loir, pbrë, curé de Firfol, et autres témoins de lad. parr.
SAINT-MARTIN-D’OUILLIE PUIS SAINT-MARTIN-DU-HOULLEY (vers 1719).
Curés. — F. Ricquier – A. Ricquier — L. Bourlet — F. Maillet — J.-B. Lechantre — J.-B. Lebrun.
Clercs. — J. Buquet — J.-B. Pastey — R. Pastey.
Patron. — L’abbé de Saint-Laumer — J.-F.-P. Lefesvre de Caumartin — L’évêque de Lx, sede vacante — Les religieux de Saint-Laumer.
Notable. — L. Hébert.
Chapelle Saint-Jacques et Saint-Philippe. (Au château du Houlley). — Chapelain. — N. du Houlley.
334. — Le 18 déc. 1719, le siège abbatial de St-Laumer de Blois étant vacant, le Seigr évêque de Lx donne à Me Félix Maillet, pbrë de Lx, la collation de la cure de St-Martin du Houlley, ci-devant appelée St-Martin d’Ouillie, vacante par la mort de Me Louis Bourlet. Le 17 mars 1720, led. sr Maillet prend possession dud. bénéfice, en présence de Me Jean-Baptiste Pastey, acolyte, et de plusieurs autres paroissiens.
390. — Le 7janv. 1720, la nomination à la cure de St-Martin-d’Ouillye appartenant au seigr abbé de St-Laumer de Blois, et le siège abbatial étant vacant par la vacance du siège épiscopal auquel est unie la mense abbatiale dud. monastère, les prieur et religieux de lad. abbaye, nomment à la cure de St-Martin-d’Ouillye, vacante par la mort de Me Louis Bourlet, pbrë, dernier titulaire, la personne de Me Félix Maillet, pbrë du diocèse de Lx.
Le 19 juin 1720, déjà en possession de la cure de St-Martin-du-Houlley, cy-devant S-Martin-d’Ouillye, en conséquence de la nomination faite de plein droit par le seigr évêque de Lx, le siège abbatial de St-Laumer étant vacant, le sr Maillet, pourvu encore dud. bénéfice par les religieux de lad. abbaye qui se disent patrons présentateurs de
St-Martin-du-Houlley, requiert dud. seigr évêque, afin « d’accumuler droit sur droit », une nouvelle collation de lad. cure. Mre Pierre Dumesnil-Leboucher, vicaire général, répond qu’il ne peut donner lad. collation « attendu que le lieu est remply et que mond. seigr évêque y a pourveu ».
374. — Le 10 septembre 1720, la nomination à la cure de St-Martin-du-Houlley, ci-devant St-Martin-d’Ouillie, appartenant au seigr abbé de St-Laumer de Blois, Mr Jean-François-Paul Lefêvre de Caumartin, évêque de Blois et abbé de St-Laumer, nomme à lad. cure, vacante par la mort de Me Félix Maillet, dernier titulaire, la personne de Mr Jean-Baptiste Le Chantre, pbrë, vicaire d’Hermival. Le 23 décembre 1720, les vicaires généraux, en l’absence du seigr
évêque de Lx, donnent aud. sr Le Chantre la collation dud. bénéfice. Le 29 décembre 1720, le sr Le Chantre prend possession de la cure de St-Martin-du-Houlley, en présence de Mre Adrian du Houlley, chevr, seigr-baron, châtelain et haut-justicier, seigr de Firfol et de la Lande, conser du roy en sa cour des Aides de Paris; Me Jean Barrey, pbrë,
curé de Réville, et autres habitants dud. lieu du Houlley.
541 — Le 5 septembre 1721 , la nomination à la cure de St-Martindu-Houlley, ci-devant St-Martin d’Ouillie, appartenant au seigr abbé de St-Laumer de Blois, le seigr évêque de Blois, abbé de lad. abbaye, nomme à lad. cure vacante par la mort de Me Jean-Baptiste Lechantre, pbrê, dernier titulaire, la personne de Me Jean-Baptiste Lebrun, pbrë du
diocèse de Lx. Le 23 sept. 1721, le seigr évêque de Lx donne aud. sr Lebrun la collation dud. bénéfice.
Le 20 sept. 1721, le sr Lebrun prend possession de la cure de St-Martin-du-Houlley avec toutes les cérémonies ordinaires, en présence de Mesre Adrian du Houlley, chevr, seigr baron, châtelain et haut-justicier du Houlley, seigr de Firfol et de la Lande, conser du roy en sa cour des Aides de Paris; Mesre Adrian du Houlley, fils dud. sgr, et autres habitants de lad. parr.
342. — Le 9 nov. 1724, dispense de parenté du 2e au 3e degré pour le mariage entre Jean-François de Cheux, Escr, demeurant en la parr. de St-Aubin d’Ouézy, diocèse de Séez, et damlle Marie de Carré, demeurant en la parr, de St-Léger du Houlley, autrefois appelée St-Léger d’Ouillie.
7OO. — Le 10 juillet 1721, titre clérical fait en faveur de Me Jean-Baptiste Pastey, acolyte, par Nicolas Pastey, laboureur, demeurant à St-Martin-du-Houlley.
193. — Le 1 er sept. 1726, César Levallet, marchand, demeurant à St-Martin-du-Houlley, constitue 150 livres de rente en faveur de Mr Richard Patey, acolyte dud. lieu, afin qu’il puisse parvenir aux ordres sacrés.
SAINT-MARTIN-D’OUILLIE ou SAINT-MARTIN-DU-HOULLEY.
Curés. — J.-B. Le Brun — V.-F. Duhamel.
Chapelle Saint-Jacques et Saint-Philippe, au château du Houlley. — Chapelain. — Ad. Hébert.
ÎO. — Le 2 déc. 1725, Me Adrian Hébert, diacre du diocèse de Lx, pourvu de la chapelle castrale de St-Jacques et St-Philippe du Houlley, autrefois d’Ouillie, prend possession dud. bénéfice, en présence de Me Jean-Baptiste Le Brun, pbrë, curé de St-Martin du Houlley, et plusieurs autres témoins.
193. — Le 1 er sept. 1726, César Levallet, marchand, demeurant à St-Martin-du-Houlley, constitue 150 livres de rente en faveur de Mr Richard Patey, acolyte dud. lieu, afin qu’il puisse parvenir aux ordres sacrés.
SAINT-MARTIN-D’OUILLIE ou SAINT-MARTIN-DU-HOULLEY.
Curés. — J.-B. Le Brun — V.-F. Duhamel.
Chapelle Saint-Jacques et Saint-Philippe, au château du Houlley . — Chapelain. — Ad. Hébert.
183. — Le 31 janv 1769, Me Pierre Mansel, pbrë, curé de St-Martin du Houlley (ci-devant Ouillie) et titulaire en commende du prieuré simple et régulier de St-Nicolas du Val-de-Claire, sis en la parr. Ste Catherine d’Honfleur, donne sa procuration pour résigner led. prieuré entre les mains de N.-S.-P. le pape en faveur de Dom Jean-Baptiste d’Albiac, clerc tonsuré du diocèse de Tours et religieux-profès de l’abbaye de Grestain. Il se réserve toutefois une pension annuelle de 200 livres, c’est-à-dire la moitié des revenus dud. prieuré qu’il a possédé pendant dix-huit ans environ.
Le sr d’Albiac, demeurant a Honfleur, déclare qu’il possède déjà le prieuré simple et régulier de N.-D. de Prélong, ancien Ordre de St-Benoist, au diocèse de Poitiers, et qu’en outre il a droit au prieuré d’Auffay, diocèse de Rouen, dont il n’a pas encore pris possession. Fait et passé à Lx, parr. St-Jacques, en l’auberge du Lion d’Or.
Le 4 juin 1769, led. sr d’Albiac obtient en cour de Rome, sous la signature de S.S. le pape Clément XIV, des lettres de provision dud. bénéfice.
Le 5 juillet 1769, le seigr évêque donne son visa auxd. lettres de provision.
Le 7 juillet 1769, le sr d’Albiac prend possession du prieuré simple ou chapelle de St-Nicolas du Val-de-Claire avec toutes les cérémonies ordinaires, en présence de Mesre Thomas-Bernard de Boislévesque, chevr, seigr et patron de St-Martim-le-Vieil, y demeurant; Me Pierre Ernoult, directeur des Postes, à Honfleur ; M Jacques-Jean-Guillaume
Goubard, négociant, tous deux demeurant aud. Honfleur, et autres témoins.
334. — Le 21 octobre 1751, Mre François-Léonor du Merle, clerc tonsuré du diocèse d’Evreux, âgé de 70 ans, prieur-chapelain du prieuré chapelle de St-Léger-d’Ouillie, situé en la parr. dud. lieu, résidant aud. prieuré, donne sa procuration pour résigner son bénéfice entre les mains de N.-S.-P. le Pape en faveur de son petit-neveu, Mre Jean-Annibal du Merle, aussi clerc tonsuré du diocèse d’Evreux, âgé de neuf ans et cependant capable de tenir et posséder lad. chapelle non sujette à résidence.
Le sr résignant se réserve toutefois à peu près la moitié des bâtiments du prieuré, une portion du jardin et une cour, ainsi qu’une pension de 350 livres de rente à prendre sur les revenus de ce bénéfice qu’il a desservi pendant cinquante-cinq ans environ. Fait et passé aud. prieuré, en présence de Me Pierre Lospron, pbre, curé de Moyaux et
doyen dud. lieu, et Me Adrien Hébert, curé do St-Léger-d’Ouillie.
Le 9 novembre 1751, led. sr Jean-Annibal du Merle obtient en cour de Rome des lettres de provision dud. bénéfice, avec la dispense d’âge nécessaire.
Le 29 févr. 1752, le seigr évêque donne son visa auxd. lettres de provision.
Le 9 mars 1752, le sr du Merle prend possession du prieuré simple non-conventuel, « sous l’invocation de St-Léger et de St-Martin d’Ouillie, situé en icelles parroisses, par la libre entrée en l’église paroissiale de St-Léger, où est led. prieuré dud. lieu joint », et autres cérémonies accoutumées. « Et à l’instant nous sommes avec led. sr du Merle, dit le
procès-verbal, transportez en lad. église parroissialle de St-Martin-d’Ouillie, où estant nous avons trouvé toutes les portes de lad. église fermées au nombre de trois. Vu quoi nous sommes tous transportez à la porte du manoir presbytéral dud. lieu de St-Martin-d’Ouillie qui ouvre sur le chemin qui tend dud. lieu de St-Martin à St-Léger, laquelle porte nous avons trouvée fermée, et à laquelle porte nous avons frappé à grands coups de marteau, à plusieurs reprises, sans pouvoir faire répondre personne Et nous ayant esté attesté par plusieurs des voisins du sr curé qu’il n’y a personne aud. manoir presbytéral, nous sommes transportez à la grande et principalle porte de lad. église paroissialle de St-Martin et avons mis led. sr du Merle en possession dud. prieuré » par la prière à dieu et le toucher de lad. principale porte, en présence de Me Thomas Mouton, pbfê habitué en l’église Str-Croix de Bernay, et autres témoins.
263. — Le 6 juill. 1756, dispense de bans pour le mariage entre Mesre Frédéric-Caesar de La Lande, capitaine au régiment royal des Vaisseaux, fils do Mesre Louis-Coesar de La Lande, seigr et patron des parr, du Détroit, Ouillie-le-Basset, St-Christophe des Pleurs et autres lieux, diocèse de Séez, et de noble dame Marie-Anne de Rambais, de la
parr, du Détroit, d’une part, et noble damlle Marie-Charlotte de Carrey, fille de Louis de Carrey, Escr, sr de Bellemare et du Fossey, et de feue noble dame Marie-Catherine du Loutrel, de la parr. de St-Léger-d’Ouillie,
diocèse de Lx.
41.— Le 19 févr. 1759,1a nomination à la cure de St-Martin-d’Ouillie appartenant au seigr évêque de Blois, Mgr Charles-Gilbert de May de Ternant, cons. du roy en ses conseils, évoque de Blois, demeurant à Paris, place Louis-le-Grand, parr. St-Roch, nomme à lad. cure, vacante par la mort de Me Jean-Baptiste Le Brun, pbrë, dernier titulaire, la
personne de M Pierre Mansel, pbrë du diocèse de Lx, chapelain « de là petite chapelle » du château du Houlley.
Le 26 févr. 1759, Mre Regnault, vic. gl du seigr évêque de Lx, donne aud. sr Mancel la collation dud. bénéfice.
Le 4 mars 1759, le sr Mansel prend possession de la cure de St-Martin-d’Ouillie, en présence de noble et puissant seigr Mesre Jean du Houlley, chevr, baron châtelain et haut-justicier du Houlley, seigr baron et patron de Fumichon, St-Pierre de Cantelou Firfol, la Lande et autres lieux, conser du roy en son parlement de Paris, demeurant en lad. ville;
Me Jean Greslebin, pbrë, desservant lad. parr. d’Ouillie; Me Guillaume-Jacques-François Boudard, arpenteur royal, demeurant à Firfol, et autres témoins.
110. — Le 7 juillet 1772, Me Pierre Mansel, pbrë, curé de St-Martin-du-Houlley, étant attaqué de paralysie de façon à ne plus pouvoir remplir ses fonctions curiales, donne sa procuration pour résigner lad. cure entre les mains de N.-S.-P. le pape en faveur de Me François Biset, pbrë, vicaire de Marolles. Il se réserve toutefois une partie du presbytère et une rente viagère de 300 livres à prendre sur les revenus de ce bénéfice qu’il a possédé pendant treize ans. Fait
et passé au manoir presbytéral de St-Martin-du-Houlley, en présence de Me Adrien Hébert, curé de St-Léger-d’Ouilly, et de Mre Noël-Jean de Piperey, seigr de St-Germain, seigr et patron honoraire de Piencourt, Cirfontaine et autres lieux, demeurant à Marolles. Le 27 juillet 1772, led. sr Biset obtient en cour de Rome des lettres de provisions de la cure de St-Martin-du-Houlley. Le 13 sept. 1772, le seigr évêque donne son visa auxd. lettres de provision. Le 5 janvier 1773, le sr Biset (1) prend possession de la cure du Houlley, en présence de Mesre Louis Dufaguet des Varennes, pbrë,
titulaire de la chapelle du château du Houlley, demeurant à Hermival, et autres témoins.
203. — Le 14 juillet 1773, Mre Claude-Henry Le Prestre de Théméricourt, acolyte du diocèse de Rouen, prieur commendataire du prieuré simple de St Léger et St Martin d’Ouilly dont il a pris possession par procureur le l4 sept. 1770, prend de nouveau possession en personne de ce bénéfice. Il trouve au presbytère de St-Martin d’Ouilly le même accueil peu bienveillant qu’y avait rencontré son mandataire.
395. — Le 2 août 1776, Me Pierre Hébert de la Motte, pbrë du diocèse de Lx, curé de St-Léger-du-Houlley, demeurant à Lx, parr. St-Jacques, donne sa procuration pour résigner lad. cure entre les mains de N.-S.-P. le Pape en faveur de Me Philippe Lamidey, pbrë de ce diocèse, (originaire de St-Pierre-de-Mailloc). Fait et passé à Lx,
parr. St-Jacques, en la maison de M. Guillaume-Jacques-François Boudard, receveur des décimes du diocèse.
Le 19 août 1776, led. sr Lamidey obtient en cour de Rome des lettres de provision dud. bénéfice.
Le 29 nov. 1776, le seigr évêque donne son visa auxd. lettres de provision. Le même jour, le sr Lamidey prend possession de la cure de St-Léger-du Houllay ou la Ribaude. — Ayant trouvé fermée la principale porte de l’église, ils (le curé et le notaire) apprirent que les clefs étaient entre les mains de François Fromage, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Lx, parr. St-Jacques, adjudicataire des réparations et reconstructions faites depuis peu à lad. église. Ils entrèrent par la porte latérale du choeur qu’ils trouvèrent séparé de la nef par une cloison qui devait rester
jusqu’à la réception des travaux. Ils apprirent encore que le peuple assistait aux offices paroissiaux dans le choeur où se fit aussi la cérémonie de la prise de possession en présence de plusieurs habitants du lieu.
127. —Le 29 sept. 1777, Mre Claude-Henry Leprêtre de Thèmericourt, acolyte du diocèse de Rouen, titulaire en commende du prieuré simple de St-Léger et St-Martin du Houlley, Ordre de St-Benoist, demeurant à Caen, parr. St-Gilles, donne sa procuration pour résigner led. prieuré entre les mains de N.-S.-P. le pape en faveur de Me Silvestre Satis de Belfort, pbfe du diocèse de Lx, bachelier en droit, vicaire de Loucelles, diocèse de Bayeux. Fait et passé en l’étude
du notaire apostolique de Caen. Le 6 nov. 1777, led. sr Satis de Belfort obtient en cour de Rome des lettres de provision dud. bénéfice. Le 8 janv. 1778, le seigr évêque donne son visa auxd. lettres de provision.
Le lendemain, le sr Satis de Belfort prend possession du prieuré d’Ouilly du Houlley «existant dans l’église paroissiale dud. lieu de St-Léger », parla libre entrée en icelle église et en la chapelle dud. prieuré, et autres cérémonies accoutumées. « Et pour continuer et parachever lad. prise de possession », il se rend à l’église paroissiale
de St-Martin-du-Houllay dont il trouve les portes fermées. Il se rend au presbytère avec le notaire apostolique pour avoir les clefs; mais personne ne s’étant présenté il retourne à l’église et prend possession par la prière à Dieu faite devant la principale porte, le toucher d’icelle, etc. Fait et passé en l’église paroissiale de St-Léger.
Mr Biset prêta le serment schismatique et resta dans sa paroisse en qualité de curé constitutionnel. Il mourut à St-Jacques de Lisieux (campagne St-Jacques) le 21 Juillet 1792.
Sa mort dut être assez prompte, car quinze jours auparavant il faisait encore un baptême dans son église. Le curé constitutionnel de St-Jacques célébra dans l’église de la paroisse un service pour le défunt, et les habitants d’ Ouilly ayant réclamé le corps, les gardes nationales de St-Jacques, Firfol, St-Martin et St-Léger-d’Ouilly le transportèrent dans sa paroisse sous la conduite de l’abbé Allaire, curé constitutionnel de Firfol, qui fit l’inhumation.
Prieuré de St Martin d’Ouillie du Houlley (voir Charité de Thiberville) dépendait de l’Abbaye de Saint Laumer (?) de Blois qui en 1697 fut érigé en évêché alors suivant le procès-verbal de l’érection il valait 300 livres.
SAINT-MARTIN-D’OUILLIE ou SAINT-MARTIN-DU-HOULLEY.
Curé. — J.-B. Le Brun — P. Mansel.
Prêtre desservant. — J n Greslebin.
Patron. — L’abbé de Saint-Laumer. — C.-G. de May de Ternant, év. de Blois.
Seigneur et notable. — A.-M.-J. du Houlley — P. Leudet.
Chapelle Saint-Jacques et Saint-Philippe au château du Houlley. —
Chapelains. — A. Hébert — L.-G. du Faguet de Varannes — Patron. — Le seigneur du lieu. — A.-M.-J. du Houlley.
Chapelain de la petite chapelle du château. — P. Mansel.
Dictionnaire de la Noblesse – De La Chenaye-Desbois et Badier.
– HOULEY(du), Baronnie qui a son époque vers 1725. Elle est aujourd’hui possédée par M. DU Houley, Conseiller au Parlement de Paris, comme héritier de M. du Houley, son père, qui en avoit acquis la terre de M. le Marquis d’Oraison.
– HOULLEY (du), en Normandie. De cette Famille étoit Nicolas du Houlley, Conseil en 1683, suivant l’Hist. de Rouen. Les armes : d’azur, à 4 fleurs de lis & 6 feuilles d’argent.
Recherche faite en 1540, par les élus de Lisieux des nobles de leur élection.
SAINT-MARTIN D’OUILLIE.
70. René de Maintenon, Sr. et baron du dit lieu d’Ouillie, pour justifier sa noblesse ancienne, a produit plusieurs lettres et écritures, la 1re desquelles est une grande lettre en parchemin en forme de rôle; commençant le lundi 24 juin 1409, sous le nom de Etienne Loresse, escuyer de l’écurie du Roi, duquel il a dit fournir être descendu par plusieurs lettres et écritures. Et si a fourni comme la différence du nom de Loresse à celui de Maintenon venoit de ce que Me. Jean Costereau, thésorier de France, possesseur de leur chastellenie de Maintenon, qui avoit appartenu aux prédécesseurs du dit Baron, avoit voulu usurper les nom et armes du dit Maintenon ; à laquelle usurpation s’étoit opposé le dit Baron, jouxte que contient l’acte de la dite opposition.
The Norman People And Their Existing Descendants In The British Dominions And The
United States Of America.
A voir si rapport avec Ouilly du Houlley
Howiey. Gislebert de Houlei, Norm. 1198 (MRS). John Houle, Engl. e. 1272 (RH). Hence William Howley, Archbishop of Canterbury.
Stapleton, Thomas: Magni Rotuli Scaccarii Normanniae sub Regibus Angliae. 2
De Gislet de Houlei.
Généalogiede Lafamille De Loynes – Orléans. Herluison, Libraire-Éditeur.
Branche De Mazère et du Houlley.
Daniel de Loynes, chevalier, seigneur de Mazère, auteur des branches du Houlley et de Fumichon.
Daniel DE LOYNES, chevalier, seigneur de Mazère, de la Thaudière et autres lieux, onzième enfant de Jehan de Loynes d’Autroche et de Thérèse Chartier, fut baptisé à Saint-Michel le 3 septembre 1732. Il fut capitaine au régiment de Blois ou de la Sarre et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1767. Il décéda à Mazère (cne de Nouan-le-Fuzelier),à l’âge de 70 ans, le 28 vendémiaire an XI (22 octobre 1802).
Il avait épousé en la paroisse Saint-Gervais de Paris, le 15 mai 1764, Anne-Renée-Cécile DU HOULLEY, née le 18 octobre 1743, fille de haut et puissant seigneur Mre Jean du Houlley, chevalier, baron châtelain haut-justicier de Saint-Martin-du-Houlley, seigneur honoraire de Firfol, Saint-Martin-du-Houlley, Saint-Léger-du-Houlley, seigneur de la Lande, etc…,conseiller du Roi en sa cour du Parlement, et de dame Jeanne-Anne Herment, baronne de Fumichon, dame de Saint-Pierre-de-Chanteloup, Chilliers, Barrat, Baudet, Bellemare, etc… Elle décéda à Orléans le 9 floréal an XIII (27 avril 1805).
Archives SHL.
Cartulaire Shl avec inventaires ShL et sources bibliographiques diverses du Xe siècle à 1940.
1444 Saint-Michel – Compte de Jean Le Muet p. 164
(132).- De la vente Michel Deschamps, faicte à Monseigneur Robert d’Artoys, chevalier, à cause du Manoir du Val-Hébert pour le bois-Morin, que soulloit tenir Robert du Bois-Morin et depuis la tinct messire Jehan de Briosne, jadis chevalier et à présent en sont tenans Robert Deschamps et sa femme héritière en partie de Jehan du Bosc.
Pour ce, pour moictié.. vij L x s
(Le Val-Hébert, situé à Ouilly-du-Houlley. Le Bois-Morin est mentionné en 1608 à Hermival (Aides chev.).
Jean IV d’Harcourt, baron de Brionne en 1388. Tué à Azincourt.)
1594 – 1595. Pièces relatives à des biens situés à Saint-Martin-d’Ouillie, appartenant à Jehan Parey, « du mestier d’esguilleterye », demeurant à Lisieux, paroisse Saint-Jacques.
= Arch. SHL. 3 F. 129. – 4 p. parchemin.
1617, 15 mars. Haut et puissant seigneur Messire Jehan de Longchamp, chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cinquante homme d’armes de ses ordonnances, seigneur et baron d’Ouillie, de Fumichon, et plusieurs autres seigneuries, capitaine et gouverneur pour sa majesté en cette ville de Lisieux et y demeurant donne à son épouse Marie de Frotays, procuration pour bailler et affermer ses biens.
= Arch. SHL. 9 FA. Paroisses – Ouilly-du-Houlley. – 1 p. papier 2 ff.
1655, 30 juin – Ouilly-du-Houlley. Olivier le Doux, prêtre de la paroisse Saint-Jacques de Lisieux, vend à François Desperrois, écuyer, sieur des Vaux, quatre pièces de terre à Saint-Martin-d’Ouillie.
= Tabell. de Lisieux – Disparu – Minutier n° 326. Analyse Etienne Deville.
1655, 19 juillet – Ouilly-du-Houlley. Pierre Thirel de Saint-Marin-d’Ouilly, vend à François Le Belhomme, bourgeois de Saint-Jacques de Lisieux, une pièce de terre à Saint-Martin-d’Ouilly. = Tabell. de Lisieux – Disparu – Minutier n° 352. Analyse Etienne Deville.
1696 – Election de Lisieux. Françoise de Carey, veuve de Louis de Carey, écuier, sieur de Bellemare
D’azur à une barre d’or accompagnée de deux étoiles de même et un chef aussy d’or chargé de trois carreaux ou pièces carrées de gueules. = PREVOST G.-A., Armorial général de France (Edit de Novembre 1696). Généralité d’Alençon publié d’après le manuscrit de la Bibliothèque nationale, Rouen-Paris, Lestringant-Picard, t. II, p. 2
1715, 17 juin – Ouilly-du-Houlley. Arpentage par Philippe Leudet arpenteur royal, demeurant à Moyaux, de portion de bois taillis à Hermival et Saint-Martin-du-Houlley, vendues cette année et dépendant de la baronnie du Houlley.
= Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1725. – Archives SHL.1F449. Succession de Charles Sébastien de Nocey. (décédé 16-06-1724) – Vente de la terre de la Reue.
– deux pièces sur papier, traité de mariage 25 juin 1508
– 1 pièce sur papier accord amiable entre la veuve de Nocey et ses enfants.
– 12 pièces dont deux sur parchemin dont vente de la terre de la Reue à Hermival, Ouilly du Houlley et Firfol.
1759 – Ouilly-du-Houlley. Noble et puissant seigneur messire Jean du Houlley, chevalier, baron, châtelain et haut-justicier dudit lieu du Houlley, aussi de Fumichon, seigneur et patron de Saint-Pierre-de-Canteloup, Baudet, Baratte, Thillaye, Firfol, de la Lande, Bellemare et autres terres et seigneuries, conseiller du roi au Parlement de Paris, y demeurant en son hôtel rue Geoffroy l’Asnier, paroisse Saint-Gervais. (extrait d’une pièce de procédure contre un sieur Bardel, de Saint-Julien-de-Mailloc). = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
Après 1759, 18 août – Ouilly-du-Houlley
Mémoire à consulter pour la liquidation de la succession…
» Monsieur (Jean) du Houlley, conseiller au Parlement de Paris, est mort en son château du Houlley en Normandie le 18 août 1759. Il avait été marié à Paris, en 1741 avec la demoiselle Hermant fille du médecin; ils étaient en communauté de biens. Il a laissé la dame sa veuve mariée à M. Chappe ancien conseiller du grand conseil et quatre enfants mineurs dont trois garçons et une demoiselle mariée et dotée depuis le décès du père par la dame sa mère, tutrice de ses enfants.
« Les trois quarts de la succession consistaient en la terre du Houlley en Normandie près Lisieux. Cette terre et baronnie venait de ses pères… ». = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1760, 11 janvier – Ouilly-du-Houlley. D’après une quittance signée de la baronnie du Houlley et donnée au château du Houlley, il appert qu’un répertoire des pièces a été dressé par Linel, notaire à Hermival, le 24 septembre 1759, titres et propriétés trouvées dans le château du Houlley, et que toutes les pièces ont été remises par Guillaume-Jacques-François Boudard à lad. dame du Houlley. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1760, 28 décembre – Ouilly-du-Houlley. Me Adrien-Marie-Jean du Houlley, chevalier, seigneur baron et haut justicier du Houlley, fait bail à Guillaume-Jacques-François Boudard, de Firfol, de toutes les rentes foncières et seigneuriales dépendant de la baronnie et haute justice du Houlley. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1760, 29 décembre – Ouilly-du-Houlley. Le sieur Pierre-Joseph Thorel a affermé à jean Gaullard père, la ferme de Courbec pour neuf années qui ont commencé au jour de Noël 1760 pour finir au jour de Noël 1769.
A la charge de faire et employer tous les ans à ses frais 20 gleux de glanne, de payer aussi deux poulets et outres toutes les charges, par le prix et somme de 400 livres de fermage payables en deux termes, le premier exigible au jour de Saint-Jean-Baptiste 1776 (?) et l’autre au jour de Noël ensuivant. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1766, 1er janvier – Ouilly-du-Houlley. Me du Houlley, de Saint-Aubin-le-Vertueux, a fait bail pour neuf années qui ont commencé au jour de Noël 1766 pour finir à pareil jour de l’année 1775 au sieur Jean Goubley de la ferme nommée Le Lieu Douville située en la paroisse de Firfol par bail sous signature privée le 1er janvier 1766.
A charge de faire chaumer et employer tous les ans à ses frais 400 gleux de chaume et 40 gleux de roseau, plus de fournir au château du Houlley 78 gleux de bonne paille gleux à gerbe, plus six douzaines de pigeons, fournir quatre journées de son harnois pour voiturer au profit dudit sieur bailleur, de fournir à ses frais au château 300 gleux de chaume plus un cochon gras ou 36 # plus 25 boisseaux de blé bien sec, plus fournir et planter tous les ans douze belles entes de valeur de 12 sols pièces, plus trois livres de bougies du Mans de quatre à la livre et trois pains de sucre fin de deux livres et demie, trois livres de pain. Ledit bail fait outre les conditions ci-dessus moyennant le prix et somme de 1050 livres de fermage par chacun an payables en deux termes égaux dont le premier sera exigible au jour de Noël 1767 et le second pour le jour Saint-Jean-Baptiste 1768. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1766, 1er novembre – 1767, 8 mars – Ouilly-du-Houlley. Mémoire de la dépense faite par M. le baron du Houlley à son château du Houlley, depuis et compris le premier jour de novembre 1766, jour de son arrivée jusqu’au 8 mars 1767, jour de son départ pour Paris. = Arch. SHL., 9 FA. Paroisses – Ouilly-du-Houlley. Papier 5 ff.
1771, 7 février – Ouilly-du-Houlley. Bail par Adrien-Marie-Jean du Houlley, chevalier, baron du Houlley, mousquetaire de la compagnie de la garde du Roi, demeurant à Paris, à Charles Duval, receveur des vingtièmes de la ville de Lisieux, de l’universalité de la terre seigneurie et baronnie du Houlley, fiefs, moulins, prés, fermes particulière qui en dépendant et vingt acres de bois taillis.= Arch. SHL., 9 FA. Parch. 2 ff.
1771. Pièces relatives aux sommes en argent consignées au Bureau des Consignations de Lisieux par les fermiers de la baronnie du Houlley.= Arch. SHL., 2 F. Fonds Boudard.
1771, 3 avril – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes
Le sieur Pierre-Joseph Thorel passa bail à Jean Jardin, de la ferme de la Guichonnière pour neuf années qui ont commencé au jour de Noël 1771 pour finir pareil jour 1780, à charge de faire chaumer et employer à ses frais tous les ans 300 gleux de chaume et 40 gleux de glenne, et en outre 100 gleux de chaume qu’il fera porter au château, fournira et plantera à ses frais 12 pieds d’arbres chacun an, fournira 47 chapons gras, 10 bons poulets, deux pains de sucre fin, deux livres et demie chacun et deux livres de bougies de 4 quatre à la livre, s’oblige en outre de faire au profit du bailleur, quatre journées de harnois, fournira au château 70 gleux de paille gleux à gerbe et en outre toutes les clauses, charges et conditions ci-dessus moyennant le prix et somme de 888 livres de fermage payable en deux termes, le premier a été acquitté au jour Saint-Jean-Baptiste 1772 et le second au jour de Noël audit an.
= Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771, 25 juin – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes. Le 25 juin 1771, le sieur Pierre-Joseph Thorel passa bail à Jean Jardin, de la ferme de la Guichonnière pour neuf années qui ont commencé au jour de Noël 1771 pour finir pareil jour 1780, de la ferme Saint-Christophe, dépendant de la baronnie du Houlley, à la charge par ledit preneur de faire chaumer et employer à sas frais tous les ans 400 gleux de chaume et 40 gleux de glanne, et en outre de faire porter au château 400 gleux de chaume, de fournir chacun an 10 boisseaux d’avoine, 6 chapons, 6 bons poulets, 3 douzaines de pigeons, quatre jours de charroy, 100 bottes de paille gleu à gerbes, et outre les charges et conditions ci-dessus moyennant le prix et somme de 1400 livres de fermage pour chacun an, payables en deux termes, le premier Saint Jean Baptiste et le second au jour de Noël.
= Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771, 29 juillet – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes Le sieur Pierre-Joseph Thorel passa bail à Jean Etard, pour neuf années qui ont commencé au jour de Noël 1772 pour finir à pareil jour de Noël 1781, de la terre et ferme du Bois Dumont dépendant de la baronnie du Houlley, à la charge par ledit preneur de payer et livrer au château du Houlley, chacun an, 15 boisseaux d’avoine, mesure de Lisieux, 6 bons chapons, 2 livres de bougie du Mans, des 4 à la livre, et 2 pains de sucre fin de 2 livres et demie chacun et payer toutes les rentes seigneuriales que ladite ferme est obligée de faire, fournir à ses frais 12 jeunes entes bonnes et valables, faire chaumer en employer à ses frais 400 bons gleux de chaume et 20 gleux de roseau de bled, de faire tous les ans au profit du sieur bailleur quatre jours de harnois ou 16 journées de cheval. Et outre les charges ci-dessus moyennant le prix et somme de 1200 livres de fermage pour chacun an, payables en deux termes, le terme Saint Jean et Noël. = Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771, 30 juillet – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes. Le sieur Pierre-Joseph Thorel passa bail à Jean-Baptiste Lepée de la Cour de la Fontaine pour neuf années qui ont commencé au jour de Noël 1771 pour finir à pareil jour de Noël 1780, moyennant le prix et somme de 80 livres. = Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771, 30 juillet – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes. Le sieur Pierre-Joseph Thorel a affermé à Louis Campie, meunier, le moulin de Saint-Léger, dépendant de la baronnie du Houlley, pour neuf années qui ont commencé aud. jour de Saint Michel 1774 pour finir à pareil jour de Noël 1783. A charge d’entretenir ledit moulin de fer, d’acier et métier, de fournir tous les ans deux bons chapons et deux bons canards et en outre 200 livres de fermage chacun an aud. jour saint Michel 1774 et les autres de trois mois en trois mois. = Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771, 14 octobre – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes. Le sieur Pierre-Joseph Thorel passe bail à Jean Anglement de la Ferme du Val Hébert dépendant de la baronnie du Houlley, pour neuf années entières qui ont commencé aud. jour de Saint Michel 1772 pour finir à pareil jour de Noël 1781. A charge de fournir 12 bonnes entes, et de faire chaumer et employer à ses frais tous les ans 200 de chaume et 40 gleux de roseau, de payer les rentes seigneuriales et domaniales, de fournir chacun an six douzaines de pigeons, faire cinq journées de harnois aussi chacun an fournir 6 bons poulets, 2 beaux dindons, 4 pains de sucre fin de chacun 2 livres et demie à 3 livres et 4 livres de bougies du Mans de quatre à la livre.
Le présent bail fait, outre les charges et conditions ci-dessus, moyennant 900 livres de fermage pour chacun an payables en deux termes égaux, soit le premier a été exigible au jour de Noël 1773 et le second à Paques 1774.
= Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771, 21 novembre – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes. Le sieur Pierre-Joseph Thorel a affermé à Jacques Labbé pour neuf années qui ont commencé au jour de Saint Michel 1772 pour finir à pareil jour en l’année 1781, la Ferme du Val Hébert dépendant de la baronnie du Houlley, A charge de payer les rentes seigneuriales dues pour les dits fonds, de faire chaumer et employer à ses frais tous les ans 400 gleux de chaume et 50 gleux de glenne, de fournir au jour Saint Jean-Baptiste 10 poulets et faire tous les ans quatre journées de harnois. En outre les charges et conditions ci-dessus, moyennant le prix et somme de 700 livres de fermage pour chacun an payables en deux termes, dont le premier a été exigible par avance au jour de Noël 1772 et le second au jour Saint Michel 1774 et ainsi continuer.
= Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771, 26 novembre – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes. Le sieur Pierre-Joseph Thorel a affermé au sieur Michel Lachey la ferme du château du Houlley pour neuf années qui ont du commencer à Noël 1770, pour finir à pareil jour en l’année 1781, à la charge payer chaque année 25 boisseaux d’avoine, 12 poulets, 2 livres de bougies, des 4 à la livre, 5 livres de sucres et 500 de grosses noix et en outre moyennant 1300 livres. = Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771, 2 décembre – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes. Le sieur Pierre-Joseph Thorel passa bail à Messire Louis du Faquet, prêtre, écuyer, sieur des Varennes de différentes pièces de terre dépendant de la baronnie du Houlley, pour neuf années qui commenceront au jour de Noël 1772 pour finir à pareil jour de l’année 1781, moyennant 490 livres
Le 28 avril 1772, bail au même de plusieurs autres pièces de terres moyennant 100 livres. = Arch. SHL., 2 F. Analyse Etienne Deville.
1771 – 1784 – Ouilly-du-Houlley
1771, 29 février – Fourniture de viande
1783, 21 avril – Refonte des cloches d’Hermival
1783, 24 avril – Prisonniers conduits à Lisieux
1783, 24 avril – Visite d’un cadavre
1783, 11 mai – Visite d’un cadavre.
1784, 26 mai – Réparation du presbytère de saint-Léger
1784, 23 avril – Acquit de fondations en l’église de Saint-Martin-du-Houlley
= Arch. SHL. 9 FA. Paroisse – Ouilly-du-Houlley. Pap. 7 pièces.
1772, 5 janvier – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes ? Le sieur Pierre-Joseph Thorel passa bail à Pierre Bouttey, maréchal de la forge dépendant de la baronnie du Houlley, pour neuf années qui ont commencé au jour de Noël 1771 pour finir à pareil jour de l’année 1780, moyennant 30 livres de fermage payable en deux termes, à Saint Jean et Noël. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1772, 24 juillet – Ouilly-du-Houlley – Paris
Dans une lettre, écrite à M. Boudard, à Lisieux, par M. Chappe, baron de Fumichon, datée de Paris, on relève:
« Le chevalier du Houlley doit se rendre lundi pour dîner à Fumichon. De la façon dont s’est exécuté son voyage, il ne m’a pas été possible d’en prévenir personne, de manière qu’il arrivera peut-être sans trouver de quoi dîner. J’en serois d’autant plus fâché qu’il a avec lui un jeune mousquetaire de ses amis qui ne trouveroit pas bon, suivant toutes les apparences de mourrir de faim dans ce pays-là. Je vous prie donc, aussitôt ma lettre reçue de prévenir par un mot de lettre et de lui envoyer par le porteur de la lettre ce qui sera nécessaire pour mettre le pot au feu et pour faire quelques entrées, comme côtelettes, pieds, saucisses, et en un mot ce que vous croirez convenir et qui sera le plus aisé à accommoder. Gérard envoyera ensuite chercher ce dont on aura besoin. S’il arrive que le chevalier vous demande de l’argent, vous lui donnerez aussi ce qu’il vous demandera en prenant de luy un reçu en mon nom et par ses mains… »
= Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1772, 17 septembre – Ouilly-du-Houlley. dates incohérentes ? Le sieur Pierre-Joseph Thorel afferma à Jean Gaillard, la ferme des Longschamps, dépendant de la baronnie du Houlley, à la charge de fournir tous les ans douze entes de valeur au moins de 12 sols, faire chaumer et employer à ses frais 200 gleux de chaume et 20 gleux de glenne, plus de fournir et livrer tous les ans une livre de bougie de quatre à la livre, un pain de sucre de livres et demie à trois livres et 2 chapons gras et en outre toutes les charges ci-dessus, moyennant 300 livres payables en deux termes à la Saint-Jean et à Noël. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1773 – Ouilly-du-Houlley dates incohérentes ? Le sieur Pierre-Joseph Thorel a affermé à Jean Bossey, laboureur, la ferme du château du Houlley pour huit années qui ont commencé au jour de Noël 1773. Moyennant 1300 livres par an de fermage payables en deux termes égaux à la saint Jean et à Noël.
Tenus ledit preneur de fournir chaque année six belles entes de valeur de 10 à 12 sols, tenu de faire chaumer et employer à ses frais 150 gleux de chaume et 10 gleux de glenne sur les bâtiments de ladite ferme, 25 boisseaux d’avoine, 12 poulets, 2 livres bougies de 4 à la livre, 2 pains de sucre de 2 livres et demie à 3 livres chacun.
Tenu encore ledit preneur de fournir tous les ans 500 de grosses noix et faire pour le profit du sieur bailleur quatre journées de harnois. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1775, 28 mai – Ouilly-du-Houlley
Délibération des habitants de Saint-Léger-du-Houlley, après le décès de Me Adrien Hébert, titulaire de la cure, relatif à l’inventaire de ses meubles et paiers, à l’apposition des scellés et aux réparations à faire au presbytère.
= Arch. SHL. 9 FA. Paroisses – Ouilly-du-Houlley
1776, 6-10 mai – Ouilly-du-Houlley
Arbitrage par Jean-Baptiste-Adrien de Neuville, avocat au Parlement, demeurant à Lisieux et Adrien-Georges Buscher des Noës, avocat au Parlement, conseiller du roi, lieutenant particulier au bailliage de Montreuil, pour régler et arrêter le compte général des fermages dus par Pierre-Joseph Thorel, fermier général de la baronnie du Houlley à Messire Alexandre-François-Pierre du Houlley, chevalier, baron du Houlley, mineur émancipé d’âge, seul héritier de feu messire Adrien-Marie-Jean du Houlley, son frère.
= Arch. SHL. 9 FA. Paroisses – Ouilly-du-Houlley. Pap. 14 ff.
1777, 17 juin – Ouilly-du-Houlley. Messire Alexandre-François-Pierre du Houlley, chevalier, baron du Houlley, signe une pièce établissant qu’il est héritier par bénéfice d’inventaire quant aux propres régis par la Coutume de Normandie, de feu messire Adrien-Marie-Jean du Houlley, son frère. = Arch. SHL. 2 F.
1777, 12 novembre – Ouilly-du-Houlley. Messire Alexandre-François-Pierre du Houlley, chevalier, seigneur, baron haut-justicier des fiefs de la Lande, Firfol et autres lieux, fait bail à Guillaume-Jacques-François Boudard, receveur des décimes, demeurant à Lisieux, des revenus de la baronnie du Houlley et desdits fiefs de la Lande et Firfol.
= Arch. SHL. 9 FA. Paroisses – Ouilly-du-Houlley.
1779, 30 septembre – Ouilly-du-Houlley. Arpentage par Nicolas Rousselet, arpenteur juré demeurant à Moyaux, d’une partie des bois taillis appartenant à maître Alexandre-François-Pierre du Houlley, ancien chevau-léger de la garde ordinaire du roi, héritier de Mre Adrien-Marie-Jean du Houlley, seigneur et baron haut-justicier du Houlley, demeurant ordinairement à Paris, paroisse Saint-Eustache. Bois de La Leux – Bois du Châtaignier – Bois des Onflaries.
Les tenanciers sont en général des gens de Firfol, Saint-Martin-du-Houlley et Hermival. = Arch. SHL. 2 F. Pap. 4 ff.
1780 – 1783 – Ouilly-du-Houlley.. Comptes rendus au baron du Houlley par son receveur.
« Ces comptes, recettes et dépenses, contiennent quelques curieuses indications; j’en ai extrait ce qui est relatif au château: 1780 – 10 feuillets – 1780 – 10 feuillets – 1781 – Réparations et plantations – 8 feuillets – 1783 – 8, 4, 7 feuillets » ED. = Arch. SHL. 2 F. 12 pièces pap. Analyse Etienne Deville.
1781, 7 février – Ouilly-du-Houlley. Bail fait par m. Silvestre Satis de Belfort, chanoine de l’insigne église collégiale de Saint-Sépulcre de Caen, et prieur commendataire du prieuré de Saint-Léger d’Ouillie, demeurant à Caen, rue des Chanoines, à Guillaume Fresnel, laboureur de la paroisse de Saint-Léger-du-Houlley, de la ferme et dîme dud. Saint-Léger-du-Houlley, pour neuf années moyennant 1.000 livres par an.
Non compris dans led. bail les rentes seigneuriales, treizièmes, déshérence, bâtardise, confiscation et autres droits seigneuriaux, fixes et casuels. = Arch. SHL. NE. 23. Ch. Vasseur. Pièces originales.
1783 – Ouilly-du-Houlley. « En 1783, Alexande-François-Pierre du Houlley était baron du Houlley et de Fumichon, en qualité d’héritier de Madame Chappe, sa mère, décédée. Ce fut lui qui bailla à Guillaume-Jacques-François Boudard, les bois taillis de la baronnie de Fumichon.
M. du Houlley étant décédé, M. de Mézières est devenu son héritier au droit de Madame du Houlley, son épouse. »
(Extrait d’un Mémoire à consulter… (1787). » sur ce bail, à propos de litiges. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1784, 1er octobre – Ouilly-du-Houlley. Bail pour neuf années qui commenceront à Noël 1789, des revenus de la baronnie du Houlley et des fiefs de la Lande et de Firfol et circonstances et dépendances consenti par Messire Alexand4re-François-Pierre du Houlley, chevalier, seigneur baron haut-justicier du Houlley, seigneur des fiefs de La Lande et autres lieux, demeurant à Lisieux, paroisse Saint-Jacques, à Pierre David, bourgeois de Lisieux, y demeurant, même paroisse, moyennant la somme de 17.300 livres. = Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
1784 – Ouilly-du-Houlley.
Etat des baux de la baronnie du Houlley:
Ferme du château- Ferme du Lieu Bouet – Trois corps de fermes: Les Longschamps, Le Courbec, La Reux – La Grande Prairie du Houlley – Le Moulin de Clipint – La ferme du Bois du Mont – La ferme du Val-Hébert – La ferme de la Rochelle – Le Moulin de Saint-Léger – La ferme de Saint-Léger-du-Houlley – La ferme du Lieu d’Ouville.
= Arch. SHL. 9 FA. Paroisses. Ouilly-du-Houlley.
1793, 10 août – Ouilly-du-Houlley. Dans un acte de rachat de rentes passé devant Eustache Berraud, à Hermival, on lit: « Daniel de Loynes ayant épousé Anne-Renée-Cécile du Houlley, seule et unique héritière de feu Alexandre-François-Pierre du Houlley, son frère, qui était devenu seul et unique héritier de feu Jean du Houlley, leur père commun »
= Arch. SHL. 2 F. Analyse Etienne Deville.
FONDS BOUDARD ou BOUDARD.
-2FK25 : Abbaye de Grestain : 1759 : correspondance entre M. Mauger de Caen et Boudard au Château du Houlley.
-2FM59 : Livre de comptes pour le baron Duhoulley (du Houlley)
Voir « Imprimés ».
I J 5 : Observations pour le baron du Houlley, mousquetaire contre M. Chappe, son beau-père, et M. de Saint Aubin, son oncle, demandeurs, 1759. Terres et château du Houlley (ex n° 72)
FONDS STURLER.
23 C Madame SARDET OUILLEY DU HOULEY août 1960
Poteries et étains présentation 2 pellicules
56 I Ouilly-du-Houlley Ferme Auberge nov 78
3 photos NB 9/13
1 photo NB 13/18
2 pellicules NB
demande : M. Lanos
– Fonds VASSEUR :
12 – OUILLYE DU HOULLEY ou OULLAYA RIBALDI ou St Martinus de Ouillera Doyenné de Moyaux élection de Lisieux, sergenterie de Moyaux 45 feux.
Sous l’invocation de St Martin
Patronage:
XIVe R. de Brucourt
XVIe Abbas S. Lamonari Blesensis
XVIIIe l’Evêque de Blois
Capella SS Johannes et Philippi in baronia de Ouilleya
Patronage: Baro loci
Curés:
Maurel 1764
Pierre Mancel 1766
Biset 1772/1787
Insinuations:
Description de l’église du 17 juillet 1853
Description du château (extérieur et intérieur)
Description de la cloche :
La générosité des paroissiens de Ouilly du Houlley et le vœu de M. Tesson leur pasteur, m’ont appelée ici, J’ai été bénite au mois de juin 1838 par M. Jarolet, curé de St-Pierre de Lisieux, chanoine de Bayeux.
Je me nomme Marie Elisabeth mes parrain et marraine sont Messire Charles Jérôme Gabriel Baguenault et Dame Adelaïde Zoé de Loynes du Ouilley
Mahuet : fondeur
Houley en Normandie subdélégation de Lisieux d’Azur à trois coquilles d’argent.
La Baronie du Houley a son époque vers 1725. Elle est aujourd’hui possédée par Monsieur du Houley, conseiller au Parlement de Paris, comme héritier de Monsieur du Houley son père, qui en avait acquis la terre de Monsieur le Marquis d’Oraison. (La chesnaye tome 8 page 133)
Ouilli du Houlei, arrondissement de Lisieux.
Ouilli du Houlei date de 1825.Cette commune a été formée du Houlie et d’Ouillie-la-Ribaude. Le surnom de cette dernière vient, dit Monsieur Dubois, de l’ancien mot ribaude (femme débauchée), parce que sans doute autrefois il y avait en cette commune beaucoup plus de libertinage qu’aux environs, ou peut-être ce sobriquet n’est-il qu’une simple taquinerie de voisins, fort commune autrefois même dans le beau monde, même à la Cour. Monsieur Dubois ajoute que le mot Houlli avait beaucoup de rapport avec le surnom d’Ouilli, car en roman, Houilleur et Houlier signifiaient homme débauché.
Baux généraux de la terre du Houlley passés entre Messire Alexandre François Pierre du Houlley, chevalier, seigneur baron Haut Justicier du Houlley, seigneur des fiefs de la Lande, Firfol et autres lieux, de présent au château de Fumichon et Guillaume Jacques François Boudard, receveur des décimes demeurant à Lisieux, 12 novembre 1777 et
Pierre David, bourgeois de Lisieux, 1er octobre 1784,
en 1787 avec Messire Daniel de Loynes, chevalier, seigneur de Mazères et autres lieux, chevalier de l’ordre militaire et royal de Saint Louis, et Noble Dame Anne Renée Cécile du Houlley, son épouse, seule héritière de Monsieur le Baron du Houlley, son frère, demeurant à Orléans. Comptes rendus. Etats des baux partiels, transactions, quittances et pièces à l’appui au nombre de vingt (communiqués par Ch.Vasseur le 3 août 1869)
Le plus ancien des seigneurs d’Ouillie dont on ait conservé le nom est Martin d’Ouillie qui figure dans les rôles de l’Echiquier de Normandie à la date de 1180.
Il existe ensuite une lacune pendant tout le 13e siècle et une partie du 14e. Il est fort étonnant que le registre de Philippe Auguste ne fasse point mention de cette terre importante qui dès lors était baronnie.
En 1464, Philippe le Veneur, baron de Tillières, fit partage de la seigneurie d’Ouillie la Ribaude avec Philippe de Manneville et Catherine le Baveux, veuve de Louvel l’Estandart.
Philippe le Veneur avait épousé en 1450 Marie Blosset, fille de Guillaume Blosset, seigneur de Carrouges et de Marguerite de Malestroit. Leur second fils fut évêque de Lisieux.
Il avait une part d’hérédité dans la terre d’Ouillie parce que son père Jean le Veneur, seigneur du Homme, qui fut tué à Azincourt en 1415, avait épousé Jeanne de Baveux, fille de Robert le Baveux, baron de Tillières et d’Agnès Paynel. C’était une héritière, je crois, sans avoir acquis la preuve que la baronnie d’Ouillie venait des Paynel parce qu’ils ont possédé beaucoup de terres de ce côté. C’est Philippe de Manneville qui resta en possession de la terre d’Ouillie.
Monseigneur Jehan de Manneville (sans doute son fils) chevalier seigneur et baron d’Ouillie et d’un fief assis à Lieuray, nommé Tillières, n’ayant point comparu aux Montres de la Noblesse du bailliage d’Evreux, ordonnées par Louis XI en 1469, ces fiefs furent pris et mis à la main du Roy sous laquelle ils seront régis et gouvernes jusques à ce qu’ils aient fait apparoir comme et du lieu où il s’était présenté.
En 1540 René de Maintenon était seigneur et baron d’Ouillie. Pour justifier sa noblesse devant les élus de Lisieux il produisit plusieurs lettres et écritures, la première desquelles est une grande lettre en parchemin en forme de rôle, commençante le lundi 24 juin 1409 sous le nom d’Etienne Loresse, escuyer de l’écurie du Roy, duquel il a dit fournir être descendu par plusieurs lettres et écritures. Et il a fourni comme la différence du nom de Loresse à celui de Maintenon venait de ce que Me Jean Costereau, trésorier de France, possesseur de leur chatellerie de Maintenon qui avait appartenu aux prédécesseurs dudit baron, avait usurpé les noms et armes dudit Maintenon à laquelle usurpation s’était opposé ledit baron jouxte ce que contient l’acte de ladite opposition (Recherches des Elus de Lisieux p. 30 et 31)
De Nollent : de gueules au chef cousu de sinople à l’aigle d’argent sur le tout (Lachesnaye tome 11).
Il n’est point étonnant de voir une alliance entre cette famille et le baron d’Ouillie puisqu’elle a possédé plusieurs fiefs dans le voisinage immédiat du château d’Ouillie
Dès le commencement du 17e siècle, la baronnie d’Ouillie est dans les mains de la famille de Longchamp de Fumichon, dont plusieurs membres furent gouverneurs de la ville de Lisieux au 16e siècle.
Dans une transaction faite avec le receveur de Charles de Clercy, écuyer, sieur de Mortemer et des Louverets, relativement des droits de treizièmes à prélever sur des terres situées à Moyaux, Messire Jehan de Longchamp prend les qualifications suivantes : chevalier de l’Ordre du Roy, conseiller en ses Conseils d’Etat et privé, gouverneur de la ville de Lisieux, baron et chastelain d’Ouillie, seigneur de Fumichon, Boudet, La Lande, Baratte et autres qualités et sieuries. Il avait épousé Noble Jehanne Dumoulin qui mourut vers 1614 car le 27 août de cette année, ses biens furent partagés par François Lambert d’Herbigny d’une part, Nicolas Jean et Louis de Bigars d’une autre part, et enfin par Abraham de Combault, héritiers chacun pour un tiers (Archives de l’Hospice)
Jehan de Longchamp ne laissa point d’héritier mâle et sa fortune fut partagée entre Louis de Rabodanges et Cézar d’Oraison qui avait épousé Noble Dame Catherine de Longchamp.
La femme du Marquis de Rabodanges eut Fumichon. Celle du sieur d’Oraison Ouillie, c’est ce qui résulte de protocoles d’actes où l’on voit figurer : Haut et Puissant Seigneur Messire Louis de Rabodanges, chevalier marquis de Crévecoeur et baron de Fumichon (27 septembre 1650)
Messire Cézar d’Oraison, chevalier marquis de Livarot, baron et châtelain d’Ouillie, seigneur du Mesnil Godemen et plusieurs autres terres, sous-lieutenant des gendarmes bourguignons, gouverneur, pour le service de sa Majesté, de la ville de Lisieux (acte de l’Hospice de 1672 et 1683. Reçus de treizièmes de mars 1637)
Cézar d’Oraison fit sa résidence ordinaire au château d’Ouillie. Il y produisit dans la recherche de 1666. On y lit « Ouillie. Cézar d’Oraison, châtelain de Livarot, ancien noble)
Il eut des enfants dans j’ignore les noms. Néanmoins la baronnie d’Ouillie ne tarda pas à passer à la famille du Houlley qui lui a laissé son nom.
Messire Alexandre François Pierre du Houlley, chevalier seigneur, baron châtelain et haut justicier du Houlley, seigneur baron et patron de Fumichon, Firfol, La Lande Boudet, Barale, Thilière et autres lieux, mourut entre 1785 et 1787, laissant pour seule héritière sa sœur Noble Dame Cécile du Houlley, épouse de Messire Daniel de Loynes, chevalier seigneur de Mazéres et autres lieux, chevalier de l’Ordre royal militaire de Saint Louis, demeurant ordinairement à Orléans.
Monsieur de Mazéres possédait encore ces terres à la Révolution. Ouillie est maintenant en possession de Monsieur Baguenault de Puchesse, son neveu, qui habite aussi Orléans, mais il vient de vendre le château (octobre 1861) au Sieur…… son fermier qui est dans l’intention de le faire démolir.
En 1588, suivant de Bras, la baronnie d’Ouillie se composait de quatre fiefs de haubert dont il ne donne pas les noms. Elle avait des extensions sur les paroisse de Moyaux et d’Hermival.
SHL : Achat du 11-02-2003
Lot n° 71 PAYS D’AUGE, (9 DOCUMENTS)
Saint Martin d’Ouilly ; 10 minutes notariées de 1599 à 1617 ; papier.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
On trouve l’Armorial de d’Hozier, une dame Françoise Jean, veuve de Jacques de La Lande, écuyer, seigneur d’Ouilly, mais c’est probablement de St Léger d’Ouilly qu’il s’agit.
Le fief de Saint-Léger-d’Ouilly relevait de la vicomte d’Orbec, 1320 (fiefs de la vicomte).
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
1 – Le Manoir de Bellemare.
Michel COTTIN.
Le Manoir de Bellemare construit à la limite de la commune d’Ouilly-du-Houlley vers Marolles, est un monument exceptionnel par son ancienneté et par la technologique particulière de la construction du logis de bois. Unique nous semble-t-il dans notre région, son nom même évoque une vieille histoire dont nous ne possédons que des bribes.
Cependant, malgré son indéniable intérêt, nous n’avons pu découvrir la moindre monographie le concernant et Charles Vasseur, pourtant si scrupuleux, le mentionne dans la Statistique monumentale du calvados, en le situant d’ailleurs sur le territoire de paroisse de Firfol.
Il comprend plusieurs parties distinctes dont les deux premières seules nous intéressent ici.
A une époque difficile à cerner – sans doute au XIVe siècle – est édifié un logis de pierre quadrangulaire.
A ce logis, fut accolé une grande construction à pans de bois à encorbellements sur trois côtés. C’est d’un type de charpenterie inconnu en pays d’Auge – sans doute de multiples exemples ont-ils disparu, qui emprunte sa technologie à la Bretagne (Cf. SOULAS et HANSEN, p. 133.) et à l’ancien domaine des Plantagenêts avec son encorbellement sur solives.


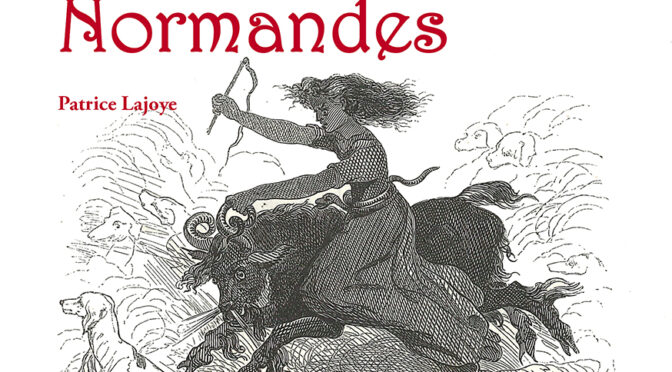
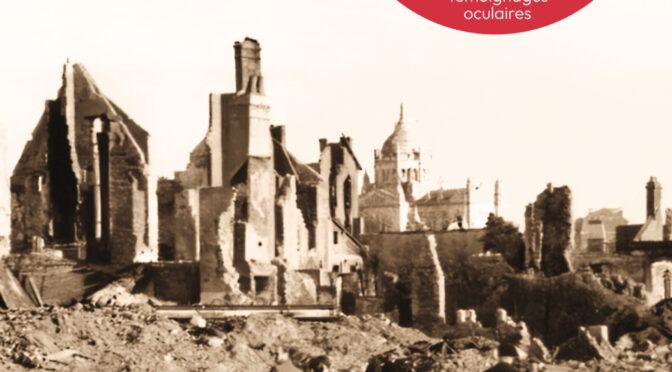
Laisser un commentaire